La déchéance de Napoléon contée par Victor Hugo dans ce poème publié dans Les Châtiments (1853).
L’EXPIATION
I
Il neigeait. On était vaincu par sa
conquête.
Pour la première fois l’aigle
baissait la tête.
Sombres jours ! l’empereur
revenait lentement,
Laissant derrière lui brûler Moscou
fumant.
Il neigeait. L’âpre hiver fondait en
avalanche.
Après la plaine blanche une autre
plaine blanche.
On ne connaissait plus les chefs ni
le drapeau.
Hier la grande armée, et maintenant
troupeau.
On ne distinguait plus les ailes ni
le centre.
Il neigeait. Les blessés s’abritaient
dans le ventre
Des chevaux morts ; au seuil des
bivouacs désolés
On voyait des clairons à leur poste
gelés,
Restés debout, en selle et muets, blancs de
givre,
Collant leur bouche en pierre aux
trompettes de cuivre.
Boulets, mitraille, obus, mêlés aux
flocons blancs,
Pleuvaient ; les grenadiers,
surpris d’être tremblants,
Marchaient pensifs, la glace à leur
moustache grise.
Il neigeait, il neigeait
toujours ! La froide bise
Sifflait ; sur le verglas, dans
des lieux inconnus,
On n’avait pas de pain et l’on allait
pieds nus.
Ce n’étaient plus des cœurs vivants,
des gens de guerre
C’était un rêve errant dans la brume,
un mystère,
Une procession d’ombres sous le ciel
noir.
La solitude vaste, épouvantable à
voir,
Partout apparaissait, muette
vengeresse.
Le ciel faisait sans bruit avec la
neige épaisse
Pour cette immense armée un immense
linceul ;
Et chacun se sentant mourir, on était
seul.
— Sortira-t-on jamais de ce funeste
empire ?
Deux ennemis ! le czar, le nord.
Le nord est pire.
On jetait les canons pour brûler les
affûts.
Qui se couchait, mourait. Groupe
morne et confus,
Ils fuyaient ; le désert
dévorait le cortège.
On pouvait, à des plis qui
soulevaient la neige,
Voir que des régiments s’étaient
endormis là.
Ô chutes d’Annibal ! lendemains
d’Attila !
Fuyards, blessés, mourants, caissons,
brancards, civières,
On s’écrasait aux ponts pour passer
les rivières,
On s’endormait dix mille, on se
réveillait cent.
Ney, que suivait naguère une armée, à
présent
S’évadait, disputant sa montre à
trois cosaques.
Toutes les nuits, qui vive !
alerte ! assauts ! attaques !
Ces fantômes prenaient leur fusil, et sur
eux
Ils voyaient se ruer, effrayants,
ténébreux,
Avec des cris pareils aux voix des
vautours chauves,
D’horribles escadrons, tourbillons
d’hommes fauves.
Toute une armée ainsi dans la nuit se
perdait.
L’empereur était là, debout, qui
regardait.
Il était comme un arbre en proie à la
cognée.
Sur ce géant, grandeur jusqu’alors
épargnée,
Le malheur, bûcheron sinistre, était
monté ;
Et lui, chêne vivant, par la hache
insulté,
Tressaillant sous le spectre aux
lugubres revanches,
Il regardait tomber autour de lui ses
branches.
Chefs, soldats, tous mouraient.
Chacun avait son tour.
Tandis qu’environnant sa tente avec
amour,
Voyant son ombre aller et venir sur
la toile,
Ceux qui restaient, croyant toujours
à son étoile,
Accusaient le destin de
lèse-majesté,
Lui se sentit soudain dans l’âme
épouvanté.
Stupéfait du désastre et ne sachant
que croire,
L’empereur se tourna vers Dieu ;
l’homme de gloire
Trembla ; Napoléon comprit qu’il
expiait
Quelque chose peut-être, et, livide,
inquiet,
Devant ses légions sur la neige
semées :
« Est-ce le châtiment,
dit-il, Dieu des armées ? »
Alors il s’entendit appeler par son
nom
Et quelqu’un qui parlait dans l’ombre
lui dit : Non.
II
Waterloo ! Waterloo ! Waterloo !
morne plaine !
Comme une onde qui bout dans une urne
trop pleine,
Dans ton cirque de bois, de coteaux,
de vallons,
La pâle mort mêlait les sombres
bataillons.
D’un côté c’est l’Europe et de
l’autre la France.
Choc sanglant ! des héros Dieu
trompait l’espérance
Tu désertais, victoire, et le sort
était las.
Ô Waterloo ! je pleure et je
m’arrête, hélas !
Car ces derniers soldats de la
dernière guerre
Furent grands ; ils avaient
vaincu toute la terre,
Chassé vingt rois, passé les Alpes et
le Rhin,
Et leur âme chantait dans les
clairons d’airain !
Le
soir tombait ; la lutte était ardente et noire.
Il avait l’offensive et presque la
victoire ;
Il tenait Wellington acculé sur un
bois.
Sa lunette à la main, il observait
parfois
Le centre du combat, point obscur où
tressaille
La mêlée, effroyable et vivante
broussaille,
Et parfois l’horizon, sombre comme la
mer.
Soudain, joyeux, il dit :
Grouchy ! — C’était Blücher.
L’espoir changea de camp, le combat
changea d’âme,
La mêlée en hurlant grandit comme une
flamme.
La batterie anglaise écrasa nos
carrés.
La plaine, où frissonnaient les drapeaux déchirés,
Ne fut
plus, dans les cris des mourants qu’on égorge,
Qu’un gouffre flamboyant, rouge comme
une forge ;
Gouffre où les régiments comme des
pans de murs
Tombaient, où se couchaient comme des
épis mûrs
Les hauts tambours-majors aux
panaches énormes,
Où l’on entrevoyait des blessures
difformes !
Carnage affreux ! moment
fatal ! L’homme inquiet
Sentit que la bataille entre ses
mains pliait.
Derrière un mamelon la garde était
massée.
La garde, espoir suprême et suprême
pensée !
« Allons ! faites
donner la garde ! » cria-t-il.
Et, lanciers, grenadiers aux guêtres
de coutil,
Dragons que Rome eût pris pour des
légionnaires,
Cuirassiers, canonniers qui
traînaient des tonnerres,
Portant le noir colback ou le casque
poli,
Tous, ceux de Friedland et ceux de
Rivoli,
Comprenant qu’ils allaient mourir
dans cette fête,
Saluèrent leur dieu, debout dans la
tempête.
Leur bouche, d’un seul cri,
dit : vive l’empereur !
Puis, à pas lents, musique en tête,
sans fureur,
Tranquille, souriant à la mitraille
anglaise,
La garde impériale entra dans la
fournaise.
Hélas ! Napoléon, sur sa garde
penché,
Regardait, et, sitôt qu’ils avaient
débouché
Sous les sombres canons crachant des
jets de soufre,
Voyait, l’un après l’autre, en cet
horrible gouffre,
Fondre ces régiments de granit et
d’acier
Comme fond une cire au souffle d’un
brasier.
Ils allaient, l’arme au bras, front
haut, graves, stoïques.
Pas un ne recula. Dormez, morts
héroïques !
Le reste de l’armée hésitait sur
leurs corps
Et regardait mourir la garde. — C’est
alors
Qu’élevant tout à coup sa voix
désespérée,
La Déroute, géante à la face
effarée
Qui, pâle, épouvantant les plus fiers
bataillons,
Changeant subitement les drapeaux en
haillons,
À de certains moments, spectre fait
de fumées,
Se lève grandissante au milieu des
armées,
La Déroute apparut au soldat qui
s’émeut,
Et, se tordant les bras, cria :
Sauve qui peut !
Sauve qui peut ! —
affront ! horreur ! — toutes les bouches
Criaient ; à travers champs,
fous, éperdus, farouches,
Comme si quelque souffle avait passé
sur eux,
Parmi les lourds caissons et les
fourgons poudreux,
Roulant dans les fossés, se cachant
dans les seigles,
Jetant shakos, manteaux, fusils,
jetant les aigles,
Sous les sabres prussiens, ces
vétérans, ô deuil !
Tremblaient, hurlaient, pleuraient,
couraient ! — En un clin d’œil,
Comme s’envole au vent une paille
enflammée,
S’évanouit ce bruit qui fut la grande
armée,
Et cette plaine, hélas, où l’on rêve
aujourd’hui,
Vit fuir ceux devant qui l’univers
avait fui !
Quarante ans sont passés, et ce coin
de la terre,
Waterloo, ce plateau funèbre et
solitaire,
Ce champ sinistre où Dieu mêla tant
de néants,
Tremble encor d’avoir vu la fuite des
géants !
Napoléon les vit s’écouler comme un
fleuve ;
Hommes, chevaux, tambours,
drapeaux ; — et dans l’épreuve
Sentant confusément revenir son
remords,
Levant les mains au ciel, il
dit : « Mes soldats morts,
Moi vaincu ! mon empire est
brisé comme verre.
Est-ce le châtiment cette fois, Dieu
sévère ? »
Alors parmi les cris, les rumeurs, le
canon,
Il entendit la voix qui lui
répondait : Non !
III
Il croula. Dieu changea la chaîne de
l’Europe.
Il est, au fond des mers que la brume
enveloppe,
Un roc hideux, débris des antiques
volcans.
Le Destin prit des clous, un marteau,
des carcans,
Saisit, pâle et vivant, ce voleur du
tonnerre,
Et, joyeux, s’en alla sur le pic
centenaire
Le clouer, excitant par son rire
moqueur
Le vautour Angleterre à lui ronger le
cœur.
Évanouissement d’une splendeur
immense !
Du soleil qui se lève à la nuit qui
commence,
Toujours l’isolement, l’abandon, la
prison,
Un soldat rouge au seuil, la mer à
l’horizon,
Des rochers nus, des bois affreux,
l’ennui, l’espace,
Des voiles s’enfuyant comme l’espoir
qui passe,
Toujours le bruit des flots, toujours
le bruit des vents !
Adieu, tente de pourpre aux panaches
mouvants,
Adieu, le cheval blanc que César
éperonne !
Plus de tambours battant aux champs,
plus de couronne,
Plus de rois prosternés dans l’ombre
avec terreur,
Plus de manteau traînant sur eux,
plus d’empereur !
Napoléon était retombé
Bonaparte.
Comme un romain blessé par la flèche
du Parthe,
Saignant, morne, il songeait à Moscou
qui brûla.
Un caporal anglais lui disait :
halte-là !
Son fils aux mains des rois ! sa
femme aux bras d’un autre !
Plus vil que le pourceau qui dans
l’égout se vautre,
Son sénat qui l’avait adoré
l’insultait.
Au bord des mers, à l’heure où la
bise se tait,
Sur les escarpements croulant en
noirs décombres,
Il marchait, seul, rêveur, captif des
vagues sombres.
Sur les monts, sur les flots, sur les
cieux, triste et fier,
L’œil encore ébloui des batailles
d’hier,
Il laissait sa pensée errer à
l’aventure.
Grandeur, gloire, ô néant !
calme de la nature !
Les aigles qui passaient ne le
connaissaient pas.
Les rois, ses guichetiers, avaient
pris un compas
Et l’avaient enfermé dans un cercle
inflexible.
Il expirait. La mort de plus en plus
visible
Se levait dans sa nuit et croissait à
ses yeux
Comme le froid matin d’un jour
mystérieux.
Son âme palpitait, déjà presque
échappée.
Un jour enfin il mit sur son lit son
épée,
Et se coucha près d’elle, et
dit : « C’est aujourd’hui »
On jeta le manteau de Marengo sur
lui.
Ses batailles du Nil, du Danube, du
Tibre,
Se penchaient sur son front, il dit :
« Me voici libre !
Je suis vainqueur ! je vois mes
aigles accourir ! »
Et, comme il retournait sa tête pour
mourir,
Il aperçut, un pied dans la maison
déserte,
Hudson Lowe guettant par la porte
entrouverte.
Alors, géant broyé sous le talon des
rois,
Il cria : « La mesure est
comble cette fois !
Seigneur ! c’est maintenant
fini ! Dieu que j’implore,
Vous m’avez châtié ! » La
voix dit : Pas encore !
IV
Ô noirs événements, vous fuyez dans la
nuit !
L’empereur mort tomba sur l’empire
détruit.
Napoléon alla s’endormir sous le
saule.
Et les peuples alors, de l’un à
l’autre pôle,
Oubliant le tyran, s’éprirent du
héros.
Les poëtes, marquant au front les
rois bourreaux,
Consolèrent, pensifs, cette gloire
abattue.
À la colonne veuve on rendit sa
statue.
Quand on levait les yeux, on le
voyait debout
Au-dessus de Paris, serein, dominant
tout,
Seul, le jour dans l’azur et la nuit
dans les astres.
Panthéons, on grava son nom sur vos
pilastres !
On ne regarda plus qu’un seul côté
des temps,
On ne se souvint plus que des jours
éclatants
Cet homme étrange avait comme enivré
l’histoire
La justice à l’œil froid disparut sous sa
gloire ;
On ne vit plus qu’Eylau, Ulm, Arcole,
Austerlitz ;
Comme dans les tombeaux des romains
abolis,
On se mit à fouiller dans ces grandes
années
Et vous applaudissiez, nations
inclinées,
Chaque fois qu’on tirait de ce sol
souverain
Ou le consul de marbre ou l’empereur
d’airain !
V
Le nom grandit quand l’homme
tombe ;
Jamais rien de tel n’avait
lui.
Calme, il écoutait dans sa
tombe
La terre qui parlait de
lui.
La
terre disait : « La victoire
A suivi cet homme en tous
lieux.
Jamais tu n’as vu, sombre
histoire,
Un passant plus
prodigieux !
» Gloire au maître qui dort sous
l’herbe !
Gloire à ce grand
audacieux !
Nous l’avons vu gravir,
superbe,
Les premiers échelons des
cieux !
» Il envoyait, âme acharnée,
Prenant Moscou, prenant
Madrid,
Lutter contre la destinée
Tous les rêves de son
esprit.
» À chaque instant, rentrant en
lice,
Cet homme aux gigantesques
pas
Proposait quelque grand
caprice
À Dieu, qui n’y consentait
pas.
» Il n’était presque plus un
homme.
Il disait, grave et
rayonnant,
En regardant fixement Rome
C’est moi qui règne
maintenant !
» Il voulait, héros et symbole,
Pontife et roi, phare et
volcan,
Faire du Louvre un
Capitole
Et de Saint-Cloud un
Vatican.
» César, il eût dit à
Pompée :
« Sois fier d’être
mon lieutenant ! »
On voyait luire son épée
Au fond d’un nuage
tonnant.
» Il voulait, dans les frénésies
De ses vastes ambitions,
Faire devant ses
fantaisies
Agenouiller les nations,
» Ainsi qu’en une urne profonde,
Mêler races, langues,
esprits,
Répandre Paris sur le monde,
Enfermer le monde en
Paris !
» Comme Cyrus dans Babylone,
Il voulait sous sa large
main
Ne faire du monde qu’un
trône
Et qu’un peuple du genre
humain,
» Et bâtir, malgré les huées,
Un tel empire sous son
nom,
Que Jéhovah dans les nuées
Fût jaloux de
Napoléon ! »
VI
Enfin, mort triomphant, il vit sa
délivrance,
Et l’océan rendit son cercueil à la
France.
L’homme, depuis douze ans, sous le
dôme doré
Reposait, par l’exil et par la mort
sacré.
En paix ! — Quand on passait
près du monument sombre,
On se le figurait, couronne au front,
dans l’ombre,
Dans son manteau semé d’abeilles
d’or, muet,
Couché sous cette voûte où rien ne
remuait,
Lui, l’homme qui trouvait la terre
trop étroite,
Le sceptre en sa main gauche et
l’épée en sa droite,
À ses pieds son grand aigle ouvrant l’œil à
demi,
Et l’on disait : C’est là qu’est
César endormi !
Laissant dans la clarté marcher
l’immense ville,
Il dormait ; il dormait confiant
et tranquille.
VII
Une nuit, — c’est toujours la nuit dans le
tombeau, —
Il s’éveilla. Luisant comme un hideux
flambeau,
D’étranges visions emplissaient sa
paupière ;
Des rires éclataient sous son plafond
de pierre ;
Livide, il se dressa ; la vision
grandit ;
Ô terreur ! une voix qu’il
reconnut, lui dit :
—
Réveille-toi. Moscou, Waterloo, Sainte-Hélène,
L’exil, les rois geôliers,
l’Angleterre hautaine
Sur ton lit accoudée à ton dernier
moment,
Sire, cela n’est rien. Voici le
châtiment :
La
voix alors devint âpre, amère, stridente,
Comme le noir sarcasme et l’ironie
ardente ;
C’était le rire amer mordant un
demi-dieu.
—
Sire ! on t’a retiré de ton Panthéon bleu !
Sire ! on t’a descendu de ta
haute colonne !
Regarde. Des brigands, dont l’essaim
tourbillonne,
D’affreux bohémiens, des vainqueurs
de charnier
Te tiennent dans leurs mains et t’ont
fait prisonnier.
À ton orteil d’airain leur patte
infâme touche.
Ils t’ont pris. Tu mourus, comme un
astre se couche,
Napoléon le Grand, empereur ; tu
renais
Bonaparte, écuyer du cirque
Beauharnais.
Te voilà dans leurs rangs, on t’a,
l’on te harnache.
Ils t’appellent tout haut grand
homme, entre eux, ganache.
Ils traînent, sur Paris qui les voit
s’étaler,
Des sabres qu’au besoin ils sauraient
avaler.
Aux passants attroupés devant leur
habitacle,
Ils disent, entends-les : —
Empire à grand spectacle !
Le pape est engagé dans la
troupe ; c’est bien,
Nous avons mieux ; le czar en
est mais ce n’est rien,
Le czar n’est qu’un sergent, le pape
n’est qu’un bonze
Nous avons avec nous le bonhomme de
bronze !
Nous sommes les neveux du grand
Napoléon ! —
Et Fould, Magnan, Rouher, Parieu
caméléon,
Font rage. Ils vont montrant un sénat
d’automates.
Ils ont pris de la paille au fond des
casemates
Pour empailler ton aigle, ô vainqueur
d’Iéna !
Il est là, mort, gisant, lui qui si
haut plana,
Et du champ de bataille il tombe au
champ de foire.
Sire, de ton vieux trône ils
recousent la moire.
Ayant dévalisé la France au coin d’un
bois,
Ils ont à leurs haillons du sang,
comme tu vois,
Et dans son bénitier Sibour lave leur
linge.
Toi, lion, tu les suis ; leur
maître, c’est le singe.
Ton nom leur sert de lit, Napoléon
premier.
On voit sur Austerlitz un peu de leur
fumier.
Ta gloire est un gros vin dont leur
honte se grise.
Cartouche essaie et met ta redingote
grise
On quête des liards dans le petit
chapeau
Pour tapis sur la table ils ont mis
ton drapeau.
À cette table immonde où le grec
devient riche,
Avec le paysan on boit, on joue, on
triche ;
Tu te mêles, compère, à ce tripot
hardi,
Et ta main qui tenait l’étendard de
Lodi,
Cette main qui portait la foudre, ô
Bonaparte,
Aide à piper les dés et fait sauter
la carte.
Ils te forcent à boire avec eux, et
Carlier
Pousse amicalement d’un coude
familier
Votre majesté, sire, et Piétri dans
son antre
Vous tutoie, et Maupas vous tape sur
le ventre.
Faussaires, meurtriers, escrocs,
forbans, voleurs,
Ils savent qu’ils auront, comme toi,
des malheurs
Leur soif en attendant vide la coupe
pleine
À ta santé ; Poissy trinque avec
Sainte-Hélène.
Regarde ! bals, sabbats, fêtes
matin et soir.
La foule au bruit qu’ils font se
culbute pour voir ;
Debout sur le tréteau qu’assiège une
cohue
Qui rit, bâille, applaudit, tempête,
siffle, hue,
Entouré de pasquins agitant leur
grelot,
— Commencer par Homère et finir par
Callot !
Épopée ! épopée ! oh !
quel dernier chapitre ! —
Entre Troplong paillasse et
Chaix-d’Est-Ange pitre,
Devant cette baraque, abject et vil
bazar
Où Mandrin mal lavé se déguise en
César,
Riant, l’affreux bandit, dans sa
moustache épaisse,
Toi, spectre impérial, tu bats la grosse caisse ! —
L’horrible vision s’éteignit.
L’empereur,
Désespéré, poussa dans l’ombre un cri
d’horreur,
Baissant les yeux, dressant ses mains
épouvantées.
Les Victoires de marbre à la porte
sculptées,
Fantômes blancs debout hors du
sépulcre obscur,
Se faisaient du doigt signe, et,
s’appuyant au mur,
Écoutaient le titan pleurer dans les
ténèbres.
Et lui, cria : « Démon aux
visions funèbres,
Toi qui me suis partout, que jamais
je ne vois,
Qui donc es-tu ? — Je suis ton
crime », dit la voix.
La tombe alors s’emplit d’une lumière
étrange
Semblable à la clarté de Dieu quand
il se venge
Pareils aux mots que vit resplendir
Balthazar,
Deux mots dans l’ombre écrits
flamboyaient sur César ;
Bonaparte, tremblant comme un enfant
sans mère,
Leva sa face pâle et lut : —
DIX-HUIT BRUMAIRE !
25-30 novembre. Jersey.









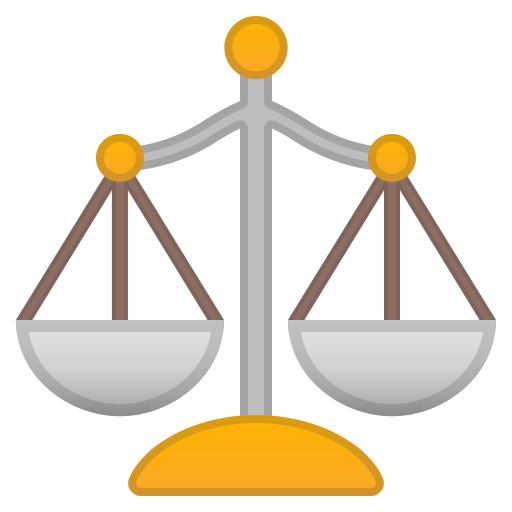















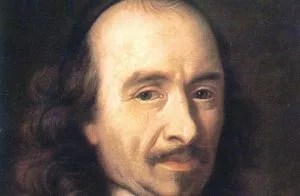






Adrian , vous qui êtes si érudit faite un quiz ou en littérature sur Chateaubriand , qui pour moi est le plus grand écrivain ,précurseur du romantisme et merci pour tous les bons moments passés en votre compagnie