L’Asie paraît être le continent du XXIe siècle. Dans Vers un nouvel ordre du monde, Gérard Chaliand et Michel Jan soulignent ainsi l’importance croissante que prennent les régions se situant à l’Est du Moyen-Orient où se concentrent près des deux tiers de l’humanité, en y incluant l’Inde. En Asie orientale, après le Japon dès les années 1950 ou la Corée du Sud et Taïwan dans les années 1990, la Chine semble désormais en mesure de rejoindre dans les décennies à venir le club des nations développées. De fait, elle est d’ores et déjà devenue la seconde économie mondiale en termes de produit intérieur brut (PIB) nominal.
Ces évolutions n’ont pas manqué de susciter l’admiration de certains observateurs. Comme le souligne l’économiste Joseph Stiglitz, durant le quarante années ayant suivi la Seconde Guerre mondiale, des pays tels que le Japon, la Corée du Sud, Taïwan ou Singapour ont connu les plus hauts taux de croissance du PIB jamais enregistrés sur une période aussi longue. Dès lors, on s’est interrogé sur les fondements des miracles économiques asiatiques ayant permis à des nations qui comptaient parmi les plus pauvres du monde en 1950 (à l’exception du Japon) d’être aujourd’hui au cœur de l’économie mondiale. D’autant plus qu’à bien des égards, elles ont suivi des voies différentes de celles des pays d’Europe ou d’Amérique du Nord, en se modernisant notamment sous des régimes autocratiques.
Le miracle économique japonais
Un conflit dévastateur
Le développement du Japon était le plus prévisible. Dès 1868, avec le début de l’ère Meiji, le pays avait en effet résolu de s’inspirer des méthodes occidentales afin de se développer et de résister à toute tentative de colonisation. Ce faisant, les Japonais s’étaient dotés d’un embryon d’industrie lourde, essentiellement mis au service du renforcement de leur potentiel militaire et naval, en particulier avant le début du conflit sino-japonais en 1937 et l’entrée en guerre contre les États-Unis en 1941.
Toutefois, à côté de ce secteur industriel peu développé en comparaison de celui des pays les plus modernes de l’époque et, de surcroît, très concentré autour de quelques grands groupes (les Zaibatsus), la majeure partie de la société japonaise restait traditionnelle voire archaïque. L’agriculture était, avant la Seconde Guerre mondiale, le secteur employant le plus d’actifs.
Surtout, au sortir de la guerre, en 1945, le Japon est un pays ravagé et dont la population a souffert des effets du conflit : bombardements massifs, blocus américain, très lourdes pertes des forces armées… Ayant perdu son empire, il n’a également plus d’accès direct à certaines ressources naturelles dont dépend sa reconstruction et qu’il est forcé d’importer. En termes de capital physique ou humain, le pays du soleil levant est également très loin de l’autre grand vaincu de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne, qui a certes subi des pertes humaines bien plus lourdes mais dont la population est aussi bien plus qualifiée.
Le facteur extérieur du développement économique japonais : le soutien américain
Dans un premier temps, le soutien américain à son ennemi d’hier s’avère crucial. En effet, devant la montée du communisme en Asie, concrétisée par la victoire de Mao Zedong en Chine 1949 et celle du Vietminh sur les Français en Indochine en 1954, les États-Unis entendent faire du Japon et de la Corée du Sud les vitrines de leur modèle économique dans la région. Outre leur soutien financier, ils facilitent ainsi les transferts de compétences entre les deux rives du Pacifique tout en encourageant des réformes économiques efficaces, telles que, au Japon, la libéralisation des activités et un meilleur partage de la propriété foncière.
De plus, les Américains ouvrent largement leur marché aux biens produits en Asie, alors que le Japon ou la Corée, eux, n’hésitent pas à protéger le leur, conformément aux préconisations de l’économiste allemand Friedrich List sur la défense nécessaire des « industries en enfance ». Pendant la guerre de Corée, entre 1950 et 1953, l’industrie japonaise bénéficie largement des commandes de l’armée américaine et joue un rôle capital dans leur approvisionnement.
Les États-Unis participent également à la stabilisation économique du Japon, par le biais d’un plan d’assainissement proposé par Joseph Dodge en 1949. Celui-ci prône notamment la mise en place d’un change fixe entre le yen et le dollar, une efficacité budgétaire accrue avec une baisse des dépenses et de l’intervention de l’État ou encore la maîtrise de l’inflation. Ces mesures permettent à l’économie japonaise de bénéficier d’une grande stabilité dans les décennies suivantes malgré un fort taux de croissance. Dans le même temps, la protection des forces armées américaines permet au gouvernement japonais de maintenir ses dépenses militaires à un niveau peu élevé, lui laissant davantage de ressources à affecter à des dépenses plus favorables à sa croissance.
Des politiques publiques efficaces au service d’une économie contrôlée
Toutefois, les politiques mises en œuvre par les gouvernements japonais successifs sont les principaux moteurs de la réussite spectaculaire du pays à partir des années 1950. S’appuyant sur une société stable, dotée d’un fort capital social, ils appliquent une stratégie volontariste d’appui aux exportations. Plutôt que de verrouiller leur économie afin de substituer les produits nationaux aux importations – politique alors mise en œuvre par les pays d’Amérique latine notamment – les dirigeants japonais préfèrent accorder des avantages fiscaux ou financiers aux entreprises se lançant à la conquête de marchés étrangers. Il s’agit ainsi d’un protectionnisme sélectif et, dans une certaine mesure, déguisé.
En même temps, l’État n’hésite pas à intervenir directement dans l’économie afin de créer des avantages compétitifs intéressants permettant à des secteurs porteurs de croissance et à forte valeur ajoutée de percer sur la scène internationale. Par ses politiques éducatives, le Japon forme rapidement une main d’œuvre qualifiée capable de rivaliser avec celle des pays occidentaux.
Le fameux MITI, le ministère de l’économie et de l’industrie, qui attire les meilleurs technocrates du pays, appuie et guide les entreprises dans leur développement, mettant en œuvre une véritable planification industrielle. Quant à la banque du Japon, elle régule étroitement l’activité des banques japonaises, en imposant notamment des quotas de croissance du crédit (window guidance) et en l’orientant vers les secteurs les plus prometteurs. De fait, jusqu’aux années 1960, l’investissement semble avoir contribué de manière nettement plus importante à la croissance que les exportations.
Un nom en particulier est attaché au miracle économique japonais de l’après-guerre, celui d’Hayato Ikeda, ministre des finances durant une partie des années 1950 et Premier ministre de 1960 à 1964. Il est considéré comme l’équivalent asiatique de Ludwig Erhard, père du Wirtschaftwunder allemand. Son action a toutefois été facilitée par l’action d’autres acteurs, comme les entreprises japonaises, qui mettent en place des systèmes de gestion novateurs et efficaces, accordant une large place à l’autonomie des travailleurs, à leur fidélité à la firme et à la décentralisation des unités de production. Ce phénomène est particulièrement saillant dans les Keiretsu, grands conglomérats héritiers des Zaibatsus d’avant-guerre. Les meilleurs exemples en sont Mitsubishi ou Mitsui.
Des résultats spectaculaires…jusqu’aux années 1990
Le Japon impressionne rapidement le monde. Sa reconstruction, dans la décennie de 1950, est rapidement achevée. Le niveau de vie de la population augmente sensiblement malgré un fort accroissement démographique, le pays passant de 72 millions à plus de 93 millions d’habitants en quinze ans après la Deuxième Guerre mondiale. Dans les années 1960, le Japon connaît une croissance encore plus élevée, atteignant parfois les 11 % par an. Ses produits commencent à s’exporter à travers le monde. Grâce à un investissement important dans l’éducation et la recherche, ils sont de plus en plus sophistiqués, permettant à l’économie japonaise de monter en gamme et de continuer à croître malgré la hausse des salaires de ses travailleurs.
Le miracle japonais se poursuit jusqu’aux années 1990. Durant la décennie précédente, le pays jouit encore d’une croissance économique bien plus forte que celle des pays d’Europe de l’Ouest ou d’Amérique du Nord, au point que de nombreux observateurs l’estiment capable de dépasser les États-Unis. Cependant, le modèle japonais s’essouffle à la fin des années 1980, du fait notamment d’une politique de change flottante, qui provoque une appréciation du yen et une baisse de la compétitivité du Japon. De plus en plus, sa croissance est due non à des gains de productivité mais à des investissements lourds dans l’immobilier, provoquant une bulle spéculative. Son éclatement en 1992 provoque une crise financière qui met en difficulté de nombreuses entreprises et banques et met fin à la période de haute croissance japonaise.
Depuis, le Japon connaît une expansion économique bien plus lente, malgré des politiques macroéconomiques – budgétaire et monétaire – souvent très offensives, à cause d’un bilan dégradé des entreprises japonaises dans les années 1990, d’un taux d’épargne élevé des japonais et du vieillissement de la population.
Pour autant, le pays reste l’un des plus innovants au monde. Selon l’OCDE, en 2011, il avait ainsi le nombre le plus élevé de brevets triadiques déposés par habitant à 107 contre environ 61 pour l’Allemagne ou 32,5 pour la France. De fait, dans les années 2000 et 2010, le constat d’un marasme économique japonais doit être nuancée : du fait d’un très faible accroissement démographique (la population s’est mise à baisser à partir de 2010), la croissance du PIB par habitant reste en réalité correcte tandis que le taux de chômage demeure peu élevé.
Les « miracles économiques » des dragons

Corée du sud, Taïwan, Hong Kong et Singapour suivent l’exemple japonais.
Les mauvaises conditions de départ des dragons asiatiques
Si le Japon était déjà relativement développé avant la Seconde Guerre mondiale, on ne peut guère en dire autant de la Corée du Sud, de Singapour ou encore de Taïwan. Ces régions font alors partie des plus pauvres du monde. Ainsi, en 1950, la Corée a un PIB par habitant inférieur à celui du Kenya ou du Ghana (Angus Maddison). De surcroît, elle est ravagée par une terrible guerre les années suivantes, jusqu’en 1953.
Contrairement au Japon, ces pays sont encore ruraux, et n’ont pas connu de développement industriel depuis le XIXe siècle. Ayant une faible population, la majorité étant constituée de paysans pauvres, Taïwan ou la Corée ne disposent pas d’un marché intérieur suffisant pour assurer leur développement de manière autonome. Le problème est encore plus aigu à Singapour, ville pauvre et peu peuplée qui se sépare en 1965 de la Malaisie à laquelle elle était rattachée.
Les nations d’Asie orientale ne manquent cependant pas d’atouts qui se révéleront rapidement décisifs. Leur ouverture à la mer, en particulier, est importante dans la mesure où le commerce international était et reste essentiellement maritime. Ce facteur les différencie ainsi de beaucoup de pays africains, enclavés. En outre, la relative homogénéité de beaucoup d’entre eux – Singapour se tourne toutefois très vite vers l’immigration pour combler les besoins de son marché du travail – leur permet d’éviter les conflits ethniques qui causeront tant de difficultés à d’autres nations du tiers-monde.
L’ouverture économique et la constitution de hubs régionaux
Les petites nations asiatiques n’ont guère d’autres choix que de s’ouvrir sur l’extérieur afin d’accéder à des marchés plus lucratifs, en se spécialisant dans certains secteurs à forte demande. Tirant parti des progrès du commerce maritime, stimulés par l’invention du container, Singapour devient rapidement un port majeur d’Asie du Sud-Est. Cette activité stratégique la dote de ressources qui sont efficacement réinvesties dans des domaines tels que l’éducation, l’enseignement supérieur et l’accumulation de capital physique. La cité-Etat, dirigée par Lee Kuan Yew (ministre de 1959 à 1990), est en outre réputée pour son climat des affaires particulièrement favorable aux entreprises, fait rare pour un régime autoritaire. Ainsi, à partir des années 1980, marquées par le début de la mondialisation et la libéralisation des flux de capitaux, Singapour n’a aucun mal à attirer des investissements étrangers.
La Corée du Sud connaît aussi une phase intense de développement à partir des années 1960 (« miracle sur le fleuve Han »). Le dictateur militaire Park Chung-Hee (1962 – 1979) en est l’instigateur majeur. Son gouvernement s’attache en effet à industrialiser le pays usant des recettes déjà mises en œuvre au Japon : soutien aux exportations, incitations à l’investissement productif, amélioration du capital humain et concentration industrielle autour de grands groupes, les chaebols. Dès les années 1960, le pays se dote ainsi d’une solide industrie métallurgique qui rivalise rapidement avec celle des pays européens ou d’Amérique du Nord. Par la suite, la Corée se spécialise dans d’autres domaines à haute valeur ajoutée comme la construction navale ou même l’industrie automobile.
Toutefois, les fruits de la forte croissance sud-coréenne, qui dépasse régulièrement les 10 % par an, restent inégalement répartis. Les campagnes, en particulier, sont loin d’en bénéficier autant que les villes, où se concentrent les grandes activités exportatrices. En effet, le gouvernement de Park Chung-Hee a fait le choix de se doter d’avantages comparatifs dans des domaines à forte valeur ajoutée, en élevant le niveau de compétence de la population, plutôt que de miser sur l’exportation de produits agricoles comme elle aurait dû le faire selon la théorie classique du commerce international (notamment énoncée par Adam Smith et David Riccardo, cette théorie repose sur l’idée que chaque nation dispose d’avantages comparatifs, c’est-à-dire de secteurs où la production est moins coûteuse. Smith propose une théorie des avantages absolus : chaque nation a intérêt à se spécialiser dans le domaine dans lequel les coûts sont inférieurs à celui de la concurrence étrangère. Riccardo estime que la théorie vaut également pour les avantages relatifs : chaque pays doit se concentrer sur la production qui est la moins chère chez elle, sans se soucier de la concurrence étrangère).
Dans les années 1970, Park comprend que délaisser les zones rurales pourraient affaiblir la cohésion sociale de la Corée du Sud. Il lance alors le mouvement des nouvelles communautés : Saemaul Undong. Il s’agit pour le gouvernement de soutenir les communautés villageoises en leur allouant des ressources tout en leur laissant une large autonomie dans leur utilisation, les citoyens étant considérés comme les plus à même d’identifier leurs propres besoins. Cependant, des évaluations doivent permettre par la suite d’identifier les collectivités les plus efficaces économiquement afin de leur accorder davantage de ressources. Le Saemaul Undong est un grand succès durant la décennie 1970 et il permet de mieux doter les campagnes coréennes d’infrastructures de base. En revanche, à partir des années 1980, il perd de sa pertinence au fur et à mesure que leurs besoins se complexifient.
Au cours des décennies ayant suivi la Deuxième Guerre mondiale, Hong Kong et Taïwan ont également connu de très forts taux de croissance. La première se développe sous l’autorité britannique à partir des années 1960, grâce à une spécialisation dans l’industrie textile qui lui permet de s’insérer sur les marchés mondiaux. La République de Chine, c’est-à-dire Taïwan, lance quant à elle un effort d’industrialisation soigneusement planifié par l’État et alimenté par une politique éducative extrêmement ambitieuse ainsi que de lourds investissements américains. Dès les années 1950, la croissance annuelle moyenne y dépasse ainsi les 9 %.
Des économies flexibles et capables de monter en gamme
C’est avant tout la durée de leur miracle économique qui caractérise les dragons asiatiques. En effet, l’un des principaux risques pour un pays en développement connaissant une forte croissance est celui de la « trappe à revenu intermédiaire » : de nombreux États se montrent incapables de changer de modèle de croissance après l’épuisement de celui qui leur a permis d’atteindre le groupe des économies à revenu intermédiaire. Dès lors, leur compétitivité est affectée par l’accroissement de leur taux de change réel du fait d’une augmentation des salaires et des prix dû aux gains de productivité de leur secteur exportateur (effet « Balassa-Samuelson ») et leur taux de croissance diminue. Le risque de tomber dans une telle trappe est encore plus grand en cas de crise financière. Cela a notamment été le cas de l’Amérique latine dans les années 1980 et de l’Asie du Sud-Est après la crise financière de 1997.
La Corée du Sud, Singapour, Hong Kong ou Taïwan ont pourtant su éviter ce piège et leur industrie est parvenue à monter progressivement en gamme au fur et à mesure qu’elle se modernisait. On le note, par exemple, dans le développement de la filière automobile sud-coréenne : désormais des constructeurs tels que Hyundai ou Kia produisent des voitures dont la qualité rivalise avec celles du reste du monde développé. Elles s’exportent donc aisément dans le reste du monde.
En outre, ces pays ont réussi à diversifier leur économie en investissant dans de nouveaux secteurs à haut potentiel. Ainsi, à partir des années 1970, Hong Kong devient une place financière majeure en Asie, suivie en cela par Singapour dans les années 1990, ce qui lui permet de se doter d’une activité intensive en capital humain. Surtout, les quatre dragons asiatiques négocient bien le tournant des nouvelles technologies dans les années 1990. Aujourd’hui, la Corée du Sud, qui consacre près de 4 % de son PIB à la recherche et au développement (R&D), est ainsi l’un des leaders mondiaux de la haute technologie avec des géants tels que Samsung ou LG Group.
La flexibilité des économies d’Asie de l’Est est largement due à la qualité de leur main d’œuvre, très qualifiée, parfaitement formée au fonctionnement des entreprises modernes et bénéficiant d’une forte exposition aux innovations techniques. Cet avantage s’explique par des politiques publiques volontaristes en faveur de l’éducation et de l’enseignement supérieur. Aussi n’est-il pas étonnant de voir qu’au début du XXIe siècle, Singapour, le Japon ou la Corée du Sud dominent largement le classement PISA évaluant les compétences des écoliers des pays développés. Si elles ne sont pas encore à la hauteur des établissements américains, les universités d’Asie orientale progressent néanmoins rapidement, en adoptant les meilleures pratiques identifiées à l’étranger en termes d’éducation aussi bien que de recherche scientifique.
Enfin, un certain nombre de caractéristiques, parfois difficiles à quantifier, ont également soutenu l’expansion à long terme des économies asiatiques : climat des affaires rassurant pour les investisseurs, capital social élevé avec une forte confiance entre concitoyens, intégrité et compétence des dirigeants du secteur public, patriotisme de la population… Singapour, plus spécifiquement, est réputée avoir l’une des fonctions publiques les plus efficaces au monde grâce à un système d’éducation performant, une politique intransigeante de lutte contre la corruption et des rémunérations attractives.
Une démocratisation réussie… sauf à Singapour
Les miracles économiques asiatiques, à l’exception du cas japonais, ont commencé sous des régimes autoritaires. Ce phénomène a interpellé les observateurs au point que des dirigeants politiques, dont Lee Kuan Yew lui-même, ont postulé l’existence de « valeurs asiatiques » spécifiques – comprenant notamment le respect de l’autorité, de l’ordre et du travail – distinctes de celles de l’Occident et ayant permis de créer un nouveau modèle de croissance. Pour autant, l’augmentation du niveau de vie des populations asiatiques a eu des conséquences politiques majeures.
La Corée du Sud en est l’exemple le plus marquant. Si Park Chung-Hee est assassiné en 1979, le pays reste toutefois sous la coupe d’un pouvoir militaire –légitimé par des élections étroitement contrôlées – durant la décennie suivante. Cet état de fait ne satisfait pas une population de plus en plus qualifiée et désireuse de prendre son destin en main. De manière symbolique, ce sont les étudiants coréens qui constituent le fer de lance de la contestation du régime militaire en organisant de nombreuses manifestations, souvent violemment réprimées. Ainsi, en mai 1980, une de ces manifestations finit par déclencher le massacre de Gwangju qui fait plusieurs centaines de victimes. Finalement, en 1987, suite à de nouvelles manifestations, le président Chun Doo-Hwan (1980 – 1988), lui-même militaire, lance un mouvement de démocratisation qui aboutit à la constitution de la sixième république coréenne. Le chef de l’État lui-même ne se représente pas aux élections de 1988. Depuis, toutes les difficultés n’ont pas disparu comme en atteste la destitution pour corruption de la présidente Park Geun-Hye (la fille du dictateur !) en 2017. Cet événement révèle toutefois la solidité de l’État de droit coréen.
La démocratisation de Taïwan se produit au même moment avec une libéralisation progressive du régime nationaliste dans les années 1980 qui accepte les partis d’opposition et l’organisation d’élections libres. Il faut toutefois attendre 2000 pour que le Kuomintang, qui dirigeait Taïwan depuis 1949, se retrouve dans l’opposition. Aujourd’hui, Taïwan apparaît comme une démocratie fonctionnelle et un État de droit favorable au développement économique et social.
Le réveil d’un géant : la croissance de l’économie chinoise
Les errements économiques du régime maoïste
La Chine n’a pu participer au premier essor économique de l’Asie orientale à partir des années 1950, du fait du régime communiste mis en place par Mao Zedong (qui dirige la Chine jusqu’à sa mort en 1976). Celui-ci, longtemps ostracisé par les États-Unis et leurs partenaires, n’a donc pu bénéficier de la même ouverture aux grands marchés d’Europe et d’Amérique du Nord que le Japon ou les dragons asiatiques.
En outre, le système économique communiste s’est montré peu performant, reposant sur un ensemble d’entreprises publiques directement financées par le ministère des finances et n’ayant ni les ressources ni la moindre incitation à innover ou à investir dans la productivité. Dans le domaine agricole, les tentatives de réformes planifiées depuis Pékin ont même abouti à de véritables catastrophes humaines comme cela a été le cas du « Grand Bond en avant » de 1958 à 1960.
En même temps, contrairement à certains de ses voisins, la Chine de Mao s’est peu intéressée au capital humain. Alors que les universités japonaises puis coréennes ont œuvré à la formation de dirigeants pouvant évoluer dans un univers capitaliste dominé par les normes et les savoirs américains, les établissements chinois préféraient former des techniciens, majoritairement ingénieurs, n’ayant guère de compétences en gestion. Aussi, les entreprises publiques chinoises étaient mal gérées, mal organisées et obéissaient à des normes juridiques et comptables peu rigoureuses. Dès lors, l’appareil industriel du pays n’était pas rationalisé ce qui affectait la qualité et le coût de la production. En outre, comme dans de nombreux États communistes, le secteur des biens de consommation avait été négligé au profit de l’industrie lourde.
Deng Xiaoping, instigateur du miracle économique
Lorsque Deng Xiaoping prend définitivement le pouvoir en 1978 après avoir écarté ses adversaires, il constate rapidement l’état d’arriération de l’économie chinoise par rapport à celle de l’Occident mais aussi, de plus en plus, à certains de ses voisins. Il en conclut que le rapprochement diplomatique avec les États-Unis, opéré dès l’époque de Mao, doit être complété par une ouverture économique de son pays afin d’attirer les investissements venus des pays développés mais aussi leurs savoirs et compétences.
Deng Xiaoping décide ainsi d’augmenter progressivement le niveau de concurrence des différents marchés chinois. Fer de lance de sa nouvelle politique, il crée des zones économiques spéciales ouvertes sur l’extérieur avec un régime fiscal et douanier très favorable aux entreprises étrangères. Les échanges avec Hong Kong, dont la rétrocession à la Chine n’aura lieu qu’en 1997 après la mort de Deng, permettent également de dynamiser l’économie nationale en la mettant en contact direct avec une cité ouverte sur le monde.
L’apprentissage du capitalisme…dans un cadre très étroitement contrôlé
Les années 1980 sont une période de développement économique rapide pour la Chine, mais elles entraînent aussi des frustrations concernant le faible degré de liberté accordé aux citoyens. De fait, Deng Xiaoping n’a aucune intention de déclencher le moindre mouvement de démocratisation de son pays, estimant que celui-ci peut suivre la voie suivie par Singapour, celle d’une croissance assurée par un régime autoritaire. Or, la libéralisation des prix (la Chine adoptant alors un système à deux prix, l’un déterminé par le marché et l’autre fixé par les autorités, qui rend possible des comportements spéculatifs) cause une inflation qui accroît le mécontentement d’une partie de la population. Les efforts du gouvernement pour la maîtriser échouent mais provoquent un ralentissement économique à la fin de la décennie 1980.
Tous ces facteurs peuvent expliquer les émeutes étudiantes de la place Tian’anmen en 1989, écrasées dans le sang par un pouvoir d’autant plus fébrile que l’Union soviétique est alors sur le point de s’effondrer. Plusieurs milliers de manifestants auraient péri dans la répression de cette révolte. Deng Xiaoping est désormais bien déterminé à poursuivre ses réformes économiques dans un cadre politique verrouillé par le parti communiste.
C’est cependant son successeur Jiang Zemin (président de 1993 à 2003) qui, dans les années 1990, met en œuvre les transformations les plus audacieuses pour insérer la Chine dans la mondialisation. Il n’hésite ainsi pas à faire appel à de grandes firmes américaines comme Goldman Sachs, Morgan Stanley ou McKinsey – toutes des symboles importants du capitalisme – pour organiser des privatisations et l’introduction en bourse de certaines entreprises publiques chinoises. Ainsi, la China National Petroleum Corporation est restructurée à la fin des années 1990 pour donner naissance à Petrochina, société cotée en bourse.
Surtout, la Chine s’ouvre de plus en plus aux investissements étrangers et au commerce international. Sa main d’œuvre qualifiée et peu coûteuse apparaît ainsi comme compétitive et attire de nombreuses entreprises occidentales qui y délocalisent une partie de leur appareil de production. Ce mouvement est bénéfique à plus d’un titre à l’économie chinoise : il créé des emplois, dote de nouvelles compétences les travailleurs chinois, permet des transferts de technologie aux sociétés nationales et alimente le trésor public du gouvernement lui donnant la possibilité d’investir massivement dans l’accumulation de capital et, de plus en plus dans les années 2000, dans la R&D.
La Chine réalise également de gros effort afin de disposer d’un système éducatif de qualité, en empruntant là encore de nombreux éléments à des modèles extérieurs. Ainsi, l’école de management de l’Université de Tsinghua doit son développement spectaculaire au soutien de prestigieux experts étrangers comme Henry Paulson, président de la banque d’investissement Goldman Sachs.
Dès le début de l’ère des réformes, la République populaire de Chine ne se contente pas d’accueillir des firmes étrangères, mais elle soutient directement le développement de ses propres entreprises. Malgré son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001, elle continue de protéger son marché par des barrières non tarifaires : règles juridiques strictes, système de contrôle des capitaux, dualité entre monnaies internationale (Renmibi) et interne ou encore sous-évaluation du yuan – ancré au dollar et évoluant dans une bande de variation étroite – jusque dans les années 2010. Des investissements peuvent aussi être interdits au nom de la « sécurité économique nationale ». Ce véritable protectionnisme n’est pas incompatible avec une véritable ouverture internationale, comme l’ont montré de nombreuses joint ventures entre sociétés chinoises et étrangères dans les années 1990. C’est cet équilibre entre exposition au monde et défense de l’industrie nationale qui est au fondement du miracle chinois.
En route vers la superpuissance économique
Dès les années 1990, l’émergence de la Chine comme géant économique mondial paraît assurée du fait de sa démographie. En effet, en 1995, sa population dépasse 1,2 milliards d’habitants contre 1,3 milliards aujourd’hui ce qui en fait le pays le plus peuplé de la planète. Toutefois jusqu’aux années 2000, son PIB par habitant restait faible. Or, en 2016, selon le Fonds monétaire international, il s’élevait à environ 15 000 dollars à parité de pouvoir d’achat ce qui plaçait la Chine dans la fourchette haute des pays à revenu intermédiaire. Cette progression est due à une remarquable expansion de son PIB entre 2000 et 2008 avec des taux de croissance annuels avoisinant régulièrement les 10 %. En conséquence, avec un PIB nominal de près de 12 000 milliards de dollars, la Chine est devenue la deuxième économie mondiale derrière les États-Unis. Or, selon la plupart des projections, elle pourrait se retrouver au premier rang planétaire avant 2050.
Le succès chinois repose surtout sur ses exportations de produits manufacturés et sur un surinvestissement massif dans les infrastructures, un modèle de croissance qui fait courir au pays le risque de tomber dans une trappe à revenu intermédiaire. Cependant, les dirigeants chinois semblent avoir compris ce danger et la République populaire entend désormais rééquilibrer son économie en l’orientant davantage vers l’innovation, via des dépenses de R&D qui dépassent désormais les 2 % du PIB, et vers la consommation intérieure.
En effet, du fait de l’absence d’un système de sécurité sociale comparable à ceux des pays européens, la population chinoise affiche un taux d’épargne très élevé, de l’ordre de 50%. Si ce comportement facilite le financement des investissements, il pénalise la consommation et oblige les entreprises nationales à obtenir des rendements importants à l’étranger grâce à leurs exportations, au moment même où le surinvestissement a conduit à dégrader le bilan de nombreuses banques du pays. L’un des défis auxquels doivent faire face le président Xi Jinping et son équipe est de mener à bien cette transition entre deux modèles de croissance, qui peut provoquer un certain ralentissement économique. De fait, en 2016, la croissance chinoise n’a pas dépassé 6,7%, son niveau le plus bas depuis un quart de siècle.
Preuve de sa volonté de poursuivre son ouverture et de rééquilibrer son modèle, la Chine a progressivement libéralisé son régime de change et laissé le renmibi s’apprécier, sans toutefois le faire flotter. Désormais, le FMI estime que la monnaie chinoise n’est plus sous-évaluée. Dans le même temps, dans l’arène diplomatique, Xi Jinping se fait désormais le principal défenseur de la mondialisation comme il l’a signalé en 2017 à Davos tout en critiquant la rhétorique nationaliste et protectionniste du président américain Donald Trump. Cette position n’illustre pas uniquement les ambitions nouvelles de la Chine mais aussi sa forte dépendance vis-à-vis des autres grandes économies mondiales.
Bibliographie
Dealing with China, Henry Paulson
Rethinking the east asian miracle, Joseph Stiglitz et Shahid Yusuf
Pour un commerce mondial plus juste, Joseph Stiglitz et Andrew Charlton
Postwar development of the Japanese economy, Shigeru Otsubo
Singapore: smart city, smart state, Kent Calder
Vers un nouvel ordre du monde, Gérard Chaliand et Michel Jan









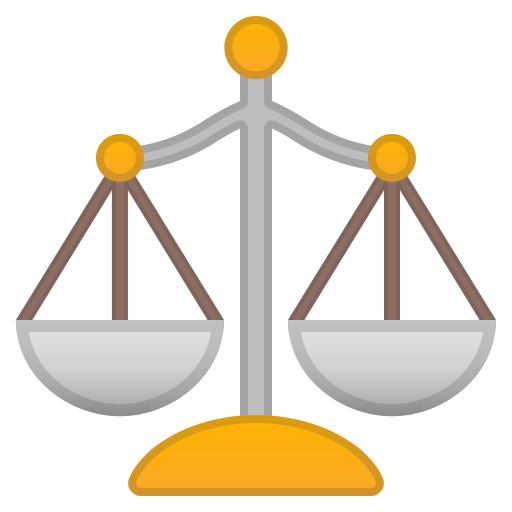























Laisser un commentaire