
⏳ Temps de lecture : 5 minutes
Il est un air pour qui je donnerais
Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber ;
Un air très-vieux, languissant et funèbre,
Qui pour moi seul a des charmes secrets.Or, chaque fois que je viens à l’entendre,
De deux cents ans mon âme rajeunit :
C’est sous Louis treize… et je crois voir s’étendre
Un coteau vert que le couchant jaunit,Puis un château de brique à coins de pierre,
Aux vitraux teints de rougeâtres couleurs,
Ceint de grands parcs, avec une rivière
Baignant ses pieds, qui coule entre des fleurs.Puis une dame, à sa haute fenêtre,
Blonde aux yeux noirs, en ses habits anciens…
Que, dans une autre existence peut-être,
J’ai déjà vue ! — et dont je me souviens !Odelettes, 1853
À lire en cliquant ici : une anthologie des poèmes de la langue française
Fantaisie de Nerval : essai d’analyse
Fantaisie est un poème romantique de Gérard de Nerval (1808 – 1855), dont le lyrisme, activé par la musique, donne naissance à une expérience quasi mystique.
Le titre du recueil, Odelettes rythmiques et lyriques, nous donne déjà un indice sur ce que le poète nous livre. L’odelette qu’il développe est une forme ramassée de l’ode, reprise à l’Antiquité par un poète qu’il a beaucoup étudié, Ronsard (1524 – 1585). L’ode, chantée ou accompagnée de musique, célèbre la valeur des héros ou porte les tourments du moi.
Ici, le rythme musical de l’odelette ouvre l’expérience lyrique, c’est-à-dire qu’elle permet une plongée dans le “moi” profond.
Fantaisie : une musique
Le poème de Nerval est une musique, un chant, un “air”, évoqué dès le premier vers de la première strophe. Le travail exigeant de la prosodie ne limite pas Fantaisie à une simple narration : il est lui-même l’objet qu’il décrit.
En effet, la versification du poème, quatre quatrains en décasyllabes, est construite selon une régularité propre à renforcer l’effet musical de la récitation. L’utilisation majoritaire de rimes riches (donn-e-r-ais / s-e-c-ets ou en-t-en-d-r-e / é-t-en-d-re, etc.), embrassées (ABBA) dans la première strophe, croisées dans les trois autres, ainsi que la prédilection pour les phonèmes en “r” et ceux en “è” travaillent à la création d’une mélodie entraînante. Le poète joue en outre :
- sur le
rythme du phrasé :
- deuxième vers : Tout Rossini (4 syllabes) / Tout Mozart (3 syllabes), tout Weber (2 syllabes, prononcer “Webre”) ;
- troisième vers : Un air très vieux / languissant/ et funèbre.
- Sur les répétitions :
- “air” au premier et troisième vers, “tout” au deuxième, “puis” au neuvième et au treizième.
Ces jeux sur la répétition donnent au poème un effet de scansion.
En même temps, le poème de Nerval est une fantaisie qui se permet quelques écarts, un “air” libre des codifications classiques. La fantaisie est, pour rappel, une pièce de musique libre, qui laisse place à l’imagination. Cette forme a notamment été pratiquée par deux compositeurs évoqués au deuxième vers, Rossini et Mozart.
Ainsi, comme évoqué plus haut, la disposition des rimes change au cours du poème : d’enjambées à la première strophe, elles deviennent croisées ensuite. Nerval utilise en outre l’enjambement, procédé romantique, peut-être inspiré par Victor Hugo, entre le premier et deuxième vers, entre le septième et le huitième et entre le onzième et le douzième. Ces trois enjambements fluidifient le poème : nous suivons une imagination à qui l’on a laissé libre cours, une fantaisie qui s’exprime selon sa propre loi.
L’air magique
Paradoxe, cette fantaisie ne laisse rien au hasard. Nerval insiste sur la musique, son pouvoir, en inaugurant son poème par une saillie hyperbolique : il donnerait, pour son air, “Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber”. La triple répétition de “tout” martèle la déclaration dans l’esprit du lecteur.
Cette proclamation, exorbitante, “vend”, en quelque sorte, le poème à son lecteur : celui-ci ne peut qu’être intrigué par cet “air” supérieur, pour l’ouïe du poète, aux œuvres de grands compositeurs, dont Rossini, le plus populaire du temps. Cet “air” fascine par son indétermination : c’est “un air”, mais pas n’importe quel air, un air gardé secret par le masque de son article indéfini.
Il se cache peut-être même un “charme“, comme le poète le révèle au quatrième vers, derrière cette introduction : la double scansion sur un rythme ternaire aux vers 2 et 3 ( “Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber” / “Un air très vieux, languissant et funèbre”) donne presque le sentiment qu’une formule magique est récitée au détriment du lecteur. Nerval l’envoûte en même temps qu’il est envoûté.
Le charme de cet “air” populaire séduit la veine romantique du temps : il offre évasion (dans le passé, “un air très vieux”), mélancolie (“languissant et funèbre”) et solitude (l’insistance “pour moi seul”), propres à l’expérience du moi. Par l’écoute de l’air, le poète s’écarte, dans un geste fascinant, des goûts communs de la société.
Les charmes de cet air sont aussi “secrets”. On sait le goût de Nerval pour l’occultisme.
La strophe terminée, la fantaisie est activée. Le poème s’ouvre à une nouvelle dimension : de la rythmique, on passe au lyrisme.
De la musique à l’intériorité
La deuxième strophe est donc une réorientation. Elle commence en effet par la conjonction “or”, placée brusquement, suivie d’une virgule : le récit prend une nouvelle direction. La musique était la porte d’entrée vers l’intériorité. Le sens dominant change : de l’ouïe on passe à la vue. L’air, antienne obsédante, qui se répète dans l’esprit du poète (“chaque fois”), laisse place progressivement à la vision intérieure : il “entend” au cinquième vers, il “voit” au septième. Signal ultime de ce déplacement : les rimes ne sont plus embrassées, mais croisées. La fantaisie revire.
Par le procédé magique de l’air, ses charmes secrets, l’âme du poète est rajeunie de deux cents ans. L’âme, certes, mais pas celle du Nerval du XIXe siècle. Ce n’est pas l’être contemporain qui est envoyé dans le passé. C’est une même âme, permanente, incarnée en plusieurs existences qui, ici, se ressouvient d’une de ses existences passées : un processus de réminiscence est-il à l’œuvre ?
Ce processus coûte au poète : comme confus, il ne donne qu’une description sommaire de ce qu’il voit, il n’est pas sûr de lui, incertitude soulignée par les points de suspension qui cassent le rythme de la narration, qui nous font imaginer un homme arrêté par une hésitation soudaine. Il dit “je crois voir s’étendre”, il n’est pas sûr de ce qu’il voit.
Ses souvenirs se reconstituent au fil de l’énonciation. Au moment d’hésitation succède un enjambement, qui matérialise le brusque retour du souvenir, comme s’il disait, après un moment d’hésitation “ah oui ! je me souviens”, et enchaînait rapidement.
Nerval pose alors le cadre de sa vision par une description verticale : il est un dans un rêve, un paysage romantique idéal, rapidement posé, sommaire, un coteau vert jauni par le couchant, couleurs chaudes de la douce mélancolie. La vision progresse rapidement sans se réorienter (“puis” libéré, contrairement à “or”, d’une virgule) et se fixe sur un cadre plus précis : c’est dans un château de style Louis XIII, dont les les couleurs (“brique”, “pierre”, des vitraux aux “rougeâtres couleurs”) s’entremêlent à celles du paysage. D’autres éléments renforcent le caractère idyllique du lieu : “de grands parcs” ; “une rivière”. Nous nous trouvons dans un château du Valois, région où Nerval a passé son enfance.
Le cadre posé, la fantaisie arrive au cœur de l’expérience qu’elle propose.
De la fantaisie au souvenir
Nul réveil à la dernière strophe, la fantaisie se déploie jusqu’au bout. La répétition de “puis” relance le mouvement de balancier.
Nerval introduit un personnage, une “dame”, pas une simple “femme”, probablement une noble, dans son château, lointaine à “sa haute fenêtre”.
Elle est “blonde aux yeux noirs“. Mais pourquoi un tel détail ? Il y a là un thème romantique, cher à Byron, à Gautier et Nerval. Nous soupçonnons que la fantaisie n’a rien d’innocent. Un dernier détail pittoresque (“habits anciens”) ouvre un nouveau moment d’hésitation et de réflexion du poète, un temps mort de la fantaisie, matérialisé par les points de suspension.
Il précède la révélation finale aux deux derniers vers. Cette fantaisie n’est pas le fruit d’une imagination libérée. C’est un ressouvenir, une réminiscence d’une âme de deux cents rajeunit, venu d’une “autre existence” de cette même âme.
L’avant-dernier vers, encore hésitant (“peut-être”), prépare l’enthousiasme final du dernier vers : “j’ai déjà vue !” – “et dont je me souviens !”. Le narrateur halète, crie presque, se précipite. Le charme de l’air lui fait vivre la métempsychose, la transmigration de son âme : il connaît cette femme, il s’en souvient, il l’a vue. N’est-elle pas cette mère qu’il a perdu à deux ans ? Cet air, “languissant et funèbre”, n’est-il pas une berceuse qui lui rappelle un monde perdu ?









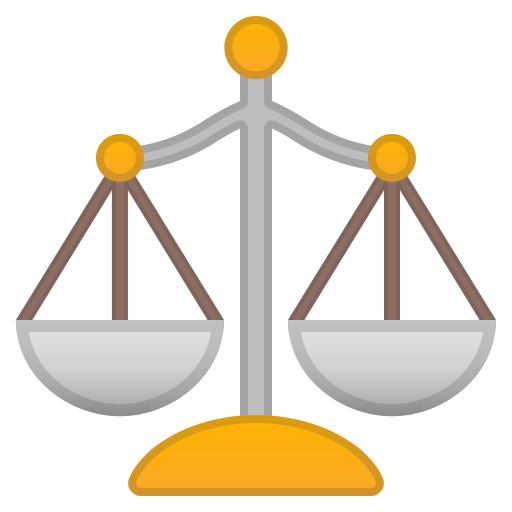









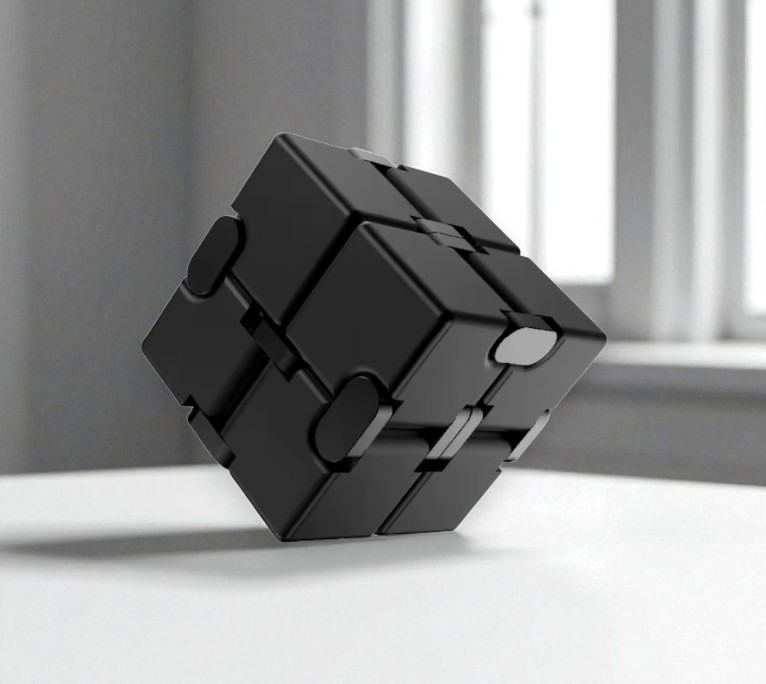

















Cela ne répond pas à ma question!!
oui je suis d accord