
⏳ Temps de lecture : 3 minutes

Ce siècle avait deux ans | Poème de Victor Hugo
Ce siècle avait deux ans ! Rome
remplaçait Sparte,
Déjà Napoléon perçait sous
Bonaparte,
Et du premier consul, déjà, par maint
endroit,
Le front de l’empereur brisait le
masque étroit.
Alors dans Besançon, vieille ville
espagnole,
Jeté comme la graine au gré de l’air
qui vole,
Naquit d’un sang breton et lorrain à
la fois
Un enfant sans couleur, sans regard
et sans voix ;
Si débile qu’il fut, ainsi qu’une
chimère,
Abandonné de tous, excepté de sa
mère,
Et que son cou ployé comme un frêle
roseau
Fit faire en même temps sa bière et
son berceau.
Cet enfant que la vie effaçait de son
livre,
Et qui n’avait pas même un lendemain
à vivre,
C’est moi. –
Je vous dirai peut-être quelque
jour
Quel lait pur, que de soins, que de
voeux, que d’amour,
Prodigués pour ma vie en naissant
condamnée,
M’ont fait deux fois l’enfant de ma
mère obstinée,
Ange qui sur trois fils attachés à
ses pas
Épandait son amour et ne mesurait pas
!
Ô l’amour d’une mère ! amour que nul
n’oublie !
Pain merveilleux qu’un dieu partage
et multiplie !
Table toujours servie au paternel
foyer !
Chacun en a sa part et tous l’ont
tout entier !
Je pourrai dire un jour, lorsque
la nuit douteuse
Fera parler les soirs ma vieillesse
conteuse,
Comment ce haut destin de gloire et
de terreur
Qui remuait le monde aux pas de
l’empereur,
Dans son souffle orageux m’emportant
sans défense,
A tous les vents de l’air fit flotter
mon enfance.
Car, lorsque l’aquilon bat ses flots
palpitants,
L’océan convulsif tourmente en même
temps
Le navire à trois ponts qui tonne
avec l’orage,
Et la feuille échappée aux arbres du
rivage !
Maintenant, jeune encore et
souvent éprouvé,
J’ai plus d’un souvenir profondément
gravé,
Et l’on peut distinguer bien des
choses passées
Dans ces plis de mon front que
creusent mes pensées.
Certes, plus d’un vieillard sans
flamme et sans cheveux,
Tombé de lassitude au bout de tous
ses voeux,
Pâlirait s’il voyait, comme un
gouffre dans l’onde,
Mon âme où ma pensée habite, comme un
monde,
Tout ce que j’ai souffert, tout ce
que j’ai tenté,
Tout ce qui m’a menti comme un fruit
avorté,
Mon plus beau temps passé sans espoir
qu’il renaisse,
Les amours, les travaux, les deuils
de ma jeunesse,
Et quoiqu’encore à l’âge où l’avenir
sourit,
Le livre de mon coeur à toute page
écrit !
Si parfois de mon sein s’envolent
mes pensées,
Mes chansons par le monde en lambeaux
dispersées ;
S’il me plaît de cacher l’amour et la
douleur
Dans le coin d’un roman ironique et
railleur ;
Si j’ébranle la scène avec ma
fantaisie,
Si j’entre-choque aux yeux d’une
foule choisie
D’autres hommes comme eux, vivant
tous à la fois
De mon souffle et parlant au peuple
avec ma voix ;
Si ma tête, fournaise où mon esprit
s’allume,
Jette le vers d’airain qui bouillonne
et qui fume
Dans le rythme profond, moule
mystérieux
D’où sort la strophe ouvrant ses
ailes dans les cieux ;
C’est que l’amour, la tombe, et la
gloire, et la vie,
L’onde qui fuit, par l’onde
incessamment suivie,
Tout souffle, tout rayon, ou propice
ou fatal,
Fait reluire et vibrer mon âme de
cristal,
Mon âme aux mille voix, que le Dieu
que j’adore
Mit au centre de tout comme un écho
sonore !
D’ailleurs j’ai purement passé les
jours mauvais,
Et je sais d’où je viens, si j’ignore
où je vais.
L’orage des partis avec son vent de
flamme
Sans en altérer l’onde a remué mon
âme.
Rien d’immonde en mon coeur, pas de
limon impur
Qui n’attendît qu’un vent pour en
troubler l’azur !
Après avoir chanté, j’écoute et je
contemple,
A l’empereur tombé dressant dans
l’ombre un temple,
Aimant la liberté pour ses fruits,
pour ses fleurs,
Le trône pour son droit, le roi pour
ses malheurs ;
Fidèle enfin au sang qu’ont versé
dans ma veine
Mon père vieux soldat, ma mère
vendéenne !
Les feuilles d’automne, 1831









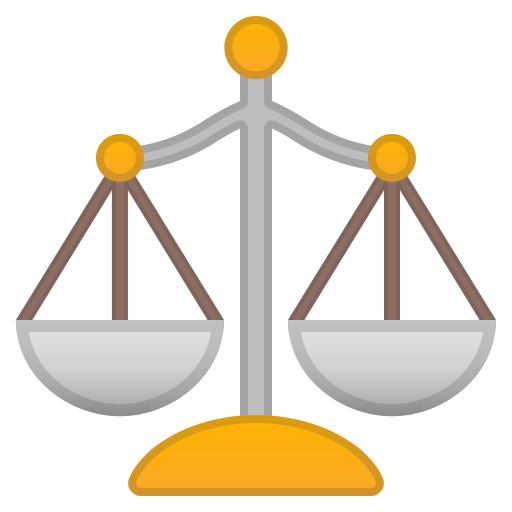









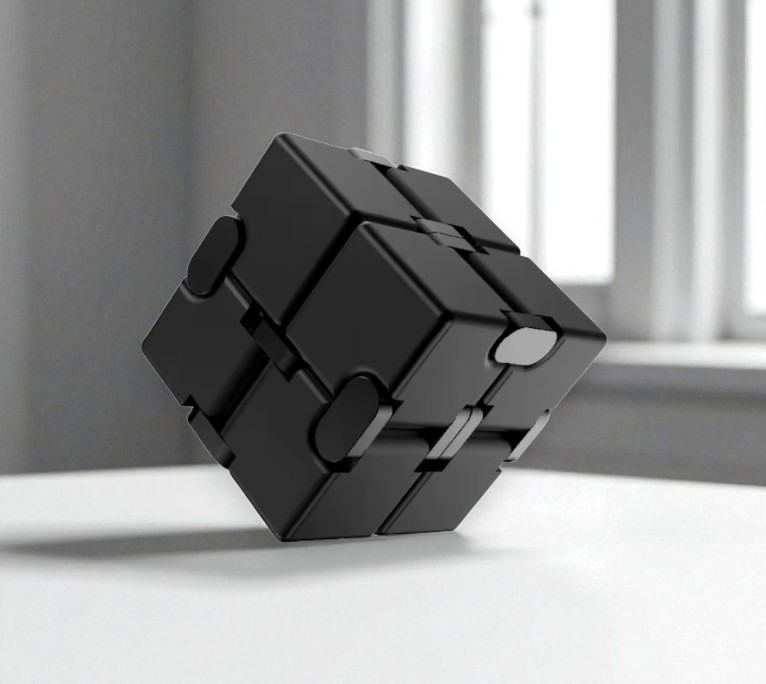

















Laisser un commentaire