
⏳ Temps de lecture : 9 minutes
Définition
le développement durable est aujourd’hui l’un des concepts les plus souvent mentionnés dans le débat public, non seulement en France mais, d’une manière générale, dans les pays développés. Défini en 1987 par le rapport Brundtland comme le développement qui répond aux exigences présentes sans hypothéquer le bien-être des générations futures, il a pris de plus en plus d’importance au cœur des politiques publiques actuelles. Pourtant, peu nombreux sont ceux qui pourraient le définir précisément, énoncer ses trois piliers écologique, social et économique ou expliquer en détails des actions visant à le concrétiser. Dès lors, il est nécessaire d’analyser la montée en puissance du développement durable en étudiant son histoire, tout en s’attachant à expliquer son rôle croissant dans l’élaboration de modèles économiques aussi bien que dans les politiques des États.
Le développement durable : une prise en compte tardive
La raréfaction des ressources naturelles
La soutenabilité de la croissance, durant la majeure partie du XXe siècle, ne tenait guère compte de certains éléments fondamentaux comme le capital naturel, l’environnement ou le bien-être des populations. L’analyse économique se fondait largement sur des indicateurs relevant largement de la production de valeur (marchande) comme le produit intérieur brut, la productivité des facteurs de productions ou encore l’emploi. Pourtant, à partir des années 1970, la question de la raréfaction des ressources naturelles commence à se poser. Alors que la croissance du PIB ralentit dans les pays développés du fait des chocs pétroliers, elle accélère dans les pays émergents, en Asie orientale notamment. Elle est toutefois très consommatrice de matières premières dont la quantité est limitée comme le pétrole ou le gaz mais aussi le charbon, bien que ses réserves soient abondantes.
Le rapport Meadows
Le rapport Halte à la croissance du club de Rome, publié en 1972, fait déjà un constat alarmant : alors que la population mondiale croît de manière exponentielle, les ressources alimentaires et en matières premières permettant d’assurant sa prospérité risquent de s’épuiser. Ce rapport raisonne largement en termes de quantité de ressources disponibles pour la croissance et n’aborde guère en détail la question de la dégradation de l’environnement. En outre, il adopte un point de vue pessimiste et estime que le progrès technique ne peut suffire à produire un développement économique moins intensif en ressources naturelles. Dès lors, seul l’arrêt de la croissance s’impose. Malgré ses limites, le rapport Meadows, du nom de deux de ses auteurs, revêt une importance capitale : pour la première fois, la question environnementale investit le débat public.
La découverte de la « tragédie des communs »
La théorie des biens publics
La réflexion sur le développement durable rejoint largement celle sur les biens publics mondiaux. La théorie des biens publics a notamment été élaborée par l’économiste Paul Samuelson à la fin des années 1940. Elle a depuis connu un succès croissant, tout en soulevant un certain nombre de problèmes économiques. Selon Samuelson, les biens publics ont pour caractéristiques d’être ni rivaux ni exclusifs : leur consommation par un agent n’empêche pas celle d’autres agents et il est impossible d’en empêcher l’usage. Certains de ces biens publics peuvent être impurs et n’avoir qu’une seule de ces caractéristiques. Ils ont en commun de bénéficier à tous sans que personne n’ait intérêt à les fournir d’un point de vue marchand.
Les biens publics sources d’externalités positives
Comme ils procurent de forts bénéfices sociaux, les biens publics sont en général sources d’externalités positives. Dès lors, ils justifient une intervention de l’État mais celle-ci ne s’applique pas à l’échelle mondiale. Seule une coordination des différents gouvernements peut alors, dans l’architecture globale actuelle, apporter des solutions adéquates. Quant à ces solutions, elles ont été exposées par plusieurs économistes renommés. Elles ne se limitent pas à la fourniture des biens publics par l’État lui-même, potentiellement financée par une taxe permettant d’internaliser les externalités selon le modèle prôné par Arthur Pigou.
La théorie des droits de propriété
Ainsi, Ronald Coase a élaboré une théorie originale pour les préserver, avec sa théorie des droits de propriété. Il s’agit d’accorder un droit de propriété à un élément, le plus souvent un bien public, générateur d’externalités. Il peut être donné à une rivière. Une entreprise qui voudrait installer une usine polluante et déverser ses déchets dans ce cours d’eau devrait payer une somme compensant la perte du bien public en question.
La nécessité d’une coordination mondiale pour le développement durable
Parmi les principaux biens publics mondiaux, on peut citer la stabilité financière, la santé, la connaissance et l’information et surtout l’environnement. En effet, un environnement sain profite à tous, dans tous les pays, mais aucun d’entre eux n’a intérêt à prendre en charge sa préservation individuellement car cela pénaliserait son économie. Dès lors, la coordination mondiale a rapidement été identifiée comme le moyen idéal de résoudre ce problème jugé essentiel. Le sommet de la terre de Rio en 1992 a ainsi inauguré une période de coopération croissante entre les États en matière de développement durable. Pour autant, chacun d’eux continue d’avoir un intérêt à se comporter en « passager clandestin » et à ne pas contribuer à l’effort en faveur de l’environnement, voire à saboter celui-ci.
Le développement durable : progrès limités & réticence des États
La prise en compte du réchauffement climatique
Dans les années 1990, la plupart des pays de la planète se sont concentrés sur leur croissance économique – celle-ci ayant considérablement accéléré dans les pays en voie de développement – négligeant par là même les impératifs de protection de l’environnement. À la fin de la décennie, ceux-ci ont toutefois resurgit à l’occasion des négociations ayant abouti au protocole de Kyoto au sujet du réchauffement climatique.
En effet, la communauté scientifique est alors de plus en plus convaincue que les gaz à effet de serre et en premier lieu le dioxyde de carbone contribuent à augmenter la température moyenne de l’atmosphère, un phénomène aux conséquences potentiellement dévastatrices. À terme, il accroîtrait en effet le risque de sécheresses mais aussi d’inondations tandis que la fonte des glaces et la montée du niveau des océans pourraient submerger certains pays proches des océans. Le réchauffement climatique pourrait aussi perturber l’agriculture dans de nombreuses régions du globe.
Malgré des débats assez vifs sur la réalité de ce phénomène et la responsabilité des activités humaines dans celui-ci, la communauté internationale s’empare de ce problème dès la fin des années 1990 avec les négociations sur le protocole de Kyoto.
Le mécanisme du protocole de Kyoto
Celui-ci met en place, conformément aux théories de Coase, un « marché du droit à polluer ». Le dispositif repose sur l’idée que le coût social de la pollution doit être payé par ceux qui en sont à l’origine. Plutôt qu’une taxe, c’est un mécanisme de marché qui a été choisi. Chaque pays dispose d’un droit limité à l’émission de dioxyde de carbone. Pour pouvoir dépasser son quota, il doit acheter des droits à un autre État, qui peut lui vendre si lui-même n’atteint pas son quota. Ce mécanisme doit également permettre de faciliter le développement des pays du Sud, ceux-ci étant financés par l’achat de droits à polluer par les nations les plus riches, qui sont alors, et de loin, les principaux pollueurs de la planète.
Les défaillances du protocole de Kyoto
Pour autant, l’accord de Kyoto illustre à merveille la difficulté à obtenir un véritable consensus sur le réchauffement climatique et les efforts à fournir pour protéger l’environnement. En effet, dès 1997, le Sénat américain refuse à l’unanimité de ratifier le protocole, empêchant sa mise en œuvre par les États-Unis alors le premier pollueur de la planète. Dans le même temps, certains autres pays bénéficient de conditions très favorables comme la Russie, qui ratifie l’accord en 2004, et se voit autoriser une part des émissions mondiales de gaz à effet de serre très supérieure à celle qu’elle émet en réalité, du fait de la prise en compte des chiffres datant de 1990, avant l’effondrement industriel du pays. Enfin, le prix de la tonne de carbone apparaît faible et n’incite guère la plupart des économies à diminuer leur consommation de cette matière polluante. Pire, ce prix baisse fortement à la suite de la crise économique de 2008. Si le protocole de Kyoto ouvre indiscutablement une ère de meilleure prise en compte de l’impératif de protection de l’environnement par les États, il reste nettement insuffisant au vu de l’ampleur du défi du réchauffement climatique.
Relance incertaine du développement durable : fin des années 2000
Le rapport Stern de 2006
Les années 2000 sont marquées par un phénomène économique majeur : le rattrapage sans précédent des pays développés par les pays émergents, ces derniers étant menés par la Chine avec des taux de croissance du PIB de 10% (pour lire un article complet sur le sujet, cliquez ici). Dans ces conditions, les nations en développement ne sont guère enclines à ralentir leur expansion économique en adoptant des objectifs environnementaux trop ambitieux.
La communauté scientifique est pourtant de plus en plus alarmiste. Le rapport Stern en 2006 estime ainsi que le réchauffement climatique pourrait coûter vingt points de PIB à l’économie mondiale à long terme. 60% des écosystèmes de la planète sont jugés dégradés et la moitié des fleuves mondiaux fortement pollués. L’augmentation de la population mondiale, s’il ralentit, accroît encore la pression sur des milieux naturels déjà sévèrement affectés par les activités humaines.
Des sommets peu convaincants
La crise de 2008-2009, bien qu’elle soit peu liée aux questions environnementales, fait pourtant resurgir ces dernières à travers le discrédit du modèle économique capitaliste et consumériste qui semblait jusqu’alors s’étendre à travers la planète.
Dans ces conditions, il n’est pas étonnant de constater que les sommets sur la protection de l’environnement se sont multipliés à partir de cette période, avec des résultats divers et souvent décevants. On peut ainsi évoquer l’accord de Copenhague de 2009 ou la conférence de Cancún en 2010 (COP 16). Si le premier évoque la nécessité de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius au cours du XXIe siècle et la mise en place d’un fonds vert de 100 milliards de dollars pour l’environnement, il ne pose aucune contrainte sur les États. En 2010, le sommet de Cancún réaffirme certaines des stipulations de l’accord précédent en leur donnant une plus grande portée mais il reste assez vague sur un certain nombre de sujet donc celui du fonds vert.
L’impossible consensus et la réticence des États à freiner leur croissance économique
Une “rivalité” entre pays développés et émergents
Souvent critiqué, le manque d’allant des gouvernements dans leur effort contre la dégradation de l’environnement est aisément compréhensible. À court terme au moins, cet effort peut en effet lourdement hypothéquer la croissance de leur PIB ce qui, dans de nombreux pays, peut avoir des conséquences sociales et politiques imprévisibles. Pour les nations émergentes, où la pauvreté, le manque de nourriture, le faible niveau d’éducation et l’espérance de vie trop basse restent des problèmes majeurs, la lutte contre le réchauffement climatique, l’épuisement des ressources ou la pollution n’apparaissent pas toujours comme une priorité. Selon leur gouvernement, du fait de leur pollution passée à l’époque de leur révolution industrielle, ce sont les pays développés qui ont une responsabilité particulière dans la situation actuelle. Leurs efforts doivent donc être supérieurs à leur contribution présente à la dégradation de l’environnement.
Des situations contrastées
Cet argument est mal accepté dans des pays affectés par la récession mondiale de 2009 et qui voient la montée en puissance des grands pays émergents – la Chine, l’Inde, le Brésil notamment – comme une menace géopolitique et économique de grande ampleur.
L’Union européenne fait pourtant figure de bonne élève dans la lutte contre le réchauffement climatique mais cela est en partie due à une désindustrialisation qui a par ailleurs un impact social sévère dans de nombreux États-membres. Dès lors, la transition énergétique se révèle difficile dans plusieurs de ces pays.
En Allemagne, par exemple, la décision d’abandonner l’énergie nucléaire après l’incident de Fukushima en 2011 entraîne un regain d’intérêt pour le charbon, combustible fossile nocif pour la santé et contribuant de manière importante an réchauffement climatique. La France pollue certes moins que l’Allemagne (en 2015, 500 millions de tonnes de CO² contre 960 millions de tonnes outre-Rhin), mais cela est dû d’une part à la plus faible industrialisation de ce pays, d’autre part à la forte part de l’énergie nucléaire dans le “mix énergétique” français, qui suscite un débat assez vif concernant la sécurité de ce type d’énergie.
Quant aux États-Unis, leur réticence à engager un effort de protection de l’environnement reste importante, d’autant que la concurrence croissante de la Chine inquiète fortement de nombreux industriels et hommes politiques Américains.
Quel avenir pour le développement durable ?
La COP 21 : un grand espoir pour le développement durable
En décembre 2015, la COP 21 de Paris paraît enfin relancer les efforts de luttes contre la dégradation de l’environnement. Au cours de cette conférence internationale, les différents États de la planète présentent leur engagement pour limiter le réchauffement climatique au cours du XXIe siècle. La Suisse s’engage ainsi la première à réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre (à partir du chiffre de 1990) avant 2030. Pour les États de l’UE pris ensemble, l’engagement monte même à 40% de réduction de ces émissions en 2030, là encore par rapport à leur niveau en 1990. Les pays émergents ne sont pas en reste. Fait significatif, la Chine elle-même se fixe des objectifs ambitieux avec une réduction de 60 à 65% de son intensité carbone par unité de PIB par rapport aux chiffres de 2005 en 2025. La COP 21 soulève alors un grand espoir dans les milieux scientifiques et écologistes, même si un certain scepticisme demeure quant à la volonté réelle des États de protéger l’environnement.
L’avenir incertain du développement durable
De fait, l’élection américaine de 2016, qui porte au pouvoir Donald Trump, proche des milieux climato-sceptiques, constitue un revers indiscutable pour les tenants du développement durable. Lorsqu’en 2017, celui-ci annonce le retrait de son pays de l’accord de Paris de 2015, cette décision est largement perçue comme une catastrophe pour la lutte contre le réchauffement climatique.
Par la suite, de nombreux États, au premier rang desquels la France, réaffirment leur engagement écologique. De nombreux scientifiques, mais aussi des membres de la société civile américaine, font de même. De plus en plus s’impose l’idée que le développement durable sera le grand combat du XXIe siècle et que celui-ci ne doit pas uniquement être mené par les États. Il reste que ceux-ci, par leur pouvoir de régulation et l’impact de leurs politiques économiques, demeurent des acteurs incontournables de la protection de l’environnement. Or, les politiques à caractère écologique peuvent entrer en contradiction avec d’autres objectifs de ces États.
Dès lors, la mise en œuvre du développement durable demeure incertaine à l’avenir et, en tout état de cause, elle devra s’appuyer sur de réels progrès techniques afin de ne plus apparaître comme un effort coûteux mais, au contraire, comme une opportunité économique.









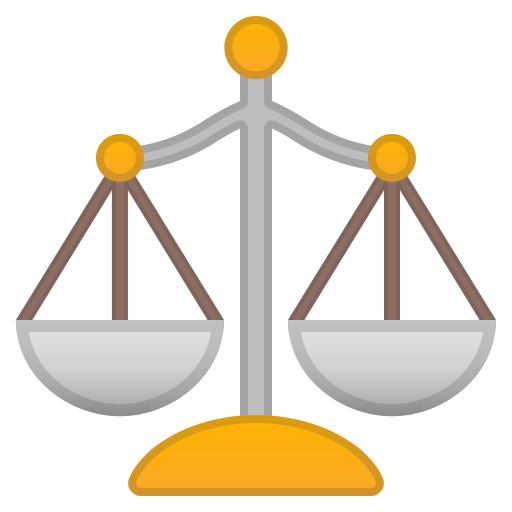









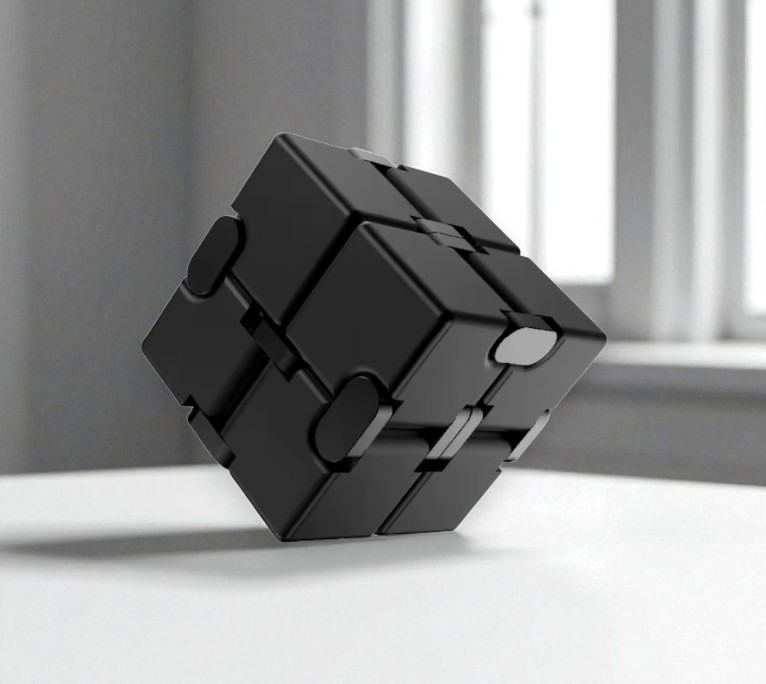















Laisser un commentaire