
La nuit de mai | Poème d’Alfred de Musset
La muse
Poète, prends ton luth et me donne
un baiser ;
La fleur de l’églantier sent ses
bourgeons éclore,
Le printemps naît ce soir ; les vents
vont s’embraser ;
Et la bergeronnette, en attendant
l’aurore,
Aux premiers buissons verts commence
à se poser.
Poète, prends ton luth, et me donne
un baiser.
Le poète
Comme il fait noir dans la vallée
!
J’ai cru qu’une forme
voilée
Flottait là-bas sur la
forêt.
Elle sortait de la prairie
;
Son pied rasait l’herbe fleurie
;
C’est une étrange rêverie
;
Elle s’efface et
disparaît.
La muse
Poète, prends ton luth ; la nuit,
sur la pelouse,
Balance le zéphyr dans son voile
odorant.
La rose, vierge encor, se referme
jalouse
Sur le frelon nacré qu’elle enivre en
mourant.
Écoute ! tout se tait ; songe à ta
bien-aimée.
Ce soir, sous les tilleuls, à la
sombre ramée
Le rayon du couchant laisse un adieu
plus doux.
Ce soir, tout va fleurir :
l’immortelle nature
Se remplit de parfums, d’amour et de
murmure,
Comme le lit joyeux de deux jeunes
époux.
Le poète
Pourquoi mon coeur bat-il si vite
?
Qu’ai-je donc en moi qui
s’agite
Dont je me sens épouvanté
?
Ne frappe-t-on pas à ma porte
?
Pourquoi ma lampe à demi
morte
M’éblouit-elle de clarté
?
Dieu puissant ! tout mon corps
frissonne.
Qui vient ? qui m’appelle ? –
Personne.
Je suis seul ; c’est l’heure qui
sonne ;
Ô solitude ! ô pauvreté !
La muse
Poète, prends ton luth ; le vin de
la jeunesse
Fermente cette nuit dans les veines
de Dieu.
Mon sein est inquiet ; la volupté
l’oppresse,
Et les vents altérés m’ont mis la
lèvre en feu.
Ô paresseux enfant ! regarde, je suis
belle.
Notre premier baiser, ne t’en
souviens-tu pas,
Quand je te vis si pâle au toucher de
mon aile,
Et que, les yeux en pleurs, tu tombas
dans mes bras ?
Ah ! je t’ai consolé d’une amère
souffrance !
Hélas ! bien jeune encor, tu te
mourais d’amour.
Console-moi ce soir, je me meurs
d’espérance ;
J’ai besoin de prier pour vivre
jusqu’au jour.
Le poète
Est-ce toi dont la voix
m’appelle,
Ô ma pauvre Muse ! est-ce toi
?
Ô ma fleur ! ô mon immortelle
!
Seul être pudique et
fidèle
Où vive encor l’amour de moi
!
Oui, te voilà, c’est toi, ma
blonde,
C’est toi, ma maîtresse et ma soeur
!
Et je sens, dans la nuit
profonde,
De ta robe d’or qui
m’inonde
Les rayons glisser dans mon
coeur.
La muse
Poète, prends ton luth ; c’est
moi, ton immortelle,
Qui t’ai vu cette nuit triste et
silencieux,
Et qui, comme un oiseau que sa couvée
appelle,
Pour pleurer avec toi descends du
haut des cieux.
Viens, tu souffres, ami. Quelque
ennui solitaire
Te ronge, quelque chose a gémi dans
ton coeur ;
Quelque amour t’est venu, comme on en
voit sur terre,
Une ombre de plaisir, un semblant de
bonheur.
Viens, chantons devant Dieu ;
chantons dans tes pensées,
Dans tes plaisirs perdus, dans tes
peines passées ;
Partons, dans un baiser, pour un
monde inconnu,
Éveillons au hasard les échos de ta
vie,
Parlons-nous de bonheur, de gloire et
de folie,
Et que ce soit un rêve, et le premier
venu.
Inventons quelque part des lieux où
l’on oublie ;
Partons, nous sommes seuls, l’univers
est à nous.
Voici la verte Écosse et la brune
Italie,
Et la Grèce, ma mère, où le miel est
si doux,
Argos, et Ptéléon, ville des
hécatombes,
Et Messa la divine, agréable aux
colombes,
Et le front chevelu du Pélion
changeant ;
Et le bleu Titarèse, et le golfe
d’argent
Qui montre dans ses eaux, où le cygne
se mire,
La blanche Oloossone à la blanche
Camyre.
Dis-moi, quel songe d’or nos chants
vont-ils bercer ?
D’où vont venir les pleurs que nous
allons verser ?
Ce matin, quand le jour a frappé ta
paupière,
Quel séraphin pensif, courbé sur ton
chevet,
Secouait des lilas dans sa robe
légère,
Et te contait tout bas les amours
qu’il rêvait ?
Chanterons-nous l’espoir, la
tristesse ou la joie ?
Tremperons-nous de sang les
bataillons d’acier ?
Suspendrons-nous l’amant sur
l’échelle de soie ?
Jetterons-nous au vent l’écume du
coursier ?
Dirons-nous quelle main, dans les
lampes sans nombre
De la maison céleste, allume nuit et
jour
L’huile sainte de vie et d’éternel
amour ?
Crierons-nous à Tarquin : ” Il est
temps, voici l’ombre ! ”
Descendrons-nous cueillir la perle au
fond des mers ?
Mènerons-nous la chèvre aux ébéniers
amers ?
Montrerons-nous le ciel à la
Mélancolie ?
Suivrons-nous le chasseur sur les
monts escarpés ?
La biche le regarde ; elle pleure et
supplie ;
Sa bruyère l’attend ; ses faons sont
nouveau-nés ;
Il se baisse, il l’égorge, il jette à
la curée
Sur les chiens en sueur son coeur
encor vivant.
Peindrons-nous une vierge à la joue
empourprée,
S’en allant à la messe, un page la
suivant,
Et d’un regard distrait, à côté de sa
mère,
Sur sa lèvre entr’ouverte oubliant sa
prière ?
Elle écoute en tremblant, dans l’écho
du pilier,
Résonner l’éperon d’un hardi
cavalier.
Dirons-nous aux héros des vieux temps
de la France
De monter tout armés aux créneaux de
leurs tours,
Et de ressusciter la naïve
romance
Que leur gloire oubliée apprit aux
troubadours ?
Vêtirons-nous de blanc une molle
élégie ?
L’homme de Waterloo nous dira-t-il sa
vie,
Et ce qu’il a fauché du troupeau des
humains
Avant que l’envoyé de la nuit
éternelle
Vînt sur son tertre vert l’abattre
d’un coup d’aile,
Et sur son coeur de fer lui croiser
les deux mains ?
Clouerons-nous au poteau d’une satire
altière
Le nom sept fois vendu d’un pâle
pamphlétaire,
Qui, poussé par la faim, du fond de
son oubli,
S’en vient, tout grelottant d’envie
et d’impuissance,
Sur le front du génie insulter
l’espérance,
Et mordre le laurier que son souffle
a sali ?
Prends ton luth ! prends ton luth !
je ne peux plus me taire ;
Mon aile me soulève au souffle du
printemps.
Le vent va m’emporter ; je vais
quitter la terre.
Une larme de toi ! Dieu m’écoute ; il
est temps.
Le poète
S’il ne te faut, ma soeur
chérie,
Qu’un baiser d’une lèvre
amie
Et qu’une larme de mes
yeux,
Je te les donnerai sans peine
;
De nos amours qu’il te
souvienne,
Si tu remontes dans les
cieux.
Je ne chante ni
l’espérance,
Ni la gloire, ni le
bonheur,
Hélas ! pas même la
souffrance.
La bouche garde le
silence
Pour écouter parler le
coeur.
La muse
Crois-tu donc que je sois comme le
vent d’automne,
Qui se nourrit de pleurs jusque sur
un tombeau,
Et pour qui la douleur n’est qu’une
goutte d’eau ?
Ô poète ! un baiser, c’est moi qui te
le donne.
L’herbe que je voulais arracher de ce
lieu,
C’est ton oisiveté ; ta douleur est à
Dieu.
Quel que soit le souci que ta
jeunesse endure,
Laisse-la s’élargir, cette sainte
blessure
Que les noirs séraphins t’ont faite
au fond du coeur :
Rien ne nous rend si grands qu’une
grande douleur.
Mais, pour en être atteint, ne crois
pas, ô poète,
Que ta voix ici-bas doive rester
muette.
Les plus désespérés sont les chants
les plus beaux,
Et j’en sais d’immortels qui sont de
purs sanglots.
Lorsque le pélican, lassé d’un long
voyage,
Dans les brouillards du soir retourne
à ses roseaux,
Ses petits affamés courent sur le
rivage
En le voyant au loin s’abattre sur
les eaux.
Déjà, croyant saisir et partager leur
proie,
Ils courent à leur père avec des cris
de joie
En secouant leurs becs sur leurs
goitres hideux.
Lui, gagnant à pas lents une roche
élevée,
De son aile pendante abritant sa
couvée,
Pêcheur mélancolique, il regarde les
cieux.
Le sang coule à longs flots de sa
poitrine ouverte ;
En vain il a des mers fouillé la
profondeur ;
L’Océan était vide et la plage
déserte ;
Pour toute nourriture il apporte son
coeur.
Sombre et silencieux, étendu sur la
pierre
Partageant à ses fils ses entrailles
de père,
Dans son amour sublime il berce sa
douleur,
Et, regardant couler sa sanglante
mamelle,
Sur son festin de mort il s’affaisse
et chancelle,
Ivre de volupté, de tendresse et
d’horreur.
Mais parfois, au milieu du divin
sacrifice,
Fatigué de mourir dans un trop long
supplice,
Il craint que ses enfants ne le
laissent vivant ;
Alors il se soulève, ouvre son aile
au vent,
Et, se frappant le coeur avec un cri
sauvage,
Il pousse dans la nuit un si funèbre
adieu,
Que les oiseaux des mers désertent le
rivage,
Et que le voyageur attardé sur la
plage,
Sentant passer la mort, se recommande
à Dieu.
Poète, c’est ainsi que font les
grands poètes.
Ils laissent s’égayer ceux qui vivent
un temps ;
Mais les festins humains qu’ils
servent à leurs fêtes
Ressemblent la plupart à ceux des
pélicans.
Quand ils parlent ainsi d’espérances
trompées,
De tristesse et d’oubli, d’amour et
de malheur,
Ce n’est pas un concert à dilater le
coeur.
Leurs déclamations sont comme des
épées :
Elles tracent dans l’air un cercle
éblouissant,
Mais il y pend toujours quelque
goutte de sang.
Le poète
Ô Muse ! spectre
insatiable,
Ne m’en demande pas si
long.
L’homme n’écrit rien sur le
sable
À l’heure où passe
l’aquilon.
J’ai vu le temps où ma
jeunesse
Sur mes lèvres était sans
cesse
Prête à chanter comme un oiseau
;
Mais j’ai souffert un dur
martyre,
Et le moins que j’en pourrais
dire,
Si je l’essayais sur ma
lyre,
La briserait comme un
roseau.
Les nuits










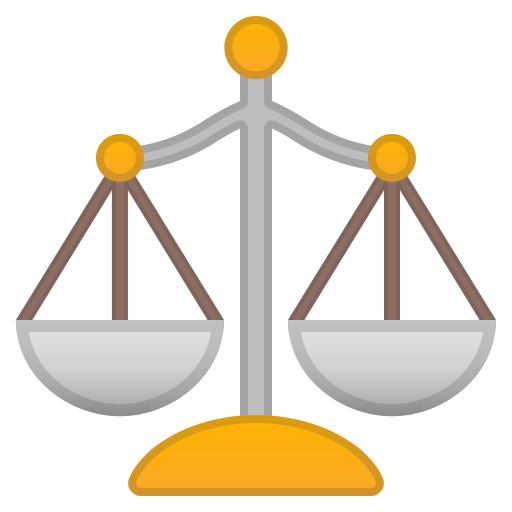























Laisser un commentaire