
Les embarras de Paris | Poème de Nicolas Boileau
Qui frappe l’air, bon Dieu ! de
ces lugubres cris ?
Est-ce donc pour veiller qu’on se
couche à Paris ?
Et quel fâcheux démon, durant les
nuits entières,
Rassemble ici les chats de toutes les
gouttières ?
J’ai beau sauter du lit, plein de
trouble et d’effroi,
Je pense qu’avec eux tout l’enfer est
chez moi :
L’un miaule en grondant comme un
tigre en furie ;
L’autre roule sa voix comme un enfant
qui crie.
Ce n’est pas tout encor : les souris
et les rats
Semblent, pour m’éveiller, s’entendre
avec les chats,
Plus importuns pour moi, durant la
nuit obscure,
Que jamais, en plein jour, ne fut
l’abbé de Pure.
Tout conspire à la fois à troubler
mon repos,
Et je me plains ici du moindre de mes
maux :
Car à peine les coqs, commençant leur
ramage,
Auront des cris aigus frappé le
voisinage
Qu’un affreux serrurier, laborieux
Vulcain,
Qu’éveillera bientôt l’ardente soif
du gain,
Avec un fer maudit, qu’à grand bruit
il apprête,
De cent coups de marteau me va fendre
la tête.
J’entends déjà partout les charrettes
courir,
Les maçons travailler, les boutiques
s’ouvrir :
Tandis que dans les airs mille
cloches émues
D’un funèbre concert font retentir
les nues ;
Et, se mêlant au bruit de la grêle et
des vents,
Pour honorer les morts font mourir
les vivants.
Encor je bénirais la bonté
souveraine,
Si le ciel à ces maux avait borné ma
peine ;
Mais si, seul en mon lit, je peste
avec raison,
C’est encor pis vingt fois en
quittant la maison ;
En quelque endroit que j’aille, il
faut fendre la presse
D’un peuple d’importuns qui
fourmillent sans cesse.
L’un me heurte d’un ais dont je suis
tout froissé ;
Je vois d’un autre coup mon chapeau
renversé.
Là, d’un enterrement la funèbre
ordonnance
D’un pas lugubre et lent vers
l’église s’avance ;
Et plus loin des laquais l’un l’autre
s’agaçants,
Font aboyer les chiens et jurer les
passants.
Des paveurs en ce lieu me bouchent le
passage ;
Là, je trouve une croix de funeste
présage,
Et des couvreurs grimpés au toit
d’une maison
En font pleuvoir l’ardoise et la
tuile à foison.
Là, sur une charrette une poutre
branlante
Vient menaçant de loin la foule
qu’elle augmente ;
Six chevaux attelés à ce fardeau
pesant
Ont peine à l’émouvoir sur le pavé
glissant.
D’un carrosse en tournant il accroche
une roue,
Et du choc le renverse en un grand
tas de boue :
Quand un autre à l’instant
s’efforçant de passer,
Dans le même embarras se vient
embarrasser.
Vingt carrosses bientôt arrivant à la
file
Y sont en moins de rien suivis de
plus de mille ;
Et, pour surcroît de maux, un sort
malencontreux
Conduit en cet endroit un grand
troupeau de boeufs ;
Chacun prétend passer ; l’un mugit,
l’autre jure.
Des mulets en sonnant augmentent le
murmure.
Aussitôt cent chevaux dans la foule
appelés
De l’embarras qui croit ferment les
défilés,
Et partout les passants, enchaînant
les brigades,
Au milieu de la paix font voir les
barricades.
On n’entend que des cris poussés
confusément :
Dieu, pour s’y faire ouïr, tonnerait
vainement.
Moi donc, qui dois souvent en certain
lieu me rendre,
Le jour déjà baissant, et qui suis
las d’attendre,
Ne sachant plus tantôt à quel saint
me vouer,
Je me mets au hasard de me faire
rouer.
Je saute vingt ruisseaux, j’esquive,
je me pousse ;
Guénaud sur son cheval en passant
m’éclabousse,
Et, n’osant plus paraître en l’état
où je suis,
Sans songer où je vais, je me sauve
où je puis.
Tandis que dans un coin en
grondant je m’essuie,
Souvent, pour m’achever, il survient
une pluie :
On dirait que le ciel, qui se fond
tout en eau,
Veuille inonder ces lieux d’un déluge
nouveau.
Pour traverser la rue, au milieu de
l’orage,
Un ais sur deux pavés forme un étroit
passage ;
Le plus hardi laquais n’y marche
qu’en tremblant :
Il faut pourtant passer sur ce pont
chancelant ;
Et les nombreux torrents qui tombent
des gouttières,
Grossissant les ruisseaux, en ont
fait des rivières.
J’y passe en trébuchant ; mais malgré
l’embarras,
La frayeur de la nuit précipite mes
pas.
Car, sitôt que du soir les ombres
pacifiques
D’un double cadenas font fermer les
boutiques ;
Que, retiré chez lui, le paisible
marchand
Va revoir ses billets et compter son
argent ;
Que dans le Marché-Neuf tout est
calme et tranquille,
Les voleurs à l’instant s’emparent de
la ville.
Le bois le plus funeste et le moins
fréquenté
Est, au prix de Paris, un lieu de
sûreté.
Malheur donc à celui qu’une affaire
imprévue
Engage un peu trop tard au détour
d’une rue !
Bientôt quatre bandits lui serrent
les côtés :
La bourse ! … Il faut se rendre ; ou
bien non, résistez,
Afin que votre mort, de tragique
mémoire,
Des massacres fameux aille grossir
l’histoire.
Pour moi, fermant ma porte et cédant
au sommeil,
Tous les jours je me couche avecque
le soleil ;
Mais en ma chambre à peine ai-je
éteint la lumière,
Qu’il ne m’est plus permis de fermer
la paupière.
Des filous effrontés, d’un coup de
pistolet,
Ébranlent ma fenêtre et percent mon
volet ;
J’entends crier partout: Au meurtre !
On m’assassine !
Ou : Le feu vient de prendre à la
maison voisine !
Tremblant et demi-mort, je me lève à
ce bruit,
Et souvent sans pourpoint je cours
toute la nuit.
Car le feu, dont la flamme en ondes
se déploie,
Fait de notre quartier une seconde
Troie,
Où maint Grec affamé, maint avide
Argien,
Au travers des charbons va piller le
Troyen.
Enfin sous mille crocs la maison
abîmée
Entraîne aussi le feu qui se perd en
fumée.
Je me retire donc, encor pâle
d’effroi ;
Mais le jour est venu quand je rentre
chez moi.
Je fais pour reposer un effort
inutile :
Ce n’est qu’à prix d’argent qu’on
dort en cette ville.
Il faudrait, dans l’enclos d’un vaste
logement,
Avoir loin de la rue un autre
appartement.
Paris est pour un riche un pays de
Cocagne :
Sans sortir de la ville, il trouve la
campagne ;
Il peut dans son jardin, tout peuplé
d’arbres verts,
Recéler le printemps au milieu des
hivers ;
Et, foulant le parfum de ses plantes
fleuries,
Aller entretenir ses douces
rêveries.
Mais moi, grâce au destin, qui
n’ai ni feu ni lieu,
Je me loge où je puis et comme il
plaît à Dieu.
Les Satires, VI, 1666










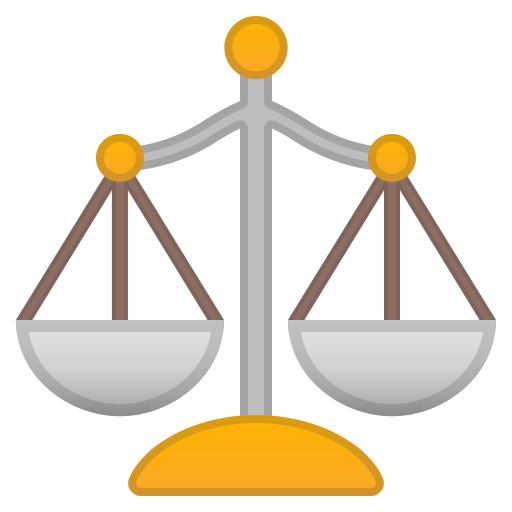























Laisser un commentaire