
⏳ Temps de lecture : 9 minutes
Qu’est-ce que la loi Falloux ?
Un peu plus d’un an après la proclamation de la République (24 février 1848), les élections législatives du 13 mai 1849, au suffrage universel direct masculin, révèlent une France polarisée. D’un côté les “blancs”, le “parti de l’Ordre », conservateur, rafle 53% des suffrages et 450 députés sur 750, et de l’autre les “rouges”, “la Montagne », une gauche républicaine qui obtient 35% des voix et 210 députés. Allié au clergé, le parti de l’Ordre victorieux, dont les objectifs sont résumés dans la devise “Ordre, propriété, religion », veut calmer la peur d’une bourgeoisie effrayée par le socialisme et l’agitation révolutionnaire (les “journées de juin” 1848) et cherche donc à limiter l’influence de ses adversaires “rouges” en développant un projet de restauration de l’ordre social contrôlé.
La loi du 15 mars 1850 dite loi “Falloux”, du nom du ministre de l’Instruction publique, le comte de Falloux (1811 – 1886), catholique et légitimiste, est une matérialisation de ce projet. Elle veut accroître l’influence de la religion, vue comme un instrument de préservation de l’ordre social, sur l’enseignement. Le parti de l’Ordre, appuyé par les catholiques mais aussi par des libéraux agnostiques ralliés par crainte de la révolution, et dirigé par un Adolphe Thiers (1797 – 1877) aux idées voltairiennes, érige l’Église comme rempart au développement des idées socialistes (alors que la Seconde République des débuts associe l’Église à ses actes, que la Révolution est religieuse, le Christ étant vu comme “un sans-culotte”, etc.).
Le système éducatif français suscite la méfiance de la droite. Elle prend directement le contrepied du projet d’Hippolyte Carnot (1801 – 1888), premier ministre de l’Instruction publique de la IIe République, qui voulait créer une école primaire publique, laïque, gratuite et obligatoire. Elle est “convaincue que le système éducatif, hérité de l’Empire, porte une responsabilité directe dans la persistance de l’esprit révolutionnaire” (Francis Démier). Les instituteurs sont eux accusés d’être les principaux propagandistes du désordre social. Thiers est donc prêt, contre l’influence de ces « trente-sept mille socialistes et communistes, véritables anticurés” et pour maintenir le petit peuple dans la soumission :
[…] à donner au clergé tout l’enseignement primaire. Je demande formellement autre chose que ces instituteurs laïques, dont un trop grand nombre sont détestables ; je veux des Frères, bien qu’autrefois j’aie pu être en défiance contre eux ; je veux rendre toute-puissante l’influence du clergé ; je demande que l’action du curé soit forte, beaucoup plus forte qu’elle ne l’est, parce que je compte beaucoup sur lui pour propager cette bonne philosophie qui apprend à l’homme qu’il est ici pour souffrir.
Discours prononcé au sein de la Commission sur l’instruction primaire de 1849
La question scolaire est d’ailleurs cardinale en France. L’enseignement est l’instrument suprême de l’État pour agir sur la masse des individus, puisqu’en entre eux et l’État, il n’y a théoriquement rien depuis la loi Le Chapelier de 1791 (J.F. Chanet). L’État est “l’instituteur” d’une “nation d’écoliers” (Taine parle du « fatal préjugé français qui érige l’État en éducateur de la nation »).
La loi Falloux : la liberté de l’enseignement

La loi Falloux conforte à cet effet la liberté de l’enseignement primaire, déjà consacrée par la loi Guizot de 1833, et l’étend à l’enseignement secondaire. Sous réserve du respect de conditions d’hygiène et de capacité, l’ouverture d’écoles secondaires privées est libre. Les ecclésiastiques peuvent ouvrir librement des établissements secondaires. Ainsi, un établissement peut être public ou libre, sous direction d’un laïc ou d’un ecclésiastique, et un instituteur peut être laïc ou ecclésiastique. Cette libéralisation répond à une demande des catholiques libéraux depuis les années 1830, déjà inscrite dans la Charte constitutionnelle de 1830 puis à l’article 9 de la Constitution de 1848 :
L’enseignement est libre. – La liberté d’enseignement s’exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l’Etat. – Cette surveillance s’étend à tous les établissements d’éducation et d’enseignement, sans aucune exception.
Les conditions d’admission à l’exercice d’instituteur primaire d’un établissement public ou libre sont favorables aux religieux. Si le brevet de capacité est demandé pour les laïcs, le titre de ministre d’un des cultes reconnus par l’État suffit pour les religieux (art. 25). Chez les femmes, les lettres d’obédience tiennent lieu “de brevet de capacité aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées à l’enseignement et reconnues par l’Etat.” (art. 49), les congrégations féminines étant alors en plein essor. Même chose pour l’ouverture d’un établissement : pour les laïcs, il faut le baccalauréat pour ouvrir un collège du secondaire, ou le brevet pour ouvrir une école primaire, alors qu’une lettre de l’évêque suffit pour les ecclésiastiques.
Les établissements libres peuvent aussi obtenir de la commune, du département ou de l’État ou un local ou une subvention qui ne peut toutefois excéder le dixième des dépenses annuelles de l’établissement (art. 69). Cette disposition existe toujours aujourd’hui (article L151-4 du Code de l’éducation).
L’Église dans l’Université
Le système éducatif français sort du monopole étatique confié à l’Université, le corps chargé de l’organisation de l’enseignement et de l’éducation, foyer de rationalisme, créée par Napoléon Ier le 10 mai 1806. Les établissements libres sont indépendants de l’Université. Elle perd en autonomie avec l’entrée de représentants des religions reconnues, de notables et de représentants de l’enseignement libres au sein du Conseil supérieur de l’instruction publique :
Le Conseil supérieur de l’instruction publique est composé comme il suit :
Le Ministre, président ;
Quatre archevêques ou évêques, élus par leurs collègues ;
Un ministre de l’Eglise réformée, élu par les consistoires ;
Un ministre de l’Eglise de la confession d’Augsbourg, élu par les consistoires ;
Un membre du consistoire central israélite, élu par ses collègues ;
Trois conseillers d’Etat, élus par leurs collègues ;
Trois membres de la cour de cassation, élus par leurs collègues ;
Trois membres de l’Institut, élus en assemblée générale de l’Institut ;
Huit membres nommés par le Président de la République, en conseil des Ministres, et choisis parmi
les anciens membres du Conseil de l’Université, les inspecteurs généraux ou supérieurs, les recteurs
et les professeurs des Facultés. Ces huit membres forment une section permanente ;
Trois membres de l’enseignement libre nommés par le Président de la République, sur la proposition
du Ministre de l’instruction publique.Art. 1.
L’enseignement primaire est placé sous le contrôle de conseils académiques, un pour chaque département, présidés par un recteur qui n’est plus choisi exclusivement parmi les membres de l’enseignement public (art. 9), ce qui affaiblit d’emblée son influence. Les recteurs sont choisis pour leur bienveillance envers l’Église, et après le coup d’État de 1851, pour leur fidélité au nouveau régime (Jean-Claude Yon). Des notables et religieux sont introduits dans les conseils académiques :
Le conseil académique est composé ainsi qu’il suit :
Le recteur, président ;
Un inspecteur d’Académie, un fonctionnaire de l’enseignement ou un inspecteur des écoles primaires, désigné par le Ministre ;
Le préfet ou son délégué ;
L’évêque ou son délégué ;
Un ecclésiastique désigné par l’évêque ;
Un ministre de l’une des deux Eglises protestantes, désigné par le Ministre de l’instruction publique, dans les départements où il existe une Eglise légalement établie ;
Un délégué du consistoire israélite dans chacun des départements où il existe un consistoire légalement établi ;
Le procureur général près la cour d’appel, dans les villes où siège une cour d’appel, et dans les autres, le procureur de la République près le tribunal de première instance ;
Un membre de la cour d’appel, élu par elle, ou, à défaut de cour d’appel, un membre du tribunal de première instance, élu par le tribunal ;
Quatre membres élus par le conseil général, dont deux au moins pris dans son sein.
Les doyens des Facultés seront, en outre, appelés dans le conseil académique, avec voix délibérative, pour les affaires intéressant leurs Facultés respectives.
La présence de la moitié plus un des membres est nécessaire pour la validité des délibérations du conseil académique.Art. 10
Ces conseils académiques exercent la répression sur les instituteurs qu’ils peuvent suspendre, muter ou révoquer, et prennent le relai des préfets à qui la loi “Parieu” du 11 janvier 1850 (la “petite loi Faloux”) avait transitoirement confié cette surveillance (art. 3). La circulaire du 16 janvier 1850 sur l’application de la loi du 11 janvier 1850 avait été claire sur l’orientation à donner à cette surveillance :
Les instituteurs ne sont pas destinés à un rôle politique. Vous n’avez point de services de cette nature à leur demander ; mais vous ne devez pas tolérer qu’ils prennent jamais une attitude hostile au Gouvernement qui les institue.
Toute manifestation de ces principes anarchiques qui masquent leur caractère destructeurs sous des noms spécieux, sous l’apparence d’un système social et politique étranger, et, dès lors, hostile à la constitution, tous actes propres à les propager sont, de la part d’hommes chargés d’un enseignement public et de l’éducation morale et religieuse des enfants du peuple, des fautes graves qui appellent votre sévère attention et l’application des pouvoirs qui vous sont conférés.
En outre, curé, pasteur ou délégué du consistoire israélite prennent part à l’inspection des établissements d’enseignement primaire (art. 18).
La religion dans les cours
Dans le primaire, l’enseignement de la religion précède celui du savoir. L’article 23 place ainsi l’instruction morale et religieuse au premier plan. Il faut attendre la loi du 28 mars 1882 pour que instruction morale et civique la remplace.
L’enseignement primaire comprend :
L’instruction morale et religieuse ;
La lecture ;
L’écriture ;
Les éléments de la langue française ;
Le calcul et le système légal des poids et mesures.
Il peut comprendre en outre :
L’arithmétique appliquée aux opérations pratiques ;
Les éléments de l’histoire et de la géographie ;
Des notions des sciences physiques et de l’histoire naturelle, applicables aux usages de la vie ;
Des instructions élémentaires sur l’agriculture, l’industrie et l’hygiène ;
L’arpentage, le nivellement, le dessin linéaire ;
Le chant et la gymnastique.Art. 23
Dans l’enseignement secondaire religieux, notamment chez les Jésuites, l’enseignement est axé sur les humanités classiques, alors que les matières scientifiques sont négligées (Bruno Poucet). Bref, comme le résume Françoise Mélonio :
À l’école publique, la religion est partout : sur les murs par les crucifix et les maximes, dans les cours par la prières […]
Pas de gratuité ni d’obligation de l’école, mais développement de l’enseignement
La gratuité de l’enseignement est rejetée et l’obligation est jugée impraticable. Cependant, “l’enseignement primaire est donné gratuitement à tous les enfants dont les familles sont hors d’état de le payer” (art. 24).
L’absence de gratuité n’empêche pas l’enseignement primaire de se développer. Elle accentue le mouvement impulsé sous la monarchie de Juillet (3 500 000 à la fin du régime, dont 1 300 000 filles). En 1865, on compte 4 437 000 élèves dans le primaire, dont la moitié de filles, et presque chaque commune compte une école primaire, même si en 1863, 34% des élèves sont présents moins de six mois par an. L’enseignement secondaire, réservé à l’élite, croît lentement 107 000 élèves en 1854, 140 000 en 1866).
L’enseignement catholique se développe. Les deux premières années de la loi Falloux, 257 collèges secondaires libres ouvrent, dont 13 de jésuites. Des congréganistes sont placés à la tête d’établissements publics. L’enseignement secondaire congréganiste a largement bénéficié de la loi Falloux : “en 1865, le privé regroupe près de 100 000 élèves répartis entre 935 établissements alors qu’on ne compte que 83 lycées et 245 collèges publics.” (Jean-Claude Yon).
Le mouvement le plus impressionnant est le développement de l’enseignement féminin. L’article 51 décide la création d’une école de filles dans chaque commune de 800 habitants ou plus (réduit par Victor Duruy à 500 en 1867), sous condition de ressource. Le nombre de filles scolarisées augmente de 40% en quinze ans (Jean-Claude Yon). L’enseignement est largement dominé par les congrégations religieuses féminines : entre 1861 et 1876, deux institutrices sur trois sont des sœurs (J.-F. Chanet), dont 60% dans les écoles publiques, et plus d’un tiers des filles sont scolarisées dans le privé. Chez les garçons, 80% des instituteurs sont des laïcs. Toutefois, il n’existe pas d’enseignement secondaire féminin (les lycées de jeunes filles sont institués par la loi Camille Sée de 1880).
La loi Falloux : l’ouverture de la guerre scolaire
Malgré la place donnée à la religion, cette loi ne satisfait pas pour autant l’Église. C’est en effet une loi de transaction, où la religion est instrumentalisée pour maintenir l’ordre social. En outre, l’État continue à exercer une surveillance des établissements scolaires, ce qui empêche l’Église d’en faire des bastions pour sa “reconquête” religieuse.
Surtout, la loi Falloux, en distinguant l’enseignement public de l’enseignement libre, ouvre une guerre scolaire, une concurrence entre deux jeunesses, “deux France”. Cette configuration se maintient bien au-delà du XIXe siècle : au vaste “mouvement de l’école libre” en 1984 contre le projet de loi Savary répond la manifestation laïque du 16 janvier 1994 contre la révision de la loi Falloux, voulue par le ministre François Bayrou.
L’alliance politique de l’Église et avec le pouvoir, maintenue sous Napoléon III, fixe le combat républicain et démocratique sur le cléricalisme. La question de la laïcisation de l’école devient primordiale. Dans son discours du 15 janvier 1850, Victor Hugo (1802 – 1885), député, demande “l’Église chez elle et l’État chez lui”, et dénonce la loi Falloux comme une arme dans la main du parti clérical. Lui veut un “un immense enseignement public donné et réglé par l’État, partant de l’école de village et montant de degré en degré jusqu’au, Collège de France, plus haut encore, jusqu’à l’Institut de France”. En 1866, Jean Macé (1815 – 1894) fonde la Ligue de l’enseignement, qui défend la laïcité à l’école, à laquelle s’oppose la Société générale d’éducation et d’enseignement, créée en 1867. Le combat républicain aboutit, sous la IIIe République, à la fondation d’une école gratuite, obligatoire et laïque (1881-1882) et à la suppression de l’enseignement congréganiste (1903).
À lire
- Jean-François Chanet, La loi du 15 mars 1850, « Du comte de Falloux aux mécomptes de François Bayrou », Vingtième Siècle. Revue d’histoire 2005/3 (n° 87)
- Jean-François Condette, 1848 : un éphémère printemps de l’école du peuple ?, Revue d’histoire du XIXe siècle 2017/2 (n° 55)
- Francis Démier, La France du XIXe siècle. 1814-1914
- Quentin Deluermoz, Le Crépusucle des Révolutions, 1848 – 1871
- Antoine Léon, Pierre Roche, Histoire de l’enseignement en France
- Françoise Mélonio, Antoine de Baecque, Histoire culturelle de la France, T.3, Lumières et liberté, Les XVIIIe et XIXe siècles
- Pierre Merle, La Démocratisation de l’enseignement
- Bruno Poucet, L’Enseignement privé en France
- Yves Verneuil, École et religion : enjeux du passé, enjeux dépassés, enjeux déplacés ?, Histoire, monde et cultures religieuses 2014/4 (n° 32)
- Philippe Vigier, La Seconde République
- Jean-Claude Yon, Histoire culturelle de la France au XIXe siècle
- Jean-Claude Yon, Le Second Empire









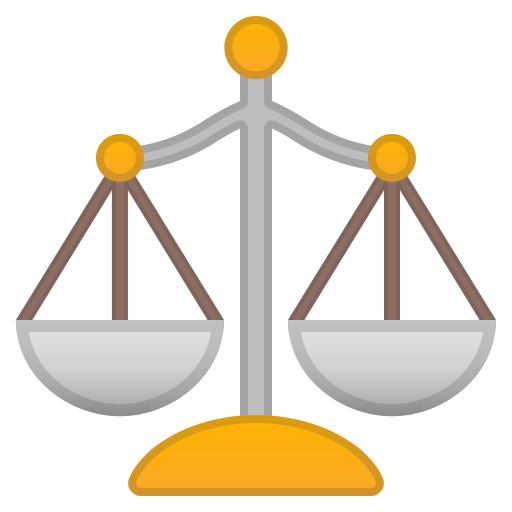









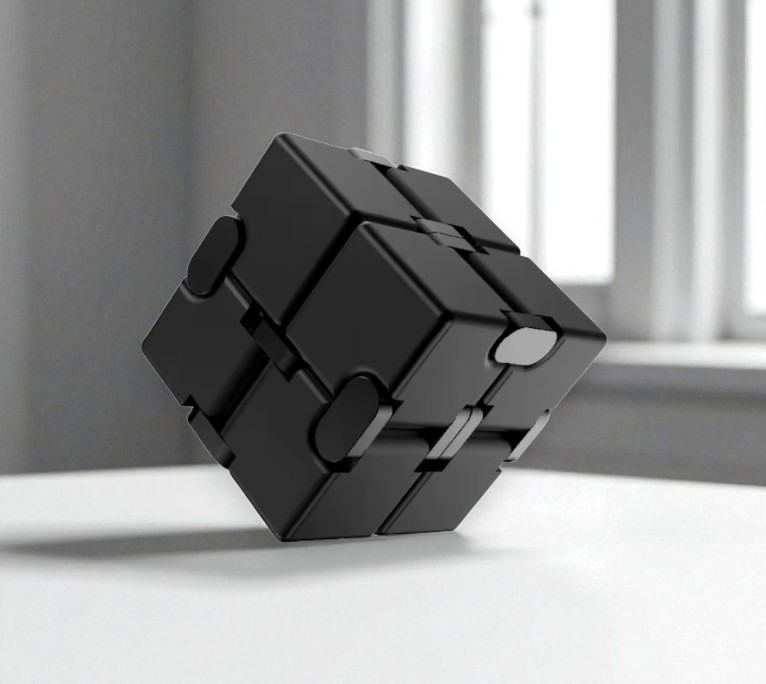

















Au fond, le Pouvoir, quel qu’il soit, a toujours compris que les enfants étant malléables à souhait, il est difficile et ‘dangeureux pour Lui, de leur laisser la liberté de penser, si jamais existe une totale liberté de penser, car ils pourraient se révolter et le renverser, et Il a donc, et encore aujourd’hui, quoique l’on pense!, cherché à le ‘propagandiser’ d’une façon manifeste ou nimbée. Il suffit de se rappeler la fallacieuse accusation contre Socrate, suivie de sa condamnation à mort qui n’a certes pas trompé son monde, lequel, comme lui-meme dit, se serait vite rebellé au Pouvoir qui l’avait condamné, pour comprendre que rien ne change jamais, ou presque rien. Toutefois, pour moi, ce ‘presque’ est déjà un progrès. Espérons-le. monique