
Tombe en nappes d’argent des hauteurs du ciel bleu.
Tout se tait. L’air flamboie et brûle sans haleine ;
La terre est assoupie en sa robe de feu.L’étendue est immense et les champs n’ont point d’ombre,
Et la source est tarie où buvaient les troupeaux ;
La lointaine forêt, dont la lisière est sombre,
Dort là–bas, immobile, en un pesant repos.
Seuls, les grands blés mûris, tels qu’une mer dorée,
Se déroulent au loin, dédaigneux du sommeil ;
Pacifiques enfants de la terre sacrée,
Ils épuisent sans peur la coupe du soleil.
Parfois, comme un soupir de leur
âme brûlante,
Du sein des épis lourds qui murmurent
entre eux,
Une ondulation majestueuse et
lente
S’éveille, et va mourir à l’horizon
poudreux.
Non loin, quelques bœufs blancs,
couchés parmi les herbes,
Bavent avec lenteur sur leurs fanons
épais,
Et suivent de leurs yeux languissants
et superbes
Le songe intérieur qu’ils n’achèvent
jamais.
Homme, si, le cœur plein de joie
ou d’amertume,
Tu passais vers midi dans les champs
radieux,
Fuis ! la nature est vide et le
soleil consume :
Rien n’est vivant ici, rien n’est
triste ou joyeux.
Mais si, désabusé des larmes et du
rire,
Altéré de l’oubli de ce monde
agité,
Tu veux, ne sachant plus pardonner ou
maudire,
Goûter une suprême et morne
volupté,
Viens ! Le soleil te parle en
paroles sublimes ;
Dans sa flamme implacable absorbe-toi
sans fin ;
Et retourne à pas lents vers les
cités infimes,
Le cœur trempé sept fois dans le
néant divin.
Poèmes antiques, 1852









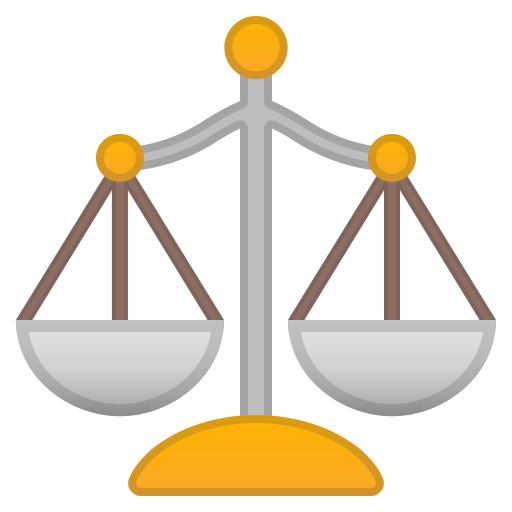









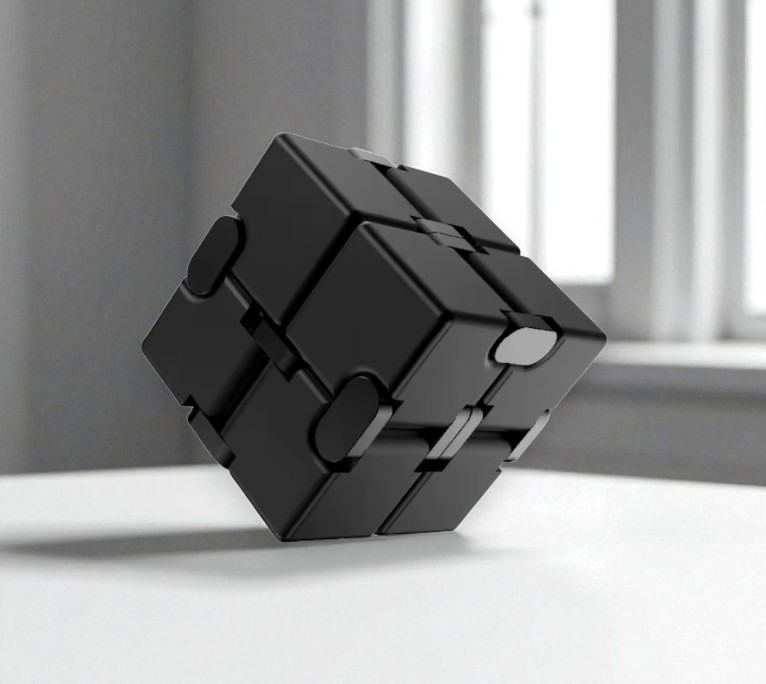

















Laisser un commentaire