La phrase « je fais à la France le don de ma personne » est tirée d’un discours de Philippe Pétain (1856 – 1951), radiodiffusé le 17 juin 1940 à midi et demi :
Français !
À l’appel de monsieur le président de la République, j’assume à partir d’aujourd’hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l’affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis à vis de nos alliés. Sûr de l’appui des anciens combattants que j’ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne, pour atténuer son malheur.
En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés, qui dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion, et ma sollicitude.
C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat.
Je me suis adressé cette nuit à l’adversaire pour lui demander s’il est prêt à rechercher à moi, entre soldats, après la lutte, et dans l’honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités.
Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside, pendant ces heures [lapsus], pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n’obéir qu’à leur foi dans le destin de la patrie.
Contexte du discours de Pétain du 17 juin 1940 (“je fais à la France le don de ma personne”)

Philippe Pétain, maréchal de France de 84 ans, célèbre auprès de l’opinion public comme “vainqueur” de Verdun (de la bataille de Verdun en 1916, pendant la Première Guerre mondiale), et président du Conseil (le chef du gouvernement, qui détenait alors la réalité du pouvoir) depuis la veille le 16 juin 1940, annonça aux Français, qui découvrirent sa voix, vouloir « mettre un terme aux hostilités » avec « l’adversaire », c’est-à-dire l’Allemagne, contre laquelle la France était en guerre depuis le 3 septembre 1939.
L’offensive allemande, déclenchée le 10 mai 1940, a entraîné la “débâcle” de l’armée française, si bien que le gouvernement français s’est retiré à Bordeaux pour y siéger à partir du 14 juin. Paul Reynaud, président du Conseil à partir du 21 mars 1940, était partisan de la poursuite de la guerre depuis l’Afrique du Nord. Ne se sentant pas soutenu, il démissionna le 16 juin en faveur de son vice-président, Pétain.
Par la célèbre formule « je fais à la France le don de ma personne, pour atténuer son malheur », Pétain semblait s’offrir, dans sa propagande, comme en sacrifice à une France ébranlée par la défaite, sorte de Cincinnatus qui faisait office de recours dans un temps de malheur. Cette phrase est aujourd’hui un des symboles en France la défaite de 1940.
Hostile au conflit dès son commencement parce qu’il estimait la France mal préparée moralement et militairement, Pétain était un chaud partisan de l’armistice, c’est-à-dire de la suspension des hostilités. Sa vision de l’événement dépassait le simple constat de la défaite : il envisageait, plus que l’armistice, la paix, pour mettre en place un projet politique de « reconstruction » de la France. La guerre était pour lui l’assurance que la France serait détruite. Il aurait ainsi tenu dès le 26 mai des propos évocateurs à Paul Baudouin, rapporté dans Neuf mois au gouvernement :
C’est une chose facile et stupide d’affirmer qu’on luttera jusqu’au dernier homme. C’est criminel aussi étant donné nos pertes de l’autre guerre et notre faible natalité. Et puis, qu’est-ce que cela veut dire ? On le dit et on ne le fait pas. Il faut sauver une partie de l’armée, car sans une armée groupée autour de quelques chefs pour maintenir l’ordre, une vraie paix ne sera pas possible et la reconstruction de la France n’aura pas de point de départ.
Dans la veine de ces propos rapportés, le discours radiodiffusé de Pétain n’évoquait pas la suspension des hostilités, mais leur fin, c’est-à-dire la paix. Baudouin, ministre des Affaires étrangères, avait en effet mandé le 17 juin à minuit et demi l’ambassadeur de l’Espagne auprès des Allemands afin de requérir une cessation des hostilités et de connaître les conditions de la paix (cf. Bénédicte Vergez-Chaignon).
“Trop peu d’enfants, trop peu d’armes, trop peu d’alliés, voilà les causes de notre défaite.”
Pétain révéla peu à peu aux Français son idéologie politique (la “reconstruction de la France”) au fil de trois autres appels qu’il leur adressa pendant ce moment clé de conclusion de l’armistice avec les Allemands. L’appel du 20 juin 1940 fut plus long que celui du 17 :
Français !
J’ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. Le Gouvernement a désigné mercredi les plénipotentiaires chargés de recueillir leurs conditions. J’ai pris cette décision, dure au cœur d’un soldat, parce que la situation militaire l’imposait. Nous espérions résister sur la ligne de la Somme et de l’Aisne. Le Général Weygand avait regroupé nos forces. Son nom seul présageait la victoire. Pourtant la ligne a cédé et la pression ennemie a contraint nos troupes à la retraite.
Dès le 13 juin, la demande d’armistice était inévitable. Cet échec vous a surpris. Vous souvenant de 1914 et de 1918, vous en cherchez les raisons. Je vais vous les dire.
Le 1er mai 1917, nous avions encore 3 280 000 hommes aux armées, malgré trois ans de combats meurtriers. À la veille de la bataille actuelle, nous en avions 500 000 de moins. En mai 1918, nous avions 85 divisions britanniques ; en mai 1940, il n’y en avait que 10. En 1918, nous avions avec nous les 58 divisions italiennes et les 42 divisions américaines.
L’infériorité de notre matériel a été plus grande encore que celle de nos effectifs. L’aviation française a livré à un contre six ses combats.
Moins forts qu’il y a vingt-deux ans, nous avions aussi moins d’amis. Trop peu d’enfants, trop peu d’armes, trop peu d’alliés, voilà les causes de notre défaite.
Le peuple français ne conteste pas ses échecs. Tous les peuples ont connu tour à tour des succès et des revers. C’est par la manière dont ils réagissent qu’ils se montrent faibles ou grands.
Nous tirerons la leçon des batailles perdues. Depuis la victoire, l’esprit de jouissance l’a emporté sur l’esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu’on a servi. On a voulu épargner l’effort ; on rencontre aujourd’hui le malheur.
J’ai été avec vous dans les jours glorieux. Chef du Gouvernement, je suis et resterai avec vous dans les jours sombres. Soyez à mes côtés. Le combat reste le même. Il s’agit de la France, de son sol, de ses fils.
Après un exposé sur les causes immédiates de la défaite militaire, Pétain termine sur les causes profondes : une France qui a cédé, depuis la victoire de 1918, à “l’esprit de jouissance” et de “revendication” (les avancées sociales du Front populaire) au lieu de se sacrifier à l’effort et au repeuplement (“trop peu d’enfants” ou “notre faible natalité” dans les propos rapportés par Baudouin).
Si la défaite et l’armistice étaient acceptables, c’est parce que, selon lui, la France était structurellement inférieure à l’Allemagne. L’honneur de l’armée française, qui, dans ces conditions, ne pouvait faire mieux, était pour lui préservé.
“La terre, elle, ne ment pas”
L’armistice signé avec l’Allemagne le 22 juin 1940 (entré en vigueur la nuit du 24 au 25) soumettait la France à des conditions très dures (un autre armistice avec l’Italie a été signé le 24 juin). Le même jour, Winston Churchill (1874 – 1965), Premier ministre du Royaume-Uni (depuis le 10 mai), déplorait l’armistice et mit en cause l’indépendance du gouvernement. Il lui promet l’asservissement à l’Allemagne et enjoignait les Français à poursuivre à ses côtés le combat. Le 18 juin et le 22 juin, les appels à la poursuite de la guerre émis depuis Londres de Charles de Gaulle (1890 – 1970), général à titre temporaire et sous-secrétaire d’État chargé de la Défense nationale et de la Guerre dans le gouvernement Reynaud (à partir du 6 juin), allèrent dans le même sens.
Le 23 juin, dans un nouvel appel, Pétain répliqua à Churchill (et à De Gaulle), en justifiant une nouvelle fois l’armistice. Dans une ode à la France, il exaltait le redressement, qui prenait pour modèle le paysan qui cultive inlassablement son champ malgré les caprices du temps, en se désintéressant totalement de la nature et des intentions de l’ennemi devant lequel elle se soumettait, l’Allemagne nazie.
Français !
Le gouvernement et le peuple français ont entendu hier, avec une stupeur attristée, les paroles de M. Churchill.
Nous comprenons l’angoisse qui les dicte. M. Churchill redoute pour son pays les maux qui accablent le nôtre depuis un mois.
Il n’est pourtant pas de circonstances où les Français puissent souffrir, sans protester, les leçons d’un ministre étranger. M. Churchill est juge des intérêts de son pays ; il ne l’est pas des intérêts du nôtre. Il l’est encore moins de l’honneur français.
Notre drapeau reste sans tache. Notre armée s’est bravement et loyalement battue. Inférieure en armes et en nombre, elle a dû demander que cesse le combat. Elle l’a fait, je l’affirme, dans l’indépendance et dans la dignité.
Nul ne parviendra à diviser les Français où leur pays souffre.
La France n’a ménage ni son sang, ni ses efforts. Elle a conscience d’avoir mérité le respect du monde. Et c’est d’elle, d’abord, qu’elle attend le salut. Il faut que M. Churchill le sache. Notre foi en nous-mêmes n’a pas fléchi. Nous subissons une épreuve dure. Nous en avons surmonté d’autres. Nous savons que la patrie demeure intacte tant que subsiste l’amour de ses enfants pour elle. Cet amour n’a jamais eu plus de ferveur.
La terre de France n’est pas moins riche de promesse que de gloire.
Il arrive qu’un paysans de chez nous voie son champ dévasté par la grêle. Il ne désespère pas de la moisson prochaine. Il creuse avec la même foi le même sillon pour le grain futur.
M. Churchill croit-il que les Français refusent à la France entière l’amour et la foi qu’ils accordent à la plus petit parcelle de leurs champs ?
Ils regardent bien en face leur présent et leur avenir.
Pour le présent, ils sont certains de montrer plus de grandeur en avouant leur défaite qu’en lui opposant des propos vains et des projets illusoires.
Pour l’avenir, ils savent que leur destin est dans leur courage et leur persévérance.
Le 25 juin, jour de l’entrée en vigueur de l’armistice, Pétain prononça un quatrième appel, dans lequel il justifiait de nouveau l’armistice. Celui-ci débutait par un exposé sur les causes de la défaite française, justifiant, selon lui, l’armistice. Il n’y considère jamais les fautes du haut commandement ou les questions stratégiques : la France a perdu parce qu’elle était inférieure en force brute, c’est-à-dire en hommes et en armes. Cette défaite rendait la poursuite de la lutte illusoire, et justifiait le maintien d’un gouvernement français en France afin de représenter un peuple uni devant l’ennemi et d’épargner des vies. Surtout, Pétain annonçait, dans cet appel, la mise en place d’un “ordre nouveau”. Il exalte encore une fois, dans passage assez obscure de la fin de son discours, le paysan cultivateur, comme modèle de la France à restaurer. “La terre, elle, ne ment pas” : il ne fait pas de fausses promesses comme ceux qui enjoignent leurs compatriotes à continuer la lutte. Les Français souffrent, et ils seront amenés à souffrir, comme le paysan qui s’échine sur son lopin de terre, étranger à “l’esprit de jouissance” honni. Selon Pétain, c’est par là que doit s’accomplir, à la faveur de la défaite, le “redressement intellectuel et moral” auquel il convie les Français.
Français !
Je m’adresse aujourd’hui à vous, Français de la métropole et Français d’outre-mer, pour vous expliquer les motifs des deux armistices conclus, le premier avec l’Allemagne, il y a trois jours, le second avec l’Italie.
Ce qu’il faut d’abord souligner, c’est l’illusion profonde que la France et ses alliés se sont faits sur la véritable force militaire et sur l’efficacité de l’arme économique, liberté des mers, blocus, ressources dont ils pouvaient disposer. Pas plus aujourd’hui qu’hier on ne gagner une guerre uniquement avec de l’or et des matières premières. La victoire dépend des effectifs, du matériel et des conditions de leur emploi. Les événements ont prouvé que l’Allemagne possédait, en mai 1940, dans ce domaine, une écrasante supériorité à laquelle nous ne pouvions plus opposer, quand la bataille s’est engagée, que des mots d’encouragement et d’espoir.
La bataille des Flandres s’est terminée par la capitulation de l’armée belge en rase campagne et l’encerclement des divisions anglaises et françaises. Ces dernières se sont battues bravement. Elles formaient l’élite de notre armée ; malgré leur valeur, elles n’ont pu sauver une partie de leurs effectifs qu’en abandonnant leur matériel.
Une deuxième bataille s’est livrée sur l’Aisne et sur la Somme. Pour tenir cette ligne, soixante divisions françaises, sans fortifications, presque sans chars, ont lutté contre cent-cinquante divisions d’infanterie et onze divisions cuirassées allemandes. L’ennemi, en quelques jours, a rompu notre dispositif, divisé nos troupes en quatre tronçons et envahi la majeure partie du sol français.
La guerre était déjà gagnée virtuellement par l’Allemagne lorsque l’Italie est entrée en campagne, créant contre la France un nouveau front en face duquel notre armée des Alpes a résisté.
L’exode des réfugiés a pris, dès lors, des proportions inouïes. Dix millions de Français, rejoignant un million et demi de Belges, se sont précipités vers l’arrière de notre front, dans des conditions de désordre et de misère indescriptibles.
À partir du 15 juin, l’ennemi, franchissant la Loire, se répandait à son tour sur le reste de la France.
Devant une telle épreuve, la résistance armée devait cesser. Le gouvernement était acculé à l’une de ces deux décisions : soit demeurer sur place, soit prendre la mer. Il en a délibéré et s’est résolu à rester en France, pour maintenir l’unité de notre peuple et le représenter en face de l’adversaire. Il a estimé qu’en de telles circonstances, son devoir était d’obtenir un armistice acceptable, en faisant appel chez l’adversaire au sens de l’honneur et de la raison.
L’armistice est conclu, le combat a pris fin. En ce jour de deuil national, ma pensée va à tous les morts, à tous ceux que la guerre a meurtris dans leur chaire et dans leurs affections. Leur sacrifice a maintenu haut et pur le drapeau de la France. Qu’ils demeurent dans nos mémoires et dans nos cœurs.
Les conditions auxquelles nous avons dû souscrire sont sévères.
Une grande partie de notre territoire va être temporairement occupée. Dans tout le Nord et dans l’Ouest de notre pays, depuis le lac de Genève jusqu’à Tours, puis le long de la côte, de Tours aux Pyrénées, l’Allemagne tiendra garnison. Nos armées devront être démobilisées. Notre matériel remis à l’adversaire, nos fortifications rasées, notre flotte désarmée dans nos ports. En Méditerranée, des bases navales seront démilitarisées. Du moins l’honneur est-il sauf. Nul ne fera usage de nos avions et de notre flotte. Nous gardons les unités terrestres et navales nécessaires au maintien de l’ordre dans la métropole et dans nos colonies. Le gouvernement reste libre, la France ne sera administrée que par des Français.
Vous étiez prêts à continuer la lutte je le savais. La guerre était perdue dans la métropole, fallait-il la prolonger dans nos colonies ? Je ne serais pas digne de rester à votre tête si j’avais accepté de répandre le sang français pour prolonger le rêve de quelques Français mal instruits des conditions de la lutte. Je n’ai voulu placer hors du sol de France ni ma personne, ni mon espoir. Je n’ai pas été moins soucieux de nos colonies que de la métropole. L’armistice sauvegarde les liens qui l’unissent à elles. La France a le droit de compter sur leur loyauté.
C’est vers l’avenir que désormais nous devons tourner nos efforts. Un ordre nouveau commence. Vous serez bientôt rendus à vos foyers. Certains auront à le reconstruire.
Vous avez souffert.
Vous souffrirez encore. Beaucoup d’entre vous ne retrouveront pas leur métier ou leur maison. Votre vie sera dure. Ce n’est pas moi qui vous bernerai par des paroles trompeuses. Je hais les mensonges qui vous ont fait tant de mal. La terre, elle, ne ment pas. Un champ qui tombe en friche, c’est une portion de France qui meurt. Une jachère de nouveau emblavée, c’est une portion de France qui renaît. N’espérez pas trop de l’État qui ne peut donner que ce qu’il reçoit. Comptez pour le présent sur vous-mêmes et, pour l’avenir, sur les enfants que vous aurez élevés dans le sentiment du devoir.
Nous avons à restaurer la France. Montrez-la au monde qui l’observe, à l’adversaire qui l’occupe, dans tout son calme, tout son labeur et toute sa dignité. Notre défaite est venue de nos relâchements. L’esprit de jouissance détruit ce que l’esprit de sacrifice a édifié. C’est à un redressement intellectuel et moral que, d’abord, je vous convie. Français, vous l’accomplirez et vous verrez, je le jure, une France neuve surgir de votre ferveur.
Le 10 juillet 1940, les parlementaires (députés et sénateurs) votèrent à Vichy à 569 voix “pour” et 80 “contre” une loi constitutionnelle donnant tous pouvoirs au gouvernement de la République, sous autorité de Pétain, pour promulguer une nouvelle constitution. La IIIe République disparut de fait pour donner naissance à l’« État français » ou au « régime de Vichy », dont Pétain fut le chef (jusqu’à août 1944). Cet État mena, avec la participation active de Pétain, une politique réactionnaire, raciste (antisémite avant tout) et de collaboration avec l’Allemagne nazie, jusqu’à sa disparition en 1944.
Pétain fut incarcéré en juillet 1945, après la capitulation de l’Allemagne (8 mai 1945), puis condamné le 15 août, à l’issue de son procès devant la Haute Cour de justice, à la peine de mort, à la dégradation nationale, et à la confiscation de ses biens. Sa peine de mort fut commuée par De Gaulle en prison à perpétuité. Il mourut en détention sur l’Île-d’Yeu en 1951.
Voir ici : De Gaulle à propos de Pétain “la vieillesse est un naufrage”
À lire
- Bénédicte Vergez-Chaignon, Pétain










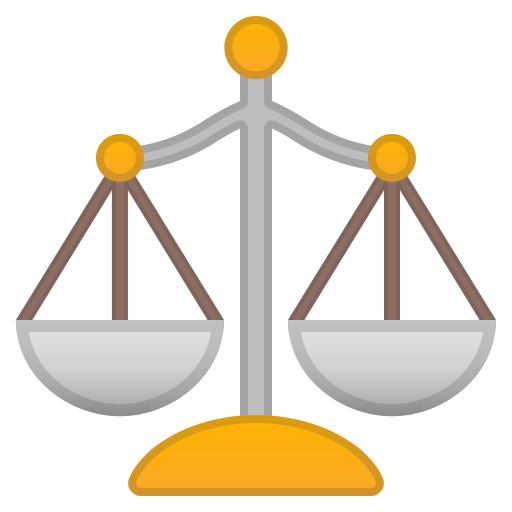



















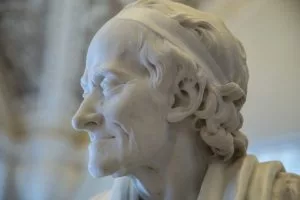



Qui fut l’auteur du texte ?