Plus l’Europe se fait, moins elle sait ce qu’elle est et doit être.
L’article de Marcel Gauchet tente de prononcer une formulation philosophique de ce problème. Depuis la chute du bloc soviétique, ce problème s’est accentué : l’Europe est “un objet politique non identifié” selon le mot de Jacques Delors. Au-delà des justifications pratiques à sa construction, comme la défense de la paix, l’accroissement de la prospérité, la recherche de la taille dans un monde où les États-nations européens se révèlent trop petits, l’objectif profond du projet européen est brouillé.
Il y a quelque chose dans l’histoire européenne qui pousse à une unification du continent et, en même temps, cette unification reste problématique.
Cet article est une synthèse d’un article de Marcel Gauchet publié dans le numéro 129 de la revue Le Débat, de mars-avril 2004, que l’on peut retrouver dans La Condition politique, livre indispensable s’il en est pour comprendre notre situation politique.
L’originalité de la construction européenne

L’Europe, une fédération d’États-nations
L’Union européenne n’est pas la seule organisation qui cherche à fédérer, unir ou rapprocher des États-nations. D’autres exemples d’intégrations régionales existent : le Mercosur en Amérique du Sud, l’Alena en Amérique du Nord, l’Asean en Asie du Sud-Est…Mais la construction européenne est faite de quelque chose de plus spécifique.
L’Europe ne peut être ni une simple zone de libre échange entre des États-nations associés en vue de leur prospérité commune, ni une nation-État fédérale unitaire.
Cette disposition originelle de l’Europe est une énigme, ramassée dans la la formule de Jacques Delors : “une fédération d’États-nations“. En effet, l’Europe n’a pas vocation à devenir un grand État-nation remplaçant les nations actuelles, mais une fédération d’États-nations, une union politique où les États-nations restent des États-nations.
Les nations européennes sont la base de l’Union
C’est sûr la base des États-nations que l’Europe se fait. Les États ne sont pas uniquement des machines à s’affronter les unes les autres. Loin de ne contenir qu’un principe d’affrontement dont le XXe siècle a été témoin, les nations contiennent aussi un principe d’union de termes séparés. Le cosmopolitisme est fils des États-nations autant que le bellicisme.
Ce sont les nations qui rendent possible le projet de leur réunion au sein d’un ensemble plus vaste, d’une communauté universelle des nations basée sur l’égalité de ses composantes et leur libre accord.
La visée de la construction européenne n’est donc pas de former une “nation européenne”. L’union des nations de l’Europe représente quelque chose de différent.
L’universalisme européen procède de la même logique. Alors que l’universalisme américain est national, fait d’une nation qui se pense exceptionnelle par les valeurs qui ont présidé à sa fondation et son développement, l’universalisme européen est polycentrique. Toutes les nations y concourent, aucune ne l’incarne mais aucun extérieur n’est exclu.
Le problème européen : les nations et la civilisation

Le problème européen est un problème d’articulation entre les nations et la civilisation.
Telle est la thèse de Marcel Gauchet. La civilisation, au singulier, doit être comprise comme le produit commun des nations. Elle est leur horizon universel. La civilisation ne peut en revanche pas exister sans le support des nations qui sont les vecteurs de son développement. Une civilisation qui veut s’accomplir en dehors des communautés particulières risque de s’abolir.
Cette situation, problématique, existait déjà avant la Première Guerre mondiale selon Gauchet. Il reprend alors une formulation de l’historien Charles Seignobos (Histoire de la civilisation contemporaine, 1899) :
La civilisation commune crée un courant international qui pousse les peuples à se sentir solidaires et à se rapprocher ; les rivalités et les haines créent un courant national qui pousse les peuples à s’isoler et à se traiter en ennemis. De la force de ces deux courants dépendra l’avenir du monde.
Qu’est-ce que la civilisation ?
Le terme de civilisation, apparu à la moitié du XVIIIe siècle, exprime une identité commune au-delà des particularismes nationaux. La civilisation est à cette époque identifiée à l’oeuvre du progrès, une somme de réalisations durables et susceptibles d’accumulation, fruits de la raison. Le progrès de cette civilisation s’incarne dans les découvertes scientifiques contribuant au progrès de l’esprit humain en général. Cette civilisation s’étend par extension aux perfectionnements de l’esprit dans les arts mécaniques, les lois ou les moeurs.
C’est un mouvement, dans le temps, de l’esprit humain et des communautés humaines qui tend vers le meilleur. La somme de ces avancées par le pouvoir de la raison porte le nom de civilisation. Les hommes ont en commun une oeuvre qui transcende la particularité de leurs appartenances et promet de les faire coexister un jour dans la paix, tel que l’exprime le projet cosmopolitique d’un Kant, par exemple.
La civilisation, oeuvre des nations
Une nation est une communauté qui partage un projet historique collectif. Telle quel, elle se développe dans sa particularité. Mais cet acteur historique ne s’enferme pas en lui-même. Une nation, en développant son projet au cours de l’histoire, produit quelque chose de valable pour tous : elle touche au domaine de l’universel. La civilisation est cette notion qui donne l’idée de cette oeuvre universelle qui est réalisée au cours de l’histoire. Elle est le nom de ce que les communautés particulières ont en partage, ce qu’elles contribuent à faire émerger, ce dans quoi elles se reconnaissent.
La nation est par ailleurs un élément qui inclut la pluralité dans son essence. L’idée de nation est inséparable de leur coexistence et de leur rivalité. Mais pluralité des nations ne veut pas dire hétérogénéités des nations. Elles partagent une culture commune, romaine et chrétienne.
Le temps de l’histoire
Les nations et la civilisation s’alimentent d’une même chose : l’histoire. On regarde leur développement du point de vue historique. Qu’est-ce que cela signifie ? Nous sommes au temps de l’histoire, c’est-à-dire une époque où nous sommes conscients que nous produisons collectivement un avenir. Nous sommes conscient que nous faisons l’histoire en vue de produire l’avenir.
Trois configurations du problème européen
Ce problème européen d’articulation entre les nations et la civilisation se décline sous trois configurations significatives depuis le XIXe siècle.
1. La civilisation par les nationalités, où l’on suppose une harmonie naturelle entre les deux termes. Cette formule culmine au milieu du XIXe siècle.
2. Les nationalismes au nom de la civilisation. De fait, ils sont contre la civilisation. La civilisation est victime des nations qui prétendent la capter à leur profit. Cette formule correspond à l’âge des impérialismes autour de 1900.
3. La civilisation sans les nations ou le dépassement des nations au profit de la civilisation. Bien que moins belligène que la formule précédente, cette formule pose aussi un problème d’articulation entre nations et la civilisation.
Quand les royaumes s’universalisent

Capter l’universel
Les nations ont eu l’ambition de capter l’universel à leur profit. En effet, les royaumes qui les ont précédé ont cherché à capter sur un territoire limité l’universalité que porte l’Empire : les monarques ont voulu donner à leur territoire la vocation à exprimer l’unité du genre humain qui donne sens à l’idée impériale.
En plus de l’Empire, les nations cherchent à capter le deuxième vecteur de l’universel, l’Église. Les royaumes qui ont précédé les nations ont cherché à s’approprier la religion chrétienne à leur profit : une “nationalisation” des Églises avant l’heure. Dans les pays où il s’impose, le protestantisme fait cette oeuvre. En France, où la Réforme ne s’impose pas, le roi cherche à subordonner l’Église gallicane pour voir confluer fidélité du chrétien et fidélité du sujet.
La concurrence entre nations
Ces proto-nations telles que les appelle Marcel Gauchet, les royaumes de l’Europe, par cette capture de l’universalité de l’Empire et de l’Église à leur profit, vivent en concurrence. Chaque nation est particulière, mais chacune se revendique de l’universalisme. Ce sont des États rivaux, mais similaires et ouverts les uns aux autres. Ils se suivent, s’observent et se copient. Peu à peu se dégage l’idée que chaque nation représente une manière légitimement différente de faire la même chose et de tendre vers le même but.
Le nationalisme vient discréditer la civilisation

La civilisation par les nationalités
De 1820 à 1870, de l’indépendance grecque à l’unification allemande, l’affirmation des nationalités et le développement de la civilisation vont de pair :
…s’il faut consacrer l’existence des nations historiques, c’est afin d’ajouter un agent libre et efficace de plus à l’entreprise universelle de la civilisation.
Ainsi Michelet affirme-t-il dans le Le peuple que “la patrie est l’initiation nécessaire à l’universelle patrie.” Plus il y aura de nations libérées de l’oppression, plus elles pourront travailler ensemble à la concorde.
Les nationalismes au nom de la civilisation
Le nationalisme arrive, dans les deux dernières décennies du XIXe siècle comme une rupture par rapport à cette perspective.
Le nationalisme et l’impérialisme correspondent à une lutte pour la prépondérance civilisationnelle, où chaque nation tend à se poser comme élue de Dieu, du destin ou de l’histoire en tant qu’interprète et agent de la civilisation. À la limite, elle se veut l’universel à elle seule.
Ainsi, Joseph Chamberlain, apôtre du progrès social par la “plus grande Angleterre”, peut-il affirmer dans son discours du 11 novembre 1895 :
Je crois en cette race, la plus grande des races gouvernantes que le monde ait jamais connues, en cette race anglo-saxonne, fière, tenace, confiante en soi, résolue, que nul climat, nul changement ne saurait abâtardir, et qui, infailliblement, sera la force prédominante de la future histoire et de la civilisation universelle… Et je crois en l’avenir de cet empire, vaste comme le monde, dont un Anglais ne saurait parler sans un frisson d’enthousiasme.”
Le nationalisme se distingue ainsi du chauvinisme par la composante universaliste dans son exaltation particulariste. La nation du nationaliste a une mission civilisationnelle qui doit passer par l’expansion la plus large possible : colonialisme en de nouvelles terres, et colonisation intérieure, à la “frontière” américaine, borne de l’expansion de la civilisation.
La notion de civilisation a été discréditée par cette tentative d’appropriation par chaque nation, qui ont justifié par elle guerres et colonisations.
Quand l’Europe ne croît plus aux nations

Le retour de la civilisation : l’économie et le droit
On n’ose plus prononcer le mot de civilisation, désormais condamné. Mais la notion a fait un retour subreptice au premier plan, dans une Europe où la guerre entre les grands ennemis d’hier est devenue presque impossible. En effet :
Le retour de la civilisation s’est effectué sous son aspect le plus humble, le plus prosaïque, mais aussi le moins sujet à discussion : l’aspect matériel de l’industrie, de la technique, des échanges, du calcul économique.
C’est une concrétisation de l’universalité scientifique. Par l’économie, élément partagé universellement, la civilisation a trouvé une incarnation pratique. Cette ressaisie s’est montrée d’une efficacité incomparable. À cet universel scientifique, pratique, qui modèle la pensée (une même façon d’envisager l’action de produire, une même façon de préparer des transactions efficaces, etc.), s’est ajouté un autre élément qui tient de l’universalisme de la civilisation : celui du droit et de l’État de droit.
Le dépassement des nations
En même temps, l’Europe se définit comme une communauté dans laquelle s’applique des règles et des valeurs valables pour les personnes et les institutions. Les nations ne peuvent que vouloir appliquer ces règles qui tiennent de l’universellement acceptable. La célèbre thèse du “patriotisme constitutionnel” défendue par Habermas lie la fidélité des citoyens à la chose publique, à la validité reconnue aux normes qui régissent la communauté. Cependant, cette thèse oublie le support particulier nécessaire à l’élévation du citoyen à cet universel.
Les nations européennes sont en effet à un degré d’ouverture inégalé de leur histoire, du point de vue de ce qu’elles ont en commun, du genre d’activités auxquelles leurs sociétés se dédient et du fonctionnement de leurs corps politiques. Cette configuration les place devant la perspective de leur dépassement. En effet, au regard de leurs similitudes, qu’est-ce qui justifie leur séparation ? Là est le problème.
L’oeuvre de rapprochement qu’opère la civilisation n’est pas politique. Elle associe les peuples, abolit les anciens motifs d’hostilité, mais ne donne aucun élément pour fonder une nation européenne, seule à même d’assurer la direction de la communauté.
Aujourd’hui, le problème européen est inverse de celui de 1900 :
La civilisation tend, en Europe, à dissoudre les nations en elle. Ou, pour être plus exact, elle pousse les nations, puisque l’initiative du mouvement leur appartient, à se sublimer dans l’universalité réalisée de la civilisation dont leur histoire moderne a accouché.
Une nation européenne impossible
Un élément rend la perspective de la création d’une nation unique impossible. Le projet européen ne vise pas une universalité qui lui serait propre. Il vise à l’universel tout court. Les règles et normes qu’il produit, le projet qu’il propose, pourraient être également valables pour toutes les nations du monde. S’il en est ainsi, c’est parce qu’une pluralité de nations concordent à le produire, et oublient ainsi leurs particularismes.
Si l’universalisme américain peut facilement s’enfermer sur lui-même, si les États-Unis peuvent prétendre être la terre d’élection de la civilisation où elle se développe indépendamment du monde, les nations européennes ne peuvent ignorer, elles, ni les États-Unis, ni la diversité de leurs histoires propres.
Ainsi, l’universalisme européen distingue ses valeurs et ses règles de leur application concrète, toujours singulière, dans chaque nation. Le risque alors est celui de l’indéfinition : quelles sont les limites de cette civilisation ? Autre élément : puisque chaque État européen tend vers les mêmes buts et aspirations, pourquoi ne pas se libérer d’eux pour se concentrer sur l’essentiel ? En d’autres termes, pourquoi ne pas dissoudre les corps politiques ? Cette dissolution :
[…] les verrait s’effacer au sein d’une société enfin rendue à la vérité de ses seules composantes qui vaillent, la garantie du droit des personnes et l’efficacité des mécanismes économiques.
D’où :
…l’aspiration à une communauté supra-politique, où une “gouvernance” globale suffirait à assurer les arbitrages et l’équilibre entre les différentes faces de cette dynamique civilisationnelle enfin pleinement consacrée dans son homogénéité.
De là le péril d’une autodestruction : l’universalisme européen a pour seul moteur la volonté des nations qui veulent transcender leurs particularismes. Les nations sont le laboratoire du genre d’unité auquel aspire l’Europe.
Le jour où il n’y aura plus de nations pour vouloir l’Europe, il n’y aura plus d’Europe.
Universalité civilisationnelle, particularisme culturel
La civilisation occidentale, civilisation universelle
Bien sûr, il existe d’autres grandes civilisations que la civilisation occidentale, qui sont autant de représentantes d’une manière d’être de l’humanité. Il est évidemment puéril de considérer la civilisation occidentale comme la seule digne de ce nom, la critique de l’ethnocentrisme étant là un des acquis majeurs du XXe siècle.
Cependant, Marcel Gauchet distingue la civilisation au singulier, dans la mesure où il se développe dans l’Occident moderne quelque chose qui dépasse l’Occident :
…un mode de pensée dont l’explication rationnelle et mathématique de la nature forme le noyau. Un mode de pensée qui ne reste pas confiné dans la connaissance scientifique, mais qui irradie la vie sociale, s’y diffuse par le canal de la technique, s’y élargit en mode d’action rationnel, dont le calcul économique est la forme la plus répandue, mais non la seule, loin s’en faut.
Un deuxième noyau de la civilisation occidentale
À ce noyau, dont la validité universelle est incontestable (tout le monde accepte les mathématiques), Marcel Gauchet veut en ajouter un deuxième, sujet à débats. Ce deuxième noyau est constitué du principe de légitimité constitué par les droits individuels, “les droits de l’homme“.
Si la source du droit n’est pas hétéronome, si elle n’est pas héritée des ancêtres, elle se trouve alors dans l’égale liberté attribuée aux individus. Si l’universalité des droits de l’homme fait débat, c’est que certaines régions du monde ne sont pas “sortie de la religion“. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que certains pays légitiment toujours la configuration de leur société par ce qui se présente avant soi ou au-dessus de soi (“les ancêtres faisaient ainsi”, “Dieu dicte”, etc.).
Une civilisation mondiale
Ces deux noyaux de la civilisation occidentale, la science, qui détermine une manière de penser et de faire, et la politique, qui détermine une manière collective de fonctionner, sont destinés à devenir les noyaux d’une civilisation mondiale, planétaire. L’Occident ne les impose pas : les autres nations se les approprient en raison des biens qu’ils promettent. Nulle contrainte à l’occidentalisation, comme lors de la première mondialisation de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle.
Cette appropriation ne se fait pas sans difficultés. En témoigne le recrutement de fondamentalistes dans des milieux qui ont pourtant bénéficié d’une formation scientifique. N’oublions pas l’histoire de l’Europe qui est un rappel des douleurs qu’entraîne l’avènement du monde moderne.
La nécessité du particularisme
Ces deux noyaux d’universalité se diffusent partout parce qu’ils n’ont pas réponses à tout. Il ne définissent pas une manière d’être totale.
La science, le calcul, les règles de l’action rationnelle ne dictent pas le tout des façons de penser des façons de faire. Les droits de l’homme ne commandent pas le tout des rapports entre les êtres et du fonctionnement des institutions politiques. Il y a plus d’une façon de les entendre et de les mettre en oeuvre.
Le particularisme est, on le voit, nécessaire. La diversité d’entendre, d’appliquer et d’aménager ces principes universels est d’essence. La modernité est multiple et va l’être davantage.
Il y a des démocraties, et non pas une, des systèmes de droit, des capitalismes et mêmes des visions de la science et de la technique. En ces domaines, il ne peut qu’y avoir plusieurs manières de viser la même chose, des manières ancrées dans la contingence d’histoires singulières.
Culture et civilisation ne s’opposent donc pas. La civilisation universelle se décline en autant de cultures qu’il y a de nations. Elle ne se donne jamais dans sa pureté, mais s’exprime chaque fois dans un cadre particulier où elle acquiert une physionomie spécifique en fonction de l’histoire dans laquelle elle s’insère. La nation en est le catalyseur. Trois raisons définissent cette articulation.
En premier lieu :
la mise en oeuvre progressive de l’universel scientifique, économique ou politique se déroule dans le temps. Elle exige un énorme travail de cohérence afin de nouer la nouveauté en train d’advenir avec l’héritage en place, l’ancien permettant de lire l’inédit, l’inédit demandant de relire l’ancien […] Voilà en quoi l’avancement de la civilisation suppose l’élaboration d’une culture au travers de laquelle elle prend sens historiquement et socialement pour les acteurs.
En deuxième lieu, il faut noter que nous n’évoluons pas spontanément dans le domaine de l’universel. Nous parlons des langues différentes. Nous sommes primitivement assignés à une particularité au-delà de laquelle nous nous construisons.
En troisième lieu, l’universel de la civilisation exige, de par sa nature, d’être mis en oeuvre de manière collective, consciente et maîtrisée. Elle s’effectue naturellement dans une démocratie forte, où les intentions collectives font l’objet d’une façonnement délibéré. La civilisation réclame le gouvernement commun de ses produits.
Les nations sont elles-mêmes tournées vers la civilisation : elles permettent à leurs membres de réaliser quelque chose qui les dépassent.
[La nation] ne tire sa substance que de son inscription à l’intérieur d’une civilisation, dont la nature universelle la justifie dans ses efforts pour en donner, du sein de ses limites, l’expression la plus exemplaire possible.
Conclusion
Pour Marcel Gauchet, nous avons donc de fortes raisons de penser que nous aurons affaire au couple nation/civilisation pour longtemps. Le problème européen réside aussi ici : si l’antagonisme meurtrier entre les nations est aujourd’hui un lointain souvenir, cette association nécessaire entre nations et civilisation rend impossible la grande fédération rêvée par les premiers promoteurs de la construction européenne.
Ce qui lie est aussi ce qui sépare. L’intensité de l’aspiration à l’unité civilisationnelle n’a d’égale que la résistance des inscriptions nationales, d’autant plus inexpugnables que devenues pour une grande part inconscientes.
La démarche des fondateurs a épuisé ses ressources. On ne peut plus non plus faire sans savoir ce que l’on fait, au prix de réveiller des contradictions entre des termes jusque là harmoniques.
L’Europe avec les peuples
Cet empire de la civilisation, sans territoires ni pouvoir pour l’incarner, ne peut reposer que sur le concours actifs des nations qu’il transcende. L’Europe avancera par les peuples ou n’avancera plus. Elle est condamnée autrement, à l’interminable piétinement sur place d’une déconstruction de ses composantes sans construction d’une chose commune, sous la houlette d’une “bureaucratie missionnaire dont la cécité le dispute à l’ardeur.”
Un monde d’États-nations
L’Europe doit en outre être consciente que son ambition n’a rien de banale : nous vivons dans un monde d’État-nations loin du stade atteints par les nations européennes. Il faut que les Européens raisonnent à l’aune de ce monde pour mieux faire vivre le mécanisme subtil de leur union.
La nouvelle Europe
Chapitre issu d’un article inédit publié dans La Condition politique, “La nouvelle Europe”.
L’Europe indéfinie
L’Europe a très mal négocié le tournant de la chute du communisme. Cet impératif de défense commune avait un impact identitaire sur le projet : notre façon de vivre contre la leur. À l’abri de cette nécessité a pris corps la construction d’une Europe unie. Elle est fille de la paix, et non l’inverse.
Le projet européen avait pour horizon lointain la construction d’une nation unique pour répondre aux défis posés par la taille des États-Unis et de l’Union soviétique. En attendant, l’entité émergente est restée dans une indéfinition prudente, entre un embryon de fédéralisme et une coopération intergouvernementale étroite.
Pour faire oublier l’écroulement du rêve de la construction du socialisme dans un seul pays, la France de François Mitterrand place la construction de l’Europe comme son grand dessin.
L’Europe sera pour la France le moyen de retrouver, grâce à la souveraineté partagée, un rôle dont à elle seule elle n’a plus les moyens. Il est essentiel de se souvenir de cette promesse pour comprendre la désillusion amenée par les changements ultérieurs.
La fin de l’idée de nation européenne
La chute du bloc communiste à partir de 1989 a libéré le développement d’une immense bouffée d’air idéologique, dont l’aspect le plus spectaculaire a été les élargissement successifs à l’Est. Le renforcement de l’hétérogénéité des composantes a effacé la perspective d’arriver, un jour, à créer une nation européenne. Conséquence inattendue :
Loin de l’idée que s’en faisaient ses Pères fondateurs, la construction européenne s’est révélée être, en fait, l’amorce d’une fédération mondiale des États-nations. Sans doute constitue-t-elle par force une puissance régionale. Mais son destin n’est pas de s’affirmer dans sa particularité géographique et civilisationnelle. Elle est ouverte dans son principe. Son génie est cosmopolite.
Mais ses institutions n’ont pas suivi cette évolution. Au contraire, elles ont continué à avancer vers “une union toujours plus étroite” de type fédéral.
L’individu universel contre une nation européenne
L’universalisation toujours croissante de la figure de l’individu a encouragé la démarche européenne d’abolition des frontières. L’être de droit qu’il représente se meut dans un monde post-national. Cette figure sape donc tout autant l’idée d’une nation européenne bornée sur un territoire défini.
Un objet politique non-identifiable
L’Union européenne est en outre devenue un objet politique non-identifiable qui ne satisfait plus aux attentes que placent inconsciemment les citoyens en elle en tant qu’ils sont membres d’une communauté politique.
Elle ne leur donne pas le sentiment de protection qu’apporte l’idée d’appartenir à un collectif, ne se donne pas d’identité ni la possibilité pour ses membres de se situer dans une histoire commune et assumée pour comprendre sa place dans le monde.
L’égalité des nations
Un autre élément agit ici aussi. Les nations se sont transformées : l’État n’est plus un englobant contraignant. Il est devenu une infrastructure, un socle implicite. Il est le producteur de l’espace collectif dans lesquels les individus peuvent se penser (je me pense avant tout comme membre de l’État “France”, je ne me situe nulle part, sauf affirmation militante, lorsque je me dis citoyen du monde). Cette transformation du statut de l’État a modifié les conditions de coexistence des nations. Elles ont intégré leur similitude dans leur pluralité :
[Les nations] n’existent qu’à plusieurs et qu’en rapport les uns avec les autres ; elles sont taillées sur le même patron ; elles se consacrent à la même tâche.
C’est une révolution intellectuelle et morale : elles ont pris conscience de leur parenté foncière. Nous sommes à l’âge de l’égalité dans les rapports internationaux. Elle rend possible une “consociation entre eux fondée sur le sentiment de l’oeuvre conduite en commun”.
Une Europe des peuples à horizon mondial
La direction, l’esprit et la teneur de la construction européenne a changé. Sa dynamique est désormais universaliste.
L’horizon a basculé ; il a cessé d’être l’édification d’une nation européenne particulière pour devenir la formation d’une communauté des nations à vocation universelle, en droit ouverte à toutes celles qui se reconnaissent dans les conditions de ce processus de mise en commun.
Les nations européennes sont désormais les seules à pouvoir faire vivre leur association. L’autogouvernement au niveau étatique est devenu inséparable de l’autogouvernement à plusieurs.
Le programme désormais doit se concentrer sur une mission : aménager la solidarité des démocraties. C’est la tâche qu’il faut désormais accomplir. À l’intérieur, cette transformation demande une clarification de la règle de subsidiarité : que faut-il faire en commun ? Que faut-il faire au niveau des nations ? À l’extérieur, elle demande une maîtrise de l’ouverture à d’autres partenaires.
La nouvelle Europe en train de décanter au milieu de la confusion propre à ce genre de tournants historiques sera une Europe des peuples à horizon mondial.
À lire
Cet article synthétise deux articles de Marcel Gauchet que l’on peut retrouver dans La Condition politique, livre de très haute tenue dont la lecture serait très bénéfique à tous ceux qui préparent des concours.










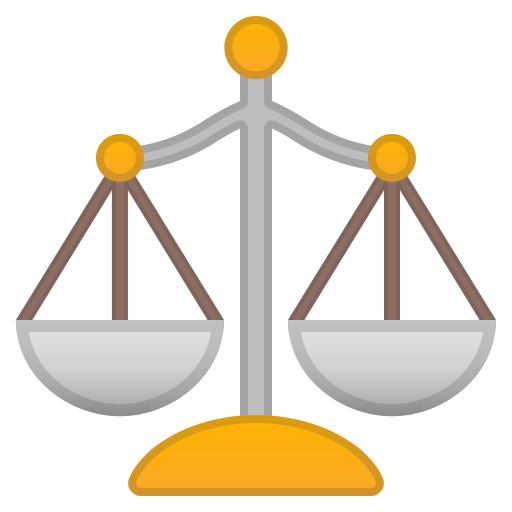























Laisser un commentaire