
⏳ Temps de lecture : 18 minutes
Cet article est inspiré par l’Histoire politique
de la Ve République (2011) d’Arnaud Teyssier.
Haut-fonctionnaire et historien, proche de Philippe Séguin (1943 –
2010), il critique le dévoiement des institutions fondées par
général de Gaulle, par ceux qui lui ont
succédé.
1995 à 1997 : le gouvernement Juppé
“L’autre politique” de Chirac

Le mandat du président de la République François Mitterrand (1916 – 1996) arrive à sa fin en 1995. Le pouvoir socialiste est usé. Deux ans plus tôt, en 1993, il n’est parvenu qu’à faire élire 57 députés aux élections législatives. Une nouvelle cohabitation avec la droite, après celle de 1986, s’est imposée.
Édouard Balladur, Premier ministre de 1993 à 1995
La droite choisit son champion, Édouard Balladur (né en 1929), comme Premier ministre. Celui-ci mène une politique de réformes d’inspiration libérale. La France doit respecter les critères de convergence européens, c’est-à-dire limiter ses déficits et sa dette publics. C’est une obligation dans l’optique du passage à la monnaie unique.
Le traité de Maastricht, signé en 1992, ratifié par la France après un referendum en 1991, a renforcé les critères de convergence en vue de l’instauration d’une union monétaire (euro). Cela se traduit par une politique du franc fort et de limitation des dépenses.
Édouard Balladur est le favori des sondages pour les élections présidentielles de 1995.
Son rival, le fondateur du parti gaulliste le Rassemblement pour la République, Jacques Chirac (1932 – 2019), semble disqualifié. Son autorité a été ébranlée par l’échec de sa candidature face à celle de Mitterrand aux présidentielles de 1988. Le président s’est même permis de donner une leçon de rhétorique à son concurrent :
Mais Chirac n’en démord pas. Il lance, lui aussi, une campagne pour 1995.
“L’autre politique” de Chirac
Chirac vilipende la politique de Balladur. Il promet une “autre politique”.
Son discours cible la “fracture sociale”. Chirac affirme ainsi sa volonté de lutter contre le chômage. Il promet des augmentations de salaire pour relancer l’activité. Il refuse de faire de l’Union européenne un carcan qui limite la souveraineté de la France. Philippe Séguin, de sensibilité gaulliste “social”, est l’inspirateur de ce volet de la campagne.
Néanmoins, le candidat n’hésite pas à faire feu de tout bois. Il se fait en même temps le champion d’un retour au libéralisme. Il suit là la ligne d’un autre conseiller, Alain Madelin (né en 1946).
Cette contradiction ne semble pas frapper pas l’opinion.
Les partisans de Chirac voit en lui un homme énergique capable de relancer la croissance et de réduire le chômage. Ce dernier s’élève, début 1995, à 10,1% de la population active.
Chirac est une offre d’alternance à un pouvoir usé. Son succès ne vient pas d’un mouvement de fond de la société. Chirac n’est pas un homme nouveau : c’est le moins pire. C’est en effet un vieux routier de la politique : il est une première fois secrétaire d’État en 1967, maire de Paris dès 1977 et Premier ministre à deux reprises, en 1974 et en 1986.
La défaite de Balladur, la victoire de Chirac
Au premier tour, Chirac obtient 20,84% des voix, derrière le candidat du Parti socialiste, Lionel Jospin (né en 1937), qui obtient 23,30% des suffrages. E. Balladur, avec 18,58% des voix, est battu. Jean-Marie Le Pen (né en 1928), président du Front national (FN), parti d’extrême-droite, consolide sa présence dans le paysage électoral : il fait 15%.
Je vous demande vous arrêter !
Le 7 mai 1995, Jacques Chirac est élu président de la République avec 52,64% des voix contre L.Jospin.
Le choix d’Alain Juppé comme Premier ministre
Le 17 mai, c’est l’heure de vérité. Dans son discours d’investiture, Chirac rend hommage, tacitement, à Séguin. Il parle de “pacte républicain”, il adopte un ton gaullien en parlant “d’État impartial, assumant pleinement ses missions de souveraineté et de solidarité”. Il rappelle, bien entendu, la priorité qu’il donnera au retour à l’emploi.
Mais Séguin, le tenant de cette “autre politique”, est éloigné des postes de pouvoir : il obtient la présidence de l’Assemblée nationale.
Le poste de chef du gouvernement échoit à Alain Juppé (né en 1945).
Ce choix annonce implicitement que Chirac ne veut pas de rupture avec la politique d’E. Balladur. Alain Juppé fait partie de ceux qui se sentent proches d’une droite libérale et moderne, plutôt que d’un gaullisme social et dirigiste. C’est aussi un “européen convaincu”.
À Séguin le ministère du verbe. À Juppé le ministère de la France.
Qui est Alain Juppé ?

A. Juppé est produit de la méritocratie républicaine. Né à Mont-de-Marsan dans une famille d’exploitants agricoles aisés, il entre, à 19 ans, à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, à Paris. Il obtient, trois ans plus tard, l’agrégation de lettres classiques.
Il ne fait pas carrière à l’université. Il entre à SciencesPo, puis à l’École nationale d’administration (ENA) et sort avec un brillant classement : il devient un inspecteur des finances, puis entre en politique.
A. Juppé fait toute sa carrière dans le giron de Chirac. C’est d’abord son économiste. En 1980, il rejoint la haute administration de la ville de Paris au poste de directeur des finances. En 1993, il devient le ministre des Affaires étrangères du gouvernement Balladur, mais ne retire jamais -officiellement-, son soutien à Chirac.
C’est un ministre de bonne réputation.
Le journal en ligne Atlantico a publié plusieurs extraits du livre de Bruno Dive, “Alain Juppé, l’homme qui revient de loin”.
Celui-ci aurait exprimé à plusieurs reprises des doutes sur la victoire Jacques Chirac et aurait même envisagé…de changer de camp !
“Alain Juppé n’est pas loin de flancher. La séduction balladurienne semble à son tour opérer sur lui. En février 1995, quelques journalistes qu’il reçoit à déjeuner, et qui en restent stupéfaits, l’entendent dire : « L’un sera toujours un agité ; l’autre est déjà un homme d’État. “
Le système des partis
Le parcours de commis de l’État d’A.Juppé aurait pu faire croire à un retour à une gestion traditionnelle de l’appareil gouvernemental, après le deuxième épisode de cohabitation.
Mais ministre de cohabitation à deux reprises, il reste marqué par des pratiques nouvelles, qui laissent une influence plus grande au Parlement, alors que la Ve République donne la prépondérance au pouvoir exécutif.
L’Assemblée nationale n’est pas dissoute

Au lieu de profiter de l’élan de la présidentielle pour obtenir une assemblée disciplinée derrière lui, le chef de l’État conserve la législature de 1993, certes de droite, mais traversée par des courants contradictoires.
Elle est ainsi composée de libéraux d’inspiration anglo-saxonne, de gaullistes plus traditionnels ou de centristes sociaux.
En résulte un gouvernement pléthorique, conçu pour satisfaire chaque sensibilité : 43 ministres, ministres délégués et secrétaires d’État. Plutôt que de prendre acte du choix du peuple souverain pour une “politique Chirac”, le pouvoir choisit d’être le compromis partisan. Ainsi, 17 ministères sont confiés à des personnalités de l’Union de la démocratie française (UDF), le parti centriste, dont trois importants : l’économie et les finances avec (A. Madelin), la Défense et les Affaires étrangères.
Une majorité composite

Le gouvernement ne semble donc pas procéder du pouvoir exécutif, mais du pouvoir législatif.
Pléthorique, dichotomique, elle est difficile à contrôler. Les ministres offrent le spectacle de leur amateurisme en multipliant les déclarations cavalières.
Intention symbolique significative, de nombreux ministères sont confiés à des personnalités nouvelles. François Baroin (né en 1965) est nommé porte-parole du gouvernement. Preuve de l’engagement et des efforts d’A. Juppé en faveur de la parité, douze femmes entrent au gouvernement, affublées du surnom sexiste et condescendant de “juppettes”. Aucune n’obtient, toutefois, de portefeuille de “premier ordre”.
La volonté réformatrice d’Alain Juppé
En 1995, la droite est majoritaire partout : en plus de la présidence, elle domine le Parlement, la presque totalité des régions, des départements et la plupart des grandes villes (Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, etc.).
Mais le gouvernement n’a pas de véritable programme. Chirac, lors de la campagne, a développé un discours “gauchisant”, contre “fracture sociale”, et libéral, inspiré par A. Madelin. Son élection à la fonction suprême, aux dépens de E.Balladur, est une surprise.
Cet extrait montre Chirac jongler entre les deux dimensions de son discours : sociale et libérale.
Cependant, A.Juppé est animé par une véritable volonté réformatrice. Le Premier ministre se souvient de la période de la première cohabitation, une lutte permanente entre le gouvernement Chirac et le président Mitterrand. Il garde un souvenir amer de la deuxième cohabitation, quand la rivalité Chirac/Balladur grevait la possibilité de toute réforme de profondeur.
Il fait un bilan implacable des quatorze années de pouvoir du Parti socialiste. Si l’ancien président le République a conforté les institutions (après les avoir critiqué très durement, voir Le coup d’État permanent), les gouvernements socialistes et ceux de droite pendant les cohabitations ont laissé un lourd passif, selon A. Juppé, notamment les déséquilibres entre les différents régimes de Sécurité sociale ou la compromission de la pérennité des systèmes de retraite.
La priorité : lutter contre le chômage
La lutte contre le Chirac était un des principaux axes de la campagne de Chirac. A. Juppé fait de la lutte contre le chômage une priorité. A. Juppé veut mener une “guerre” contre le chômage, et une “guerre” contre “l’exclusion” qui en découle.
Le 22 mai, le Premier ministre exhorte les préfets à s’engager dans sa lutte. Ils engagent dans cette entreprise “leur responsabilité personnelle”. Ce discours déconcerte : les préfets ont-ils vocation à mener une telle politique ? Ils peuvent, tout au plus, préserver des emplois avec des subventions ou s’engager dans des discussions avec les acteurs départementaux.
Les mesures du gouvernement Juppé pour l’emploi
Le gouvernement privilégie deux approches dans le cadre d’un “grand plan d’urgence pour l’emploi“. Elles reflètent le compromis branlant de la campagne présidentielle : un peu de social-démocratie d’un côté, un peu de libéralisme de l’autre.
On s’inscrit donc, d’un côté, dans une stratégie de “traitement social du chômage”. Deux types de contrats sont créés :
- le contrat initiative-emploi (CIE) pour les chômeurs de longue durée ;
- le contrôle d’accès à l’emploi pour les jeunes (CAE), qui, comme son nom l’indique, vise à favoriser l’insertion des jeunes sur le marché du travail.
D’un autre côté, le gouvernement essaie de stimuler la croissance :
- il augmente le SMIC pour faire augmenter la demande ;
- il allège la fiscalité et simplifie les procédures administratives des PME pour faire augmenter l’offre.
Une promesse non-tenue : l’augmentation des impôts
Chirac s’était engagé à réduire les impôts pendant sa campagne. Son gouvernement les augmente :
- la taxe sur la valeur ajouté (TVA) est haussée de 2 points ;
- l’impôt de la solidarité sur la fortune (ISF) et l’impôt sur les société (IS) sont majorés.
Les mesures de lutte contre le chômage ont en effet un coût.
Le gouvernement ne s’est donc pas engagé dans une politique féroce de réduction des dépenses publiques. Le représentant du libéralisme au gouvernement, A. Madelin, est d’ailleurs contraint à la démission dès le 25 août après avoir annoncé vouloir s’attaquer aux avantages acquis des fonctionnaires et des agents du service public.
La pression de l’Allemagne sur les déficits

La France a un déficit de 5,6% du PIB en 1994 et une dette de 49,6%. Le gouvernement allemand conservateur d’Helmut Kohl (1930 – 2017) s’en émeut : la France pourrait ne pas adopter la monnaie unique au rendez-vous de 1999. C’est une perspective inacceptable pour le président de la République et le Premier ministre.
Les efforts de gouvernement se concentrent désormais sur la réduction des déficits.
Aucune stratégie de communication ne lui permet néanmoins de justifier ce revirement. Il ne peut s’humilier en avouant la pression allemande. Il ne peut pas, non plus, rejeter la responsabilité de l’augmentation des impôts sur le gouvernement précédent : la majorité de Balladur est encore à l’Assemblée.
Une rentrée difficile
Dans les banlieues, l’été a été agité. Les questions de l’immigration et des mineurs multirécidivistes reviennent au premier plan. Mais le gouvernement est paralysé. Il ne veut pas être accusé de reprendre les thèses du FN.
1995 est aussi l’année de sortie du célèbre film de Matthieu Kassovitz (né en 1967), La Haine. Après la mort de Khaled Kelkal (1971 – 1995), terroriste du Groupe islamique armé (GIA) algérien, en octobre, des émeutes éclatent en banlieue lyonnaise.
Lorsque A. Juppé annonce le gel du salaire des fonctionnaires, l’opinion perd ses dernières illusions. Les promesses de la campagne de 1995 ne seront pas tenues. Il n’y a aura pas une “autre politique”, mais la prolongation de celle de Balladur : lutter contre les déficits pour rassurer les milieux financiers et préparer la France à l’entrée dans la monnaie unique.
Le couple Chirac-Juppé est au plus bas dans les sondages. La côte d’A. Juppé passe de 63 % en juin et juillet à 57 % en août, puis descend à 40 % en octobre et à 37 % en novembre.
Le temps de Séguin ?
Le long mais riche discours de Séguin de 1992 contre l’Europe du traité de Maastricht
Séguin, le représentant du gaullisme social, pourrait profiter des difficultés précoces du gouvernement pour remplacer A. Juppé. C’est un des principaux opposants à “l’Europe de Maastricht”.
Mais il ne fait pas figure de recours. Sa nomination comme chef du gouvernement serait le signal que la France s’engage dans une politique hostile à l’Europe du traité de Maastricht. Ce serait, en d’autres termes, une véritable renversement en faveur d’une Europe intergouvernementale plutôt que fédérale. Un changement dont l’ampleur peut effrayer.
Jacques Chirac voit en outre en Séguin un rival. C’est un Premier ministre potentiellement incontrôlable. L’entourage de Chirac a fait les frais de ses nombreuses saillies, notamment Dominique de Villepin (né en 1953), de plus en plus influent.
Un nouveau “régime d’assemblée” ?
Alain Juppé se retrouve “coincé”. La politique du gouvernement n’a pas été voulue par l’électorat. Il ne peut la justifier en attaquant le gouvernement précédent, puisque la majorité est la même. L’Allemagne et l’Europe font pression.
Selon A. Teyssier, la réaction du pouvoir révèle une transformation importante de la pratique des institutions. Pour reprendre en main la politique du pays et signaler à l’opinion la réorganisation de l’action gouvernementale, A. Juppé n’annonce pas un nouveau programme devant le peuple. Il fait l’erreur de ne pas “dramatiser” la situation, comme aurait pu le faire le général de Gaulle (1890 – 1970), le fondateur de la Ve République, en la présentant comme un moment grave de notre histoire nationale.
Au contraire, A. Juppé agit comme en “régime d’assemblée“, surnom péjoratif donné par le gaullisme aux IIIe et IVe républiques, où le Parlement dominait la vie politique. Le chef de gouvernement se contente donc de changer les hommes et de réajuster les équilibres parlementaires. Cette “méthode” traduit en actes, selon A. Teyssier, la perte d’autorité du président de la République par rapport à celle de ses prédécesseurs. Le Premier ministre ne tire plus assez d’autorité de l’appui du Président.
Le remaniement
La sortie des “juppettes”
Le 15 octobre 1995, Alain Juppé se fait élire à la tête de son parti, le RPR. C’est une façon de renforcer sa position.
Le 7 novembre, moins de six mois après sa constitution, il remet la démission de son gouvernement. Le nouveau gouvernement Juppé est plus resserré. Une équipe de 32 ministres, allégée des huit “juppettes”. De démagogue, A. Juppé passe à “machiste” aux yeux de critiques. Un bien “mauvais souvenir” pour lui.
Plus resserrée, cette équipe n’en est pas pour autant plus cohérente. Elle reflète davantage encore les nuances de la majorité. Trois balladuriens entrent au gouvernement : Jean-Claude Gaudin, Alain Lamassoure et Dominique Perben. Les compétences de Jacques Barrot, ministre UDF, sont étendues à l’ensemble du champ social.
Cette manoeuvre est peu conforme à l’esprit des institutions instillé par le général de Gaulle selon A. Teyssier. L’équipe gouvernementale se contente de refléter les différents équilibres entre courants politiques à l’Assemblée nationale. L’autorité du gouvernement ne trouve plus sa source pas dans l’élection du président de la République par l’ensemble du corps électoral.
La réforme de la Sécurité sociale
A. Juppé décide de consacrer ses efforts à la réforme de la Sécurité sociale, dont les déséquilibres sont de plus en plus inquiétants.
Deux obstacles principaux se dressent sur son chemin : la mauvaise conjoncture économique qui contraint le budget de l’État, et la fragilité de l’autorité du président, à la merci des équilibres de l’Assemblée nationale. Au lieu de lui servir de fusible, le gouvernement l’entraîne dans sa chute.
Le “plan Juppé”
Le 15 novembre, le chef du gouvernement présente son projet à l’Assemblée nationale. Pour assurer la pérennité du système, il veut :
- encadrer les demandes de prestation ;
- réformer les modes de gestion, notamment la gestion par les syndicats du budget de l’Assurance Maladie ;
- soustraire aux maires la présidence de droit des hôpitaux de leur commune, afin de ne pas mêler leur gestion à des considération de politique locale ;
- allonger la durée des cotisations de retraite des fonctionnaires ;
- réformer les régimes spéciaux de retraite.
Il engage sa responsabilité sur ce projet. Le soutien massif qu’il obtient le conforte : il a la main sur le terrain politique.
Il trouve en outre le soutien d’un syndicat, la CFDT de Nicole Notat (née en 1947).
Mais ce soutien est trompeur. Le Parlement n’est pas le terrain des véritables affrontements qui animent la société.
Face au plan Juppé : les grèves de 1995
Le gouvernement doit affronter une “fronde sociale”. Les mesures sur les retraites des fonctionnaires et la réforme des régimes spéciaux suscitent l’ire des syndicats FO et CGT.
FO gère en outre l’Assurance maladie. Le syndicat craint que le projet de Juppé ne le dépossède de son contrôle. En même temps, François Bayrou (né en 1951), ministre de l’Éducation nationale, fait face à des manifestations étudiantes.
Un pôle d’opposition totale à la réforme se constitue. La FO et la CGT demandent “le retrait total du plan Juppé”. Il impose son rythme à une aile modérée, la CFDT, la confédération générale des cadres, qui, elle, demande des aménagements.
Les grèves de 1995 : un nouveau mai 1968 ?
Cette mobilisation est sans précédent depuis 1968. Mais elle reste limitée aux grands services publics. Point d’ouvrier dans les rangs des manifestants. Point de grande idéologie portée par les étudiants non plus.
Le parti socialiste, sans chef véritable, affaibli, ne peut profiter de la situation. Le parti communiste a perdu sa superbe d’antan. En 1995, Robert Hue, son secrétaire national, obtient seulement 8,64%.
L’abandon partiel de la réforme
Le gouvernement entre en résistance. Il ne cherche ni la dissolution, ni le referendum, ni la réquisition des services publics. Mais il refuse de céder à la pression syndicale. A. Juppé espère voir le mouvement pourrir, comme les grèves 1986 de la SNCF.
Cependant, la semble soutenue par l’opinion. Les usagers, malgré les difficultés, soutiendraient les manifestants qui exprimeraient une amertume collective devant les sacrifices demandés. Le mouvement de 1995 a pu être interprété comme un refus par la société française de la logique libérale qu’imposent la mondialisation et la construction européenne (comme le difficile vote du traité de Maastricht par referendum en 1991 en aurait témoigné).
Les parlementaires prennent peur. Le gouvernement est affaibli. Alain Juppé doit ouvrir la voie à la discussion
Le 12 décembre, un million de personne sont dans la rue.
Le 15, Juppé abandonne la réforme sur les retraites, la fonction publique et les régimes spéciaux. Pour donner le change, il annonce en outre la tenue pour le 21 décembre d’un “sommet sur l’emploi” portant sur la réduction du temps de travail et l’insertion des jeunes.
1996 : poursuite de la même politique
L’épreuve de force débouche sur un sévère échec pour A. Juppé. On lui reproche d’être plus féroce dans le ton que dans les actes, et de ne pas s’être concerté avec les syndicats.
Le recul sur la réforme des régimes spéciaux est un symbole. C’est un dossier sur lequel le gouvernement ne “devait” pas reculer. C’est un lourde hypothèque sur l’avenir.
Pire encore, cet échec renforce le sentiment d’impuissance publique. La droite semble incapable de réformer un pays dans lequel elle possède presque tous les pouvoirs.
L’essayiste et philosophe Jean-François Revel (1924 – 2006) fait un bilan sévère de cet épisode :
On entend dire que les Français sont ouverts aux réformes, à condition qu’on s’efforce de leur expliquer. C’est une illusion complète. Quand, durant la campagne des présidentielles, Jacques Chirac parlait de réformes visant à réduire la fracture sociale, les Français comprenaient qu’ils allaient être noyés sous une pluie de subventions. Les réformes qui visent une réduction des déficits publics ou des déficits sociaux, ils ne les comprennent pas du tout.
L’usure du gouvernement Juppé
Le 22 février 1996, Chirac annonce à la télévision que le service militaire sera supprimé progressivement. Le 28 mai, le président de la République décide l’abandon du service national obligatoire et le remplace par un “rendez-vous citoyen”.
L’été 1996 est difficile. Le gouvernement est usé. La majorité se fissure. L’UDF critique le manque d’enthousiasme et d’imagination du pouvoir.
Il est handicapé par ses contradictions congénitales. Le gouvernement ne peut s’avouer franchement européen. Il risquerait de s’aliéner ses derniers soutiens dans l’opinion. Il ne peut pas non plus se dire anti-européen, au risque de froisser les députés balladuriens et UDF.
Les manifestations universitaires persistent. D’autres problèmes apparaissent : des revendications corses et des “affaires” impliquant des membres de la majorité.
Octobre noir
Les marges de manoeuvres d’A. Juppé sont réduites comme peau de chagrin en octobre. Il ne récolte plus que 27% d’opinions favorables. Pour la quatrième fois, il engage la responsabilité de son gouvernement devant l’Assemblée. C’est un aveu de faiblesse. Dans la pratique de la Ve République, c’est au Parlement de censurer, pas le contraire.
Le chef de gouvernement essaie de trouver un nouveau souffle. En novembre 1996, à l’occasion d’un discours au conseil national du RPR, il s’attaque au thème de la “modernisation de la vie politique“. Derrière ce jargon se cache l’idée d’influencer les mentalités et les comportements pour mieux faire accepter les réformes.
Chirac avoue lui aussi son impuissance. Le 12 décembre 1996, il dit à a des journalistes à la télévision :
Nous sommes un pays profondément conservateur, dans lequel il est extrêmement difficile de bouger quoi que ce soit, car on se heurte, à la fois aux traditions et aux peurs.
Il lance ainsi le thème très porteur de l’impossibilité de réformer la France.
Une tentative de reprise en main
Les élections législatives de 1998 approchent. Pour éviter le désastre, le pouvoir tente de reprendre en main la vie politique.
La montée durable du FN
Une grande inconnue menace le gouvernement : le score du FN. Sa force électorale se situe entre 10 et 15%. Mais est-il capable de se maintenir au second tour au dépend des candidats du RPR ?
En février 1997, à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, la candidate du FN, Catherine Mégret (née en 1958), arrive largement en tête au premier tour, devant le candidat du PS. Le RPR choisit alors de tester la stratégie du “front républicain”. Il contraint ses candidats à se désister. Les états-majors incitent l’électorat à repousser l’extrême-droite.
La sanction est claire : Catherine Mégret gagne les élections. L’électorat n’a pas suivi sa direction.
Au-delà de l’attention qu’éveille Jean-Marie Le Pen par son talent oratoire et ses outrances, le FN profite de la désaffection de l’électorat envers les partis traditionnels. Les facteurs sont multiples : détresse économique, exclusion, inquiétude sur l’immigration, sur la sécurité, spectacle de l’impuissance publique, etc.
La loi Debré sur l’immigration
La priorité du gouvernement est donc de contrer la montée du FN.
Le projet de loi de lutte contre l’immigration clandestine présenté par le ministre de l’Intérieur, Jean-Louis Debré (né en 1944), pourtant durci par l’Assemblée nationale en décembre 1996, suscite dès février, lors de sa relecture par le Sénat, les manifestations d’associations antiracistes. Le 22 février, 100 000 personnes manifestent à Paris.
On en revient au texte initial. Cette question est pourtant fondamentale aux yeux de l’électorat de droite.
Le drame : la dissolution
L’impasse politique semble alors complète, et fait naître l’idée d’une solution de repli par la dissolution de l’Assemblée nationale.
La dissolution selon le général de Gaulle
Notre peuple a condamné à une majorité immense le régime désastreux qui livrait la République à la discrétion des partis et qui une fois de plus avait failli jeter la France au gouffre.
Discours du 18 octobre 1962
Dans l’esprit du général de Gaulle, la dissolution est l’ultime recours du pouvoir exécutif en conflit avec le Parlement. En 1962, de Gaulle dissout parce qu’il fait face à une rébellion de parlementaires opposés à l’élection du président de la République au suffrage universel direct. En 1968, il veut obtenir une majorité suffisante face aux gigantesques émeutes qui secouent le pays.
La dissolution n’est pas, pour de Gaulle, un outil de tactique politique.
Le général aurait dit à Peyrefitte contre ceux qui l’engageait à dissoudre en 1966 :
Quelle idée ! Les Français ne comprendraient pas. Nous ne sommes pas l’Angleterre, il n’y a vraiment de raison d’écourter le mandat. La dissolution est une arme qu’il ne faut pas émousser. Pourquoi renvoyer une Assemblée où il y a une majorité et essayer de la remplacer par une Assemblée où il n’y en aurait peut-être pas ? L’opposition ferait sa campagne contre cette décision injustifiée. Elle pourrait bien entraîner la conviction des électeurs. Ensuite, je serais privé, pendant un an, de la capacité de dissoudre la nouvelle Assemblée. La Ve République, c’est la stabilité. La dissolution n’est fait que pour répondre à des crises.
En d’autres termes, elle sert surtout comme arme de dissuasion pour le président contre le Parlement, et à tirer la conclusion de victoires aux élections présidentielles.
Mitterrand a, lui, respecté l’esprit des institutions. En 1981 comme en 1988, il dissout après avoir été élu à la fonction suprême. Mais lors des difficultés des gouvernements Rocard, Cresson et Bérégovoy, il n’a pas dissous l’Assemblée.
Pourquoi choisir la dissolution ?
Le pessimisme est à l’ordre du jour. Les prévisions économiques sont mauvaises pour 1997/1998. En outre, le gouvernement prévoit d’être contraint d’augmenter la pression fiscale pour respecter les critères de Maastricht, c’est-à-dire réduire son déficit pour entrer dans l’euro. Il semble opportun de couper “l’herbe sous le pied” de la gauche avant l’arrivée de ces échéances, c’est-à-dire empêcher L. Jospin de former une opposition cohérente autour de lui.
Pourtant le gouvernement dispose d’une majorité qui lui reste fidèle, malgré des épisodes de fronde. Elle lui épargne le risque de devoir justifier, auprès de son électorat, un nouveau vote en sa faveur alors que sa politique a été en contradiction manifeste avec sa campagne. Elle lui permet en outre d’endiguer, temporairement, l’influence du FN.
La campagne législative de 1997
Le 21 mars, Jacques Chirac annonce à la télévision sa volonté de “redonner la parole au peuple”. Mais il ne parvient pas à expliquer clairement la raison de la dissolution.
A. Juppé, annonce aux députés, le 22 mars, la poursuite de la même politique en cas de victoire. La perspective est peu mobilisatrice.
L. Jospin le comprend bien. Un boulevard s’ouvre à lui. Les verts, les communistes et le parti socialiste s’allient. Ils élaborent un programme très modéré en vingt-deux points. La proposition la plus controversée est l’instauration de la semaine de 35 heures.
Jacques Chirac se compromet
Dans la campagne, Jacques Chirac se compromet dangereusement. Il fait paraître dans la presse régionale une “tribune libre”, au risque de réduire son rôle à celui de simple éditorialiste.
La fin du gouvernement Juppé
Les résultats de la droite au soir du premier tour, le 25 mai, sont mauvais. Avec à peine 36% des voix, elle réduit son score de 8 points par rapport à 1993. La coalition de gauche obtient 42% des voix, le FN 15%. L’abstention, elle, s’élève à 32%. Les jeunes des milieux populaires, qui avaient voté Chirac, le désavouent désormais. 548 sièges font l’objet d’un ballotage. Mais la réserve de voix de la droite paraît faible. Les candidats de gauche, en revanche, peuvent se désister les uns pour les autres.
La droite, après Vitrolles, ne peut pas envisager de bénéficier de la stratégie de “front républicain” là où elle est en concurrence avec le FN. La gauche, au seuil de la victoire, n’a pas intérêt à les aider.
Une chance unique demeure pour Chirac : annoncer, en cas de victoire, le changement de Premier ministre. La rumeur a pour champion Philippe Séguin. A. Juppé annonce qu’il présentera sa démission après le second tour, quoi qu’il arrive. Mais Jacques Chirac ne franchit pas le Rubicon. Il reste muet sur la question.
Le 1er juin, le couperet tombe. La remontée de la gauche est spectaculaire : elle passe de 99 sièges à 320 (246 PS, 8 écologistes, 29 divers gauche et 37 communistes). La droite perd 187 sièges. Un seul siège revient au FN.
Jacques Chirac accepte la cohabitation
Témoin impuissant de la vie gouvernementale
La légitimité personnelle de Jacques Chirac est ruinée. Mais il se maintient.
Le 2 mai, il demande à L. Jospin de former son gouvernement.
Le 4 mai, il déclare :
La France s’est prononcée. Elle a élu une nouvelle majorité. Nous voilà à nouveau en période de cohabitation. Je ne doute pas que celle-ci se déroulera dans la dignité, le respect mutuel, et un souci constant des intérêts de la France.
Le président de la République devient une nouvelle fois plus témoin qu’acteur de la vie gouvernementale. Il est privé pendant un an de son pouvoir de dissoudre l’Assemblée. Chirac cherche alors à “durer” jusqu’à la prochaine élection.
De Gaulle voyait dans les échéances électorales successives une remise en cause permanente de sa légitimité à gouverner la Nation. Le maintien d’un président gaulliste malgré le désaveu de la nation semble avoir condamné définitivement cette pratique.









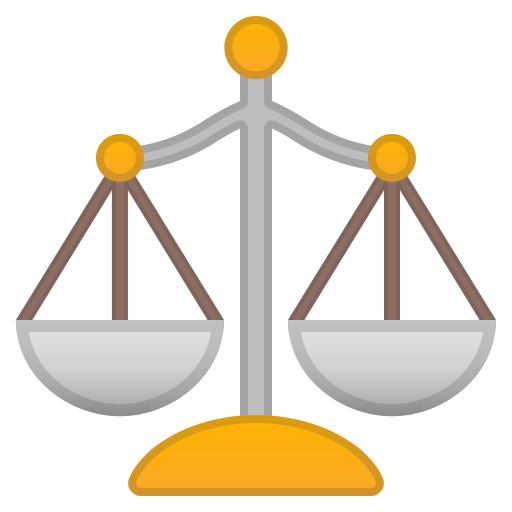









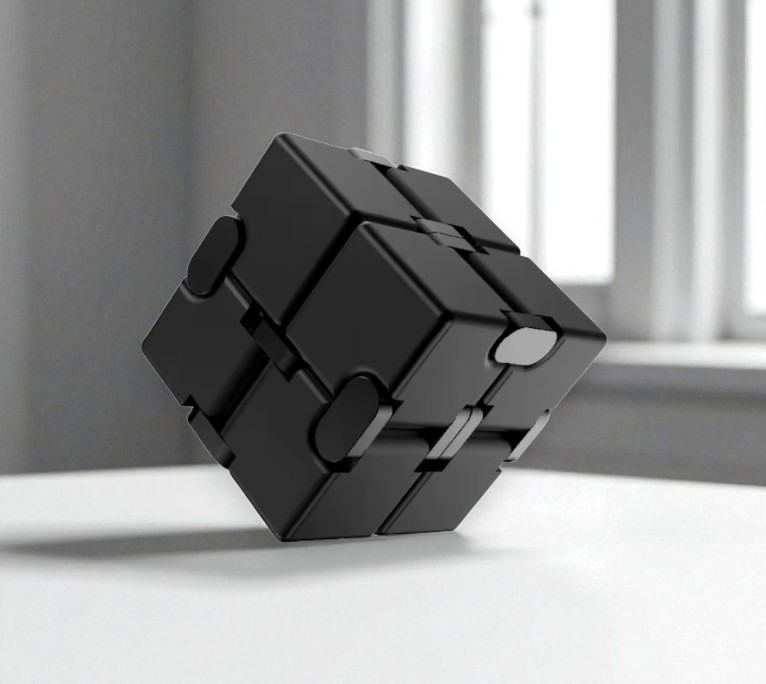

















Laisser un commentaire