
⏳ Temps de lecture : 4 minutes
La réponse
On peut écrire : à Avignon ou en Avignon. Les deux formes existent. Aujourd’hui, on emploie généralement la préposition « à » devant les noms de ville (à Paris, à Marseille, à Bordeaux, etc.). Cependant, devant le nom de certaines villes, comme Avignon ou Arles, on lit parfois « en ». Cet usage, inspiré par la manière italienne selon l’Académie, existait autrefois devant les noms de ville, en concurrence avec « à ».
Et luy faisant bailler enfans de toutes qualitez edifia lieux & escoles convables en Paris…
G. Corrozet, Les Antiquitez…, 1586
En Orléans assiegee, ;
Laissant le dangier à part,
Dans le camp & dans la ville
J’apprins du soldat le stille
Et les vocables de l’art.D’Aubigné (1552 – 1630), Le Printems
Gilles Ménages (1613 – 1692) constate dès le XVIIe siècle, dans ses Observations sur la langue française, (1672 – 1676), la raréfaction de cet usage, sauf pour Avignon et Arles. On le trouve ainsi chez Stendhal (1783 – 1842) qui raconte ce que lui dit un homme à Valence :
— Il faut que vous soyez bien bête, monsieur, de dépenser votre argent à courir la poste d’ici à Avignon ! Fourrez-moi votre voiture sur le bateau qui passe ici demain matin à dix heures, et à trois vous êtes en Avignon.
Le maintien plus tardif de cet usage pour Avignon s’explique peut-être par la persistance d’une tournure locale de langage, ou par une imitation de l’occitan (un des rénovateurs de l’occitan, Frédéric Mistral, écrit : « Qu’en Avignoun avès plantado »). Mais il faudrait expliquer pourquoi la préposition ne s’est pas maintenue pour des villes comme Marseille, Aix ou Toulon. C’est peut-être le désir d’éviter le hiatus qui explique cet archaïsme, mais il se serait alors aussi maintenu pour Aubagne, Aigues-Mortes, Aix-en-Provence, etc. On peut aussi l’expliquer par un goût pour l’archaïsme. En effet, l’entrée « en Avignon » compte 4164 résultats pour le XXe siècle, plus que pour les six siècles précédents, où la production écrite était bien sûr moindre. C’est peut-être même un pseudo-archaïsme, au vu du peu de résultats pour les XVI (28) et au XVII (83). Ce goût s’est peut-être développé sous l’influence de certains auteurs, notamment celle d’Alphonse Daudet (1840 – 1897), un Nîmois, qui l’a utilisé à plusieurs reprises dans ses œuvres provençales, pour en renforcer le decorum régional :
Sa corde, coquin de sort ! Sa corde tissée de fer, fabriquée en Avignon.
Il y en a un surtout, un bon vieux, qu’on appelait Boniface… Oh ! celui-là, que de larmes on a versées en Avignon quand il est mort !
Une autre hypothèse avance le fait qu‘Avignon et ses alentours formaient avant 1791 une entité territoriale qui faisait partie des États de l’Église : le Comtat venaissin. S’y rendre était alors comme se rendre dans un autre pays, « aller en Avignon » comme « en Italie ».
Quelques Ministres & Diacres sont aussi prisonniers en Avignon & à Carpentras.
Tableau de l’histoire des princes et principautés d’Orange, 1640 / Soit « en Avignon » est l’équivalent d’ « à Carpentras », soit « en » souligne son statut différent
La dessus le pape Innocent VI seant en Avignon, se rend entremetteur …
Et pour ce qui est en particulier de la translation du siege Apostolique en Avignon …
C’est probablement dans ce sens que cette locution est employée par Furetière dans son Dictionnaire (1690) :
Elle est nommée graine d’Avignon, parce qu’on la prepare en Avignon.
Exemple contemporain : les historiens Caroline Costedoat et Michel Signoli emploient « en Avignon » parce qu’ils parlent d’Avignon et ses alentours, sous contrôle du pape :
En Avignon, l’épidémie de 1347 a tué onze mille personnes, le retour de la peste en 1361 provoqua dix-sept mille décès.
La Peste noire
Même chose ci-dessous : c’est à l’État qu’il est fait référence :
En Avignon, enclave pontificale dans le royaume de France, le médecin et naturaliste Esprit-Claude-François Calvet (1728-1810) proclame tout aussi nettement son attachement à la République des Lettres et des Sciences.
Pierre-Yves Beaurepaire, L’Europe des Lumières
À Avignon
« À Avignon » est considéré comme encore plus fréquent qu’« en Avignon » par Le Bon Usage (14e édition). Ce google N-gram semble le montrer, bien qu’il indique une persistance marginale d’«en Avignon ».

Exemples :
Aujour-d’huy il est élevé dans une chasse à Avignon…
Scipion Dupleix, Continuation de l’histoire du règne de Louis le Juste, 1648
Si vous revenez chez les hérétiques, après vous être muni d’indulgences à Avignon, je vous ferai les honneurs de Lausanne, mieux que je ne vous fis ceux de Genève. Vous y verrez une plus belle situation.
Voltaire, Correspondance, 1758
On le croyait créole. Il avait probablement un peu touché au maréchal Brune, ayant été portefaix à Avignon en 1815. Après ce stage, il était passé bandit.
Aujourd’hui
« À Avignon » est la forme standard, et « en Avignon » est rare, peut-être parce que parfois moqué comme un archaïsme affecté et ridicule, ou réprouvé tout simplement comme une faute de français.
Porte-parole de LREM, il s’en explique dans une ode au dépassement dont la publication coïncide avec la grand-messe du parti majoritaire, ce week-end en Avignon.
Liberation.fr / Le journaliste reprend la locution employée par le parti politique
La mairie d’Avignon avait publié sur site un texte, aujourd’hui supprimé, réprouvait en des termes très sévères cet emploi :
La formule en Avignon, si elle permet d’éviter un hiatus quelque peu dissonant, est toutefois incorrecte lorsqu’elle s’applique à la ville contenue dans ses limites communales. Son emploi dans ce cas est souvent le fait de l’ignorance ou d’un certain pédantisme basé parfois sur des nostalgies d’Ancien Régime. »
Elle ajoutait cependant que :
l’usage a voulu que l’on tolère de nos jours encore les expressions “en Arles” ou “en Avignon” pour désigner la région autour de la ville, le “pays” formé par les environs, sans limites administratives bien établies.
Au contraire de la mairie, l’Académie française s’en accommode :
Remarque : On ne saurait condamner les tournures en Arles, en Avignon, bien attestées chez les meilleurs auteurs, et qui s’expliquent à la fois comme archaïsme (l’usage de en au lieu de à devant les noms de villes, surtout commençant par une voyelle, était beaucoup plus répandu à l’époque classique) et comme régionalisme provençal. Il semble cependant que cet emploi de en soit en régression.

































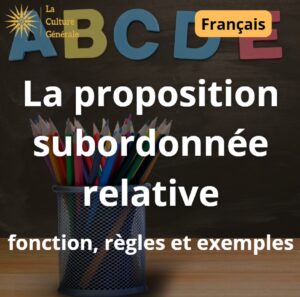



Là vous avez tout faux, aussi bien sur le a ou en pour Arles et Avignon, et sur “éviter le hiatus” (le h n’est pas aspiré donc on dit l’hiatus)