
⏳ Temps de lecture : 3 minutes
Ce article vous présente 14 mots du vocabulaire de la poésie afin de vous aider à mieux comprendre vos lectures.
La prosodie
L’ensemble des règles de versification d’une langue (comme la règle des e muets).
L’allitération et l’assonance
- En général, on parle d’allitération pour la répétition d’une consonne, et d’assonance pour la répétition d’une voyelle.
- Allitération : « Tamtam sculpté, tamtam tendu qui gronde » (Leopold Sedar Senghor, Femme noire). Ici, l’auteur répète le son « t », assimilable au bruit du tamtam.
- Assonance : « Tout m’afflige et me nuit et conspire à me nuire. » (Racine, Phèdre, I, 3)
Un acrostiche
- Un acrostiche est un jeu littéraire qui à consiste à écrire un poème dont on peut lire un mot formé par les initiales des vers
- Exemple : les initiales du premier mot de chacun des vers de la
strophe suivante forment le mot JULIE.
« Je ne saurais nommer celle qui sait me plaire
Un fat pour se vanter, un amant doit se taire
La pudeur qu’alarmait l’impétueux désir
Inventa sagement le voile du mystère
Et l’amour étonné connut le vrai plaisir » (Apollinaire, La Guirlande de Julie)
La qualité des rimes
- Les rimes peuvent être classées en fonction de leur
qualité ou de
leur richesse. La qualité ou la richesse de
la rime désigne le nombre de sons répétés.
- Rimes pauvres (un seul phonème en commun) : « Feuilles de jour et mousse de rosée, / Roseaux du vent, sourires parfumés, » (Éluard, La courbe des tes yeux)
- Rimes suffisantes (deux phonèmes en commun) : « Il était, quoique riche, à la justice enclin ; / Il n’avait pas de fange en l’eau de son moulin ; » (Hugo, Booz endormi)
- Rimes riches (trois phonèmes en commun ou plus) : « Plus mon Loire gaulois, que le Tibre latin, / Plus mon petit Liré, que le mont Palatin, » (Du Bellay, Heureux qui comme Ulysse)
Un sonnet
- Poème de quatorze vers, composé de deux quatrains (deux strophes de quatre vers) et de deux tercets (deux strophes de trois vers). Les rimes des premiers quatrains sont embrassées, les deux premières rimes du premier tercet sont suivies, tandis que les quatre dernières sont soit embrassées (un sonnet italien) soit croisées (un sonnet français).
- Exemple de sonnet français (les quatre dernières rimes sont
croisées)
« Hôte pour quelques jours de votre beau domaine,
Voyant le gai soleil qui dore le matin
Et perce d’un rayon les feuilles de satin,
Je descends dans le parc et tout seul m’y promène.On pense aller bien loin, mais tout sentier ramène,
Quand il vous a montré le village lointain,
À travers prés et bois, par un contour certain,
Au portique où César a mis l’aigle romaine,À la blanche villa, votre temple d’été,
Où, lasse du fardeau de la divinité,
Vous daignez n’être plus que la bonne princesse ;Ainsi fait mon esprit, trompé dans ses détours :
Il croit poursuivre un rêve interrompu sans cesse,
Et devant votre image il se trouve toujours ! » (Gautier, Mille chemins, un seul but)
Un calligramme
- Un poème dont les vers sont disposés de telle manière qu’ils forment un dessin.

Une diérèse
- Prononciation en deux syllabes distinctes de deux voyelles qui se suivent.
- Exemple : « Que des palais Romains le front audaci-eux » (Du Bellay, Heureux qui comme Ulysse). Il faut bien marquer le fait que l’on prononce « ci » et « eux » en deux syllabes distinctes.
Une synérèse
- Prononciation de deux voyelles qui se suivent en une seule syllabe.
- Exemple : « Dieu que l’Hébron connait, Dieu que Cédar adore, » (Lamartine, À la Grande Chartreuse). Dieu ne compte que pour une seule syllabe à chaque fois (pour respecter l’alexandrin)
Un enjambement
- Une phrase commencée dans un vers se prolonge dans le suivant.
- Exemple :
« Un pauvre Bûcheron tout couvert de ramée,
Sous le faix du fagot aussi bien que des ans
Gémissant et courbé marchait à pas pesants,
Et tâchait de gagner sa chaumine enfumée. » (La Fontaine, La Mort et le Bûcheron)
Un rejet
- Un mot ou un groupe de mots se trouve « rejeté » au vers suivant.
- Exemple :
« Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l’herbe, sous la nue, » (Rimbaud, Le Dormeur du val)
Un contre-rejet
- Un vers commence au vers précédent.
- Exemple :
- « Un homme de génie apparaît. Il est doux,
Il est fort, il est grand ; il est utile à tous ; » (Hugo, Melancholia)
- « Un homme de génie apparaît. Il est doux,
Les hémistiches
- Chacune des deux moitiés d’un alexandrin (douze syllabes).
-
Exemple : « Le
Prince d’Aquitaine à la Tour abolie : » (Nerval, El
Desdichado)
- Premier hémistiche « Le·Prin·ce ·d’A·qui·taine » (6 syllabes)
- Second : « à·la·Tour·a·bo·lie : » (6 syllabes)
Un distique
- Strophe de deux vers qui forment un sens complet (une unité dans le sens)
- Exemple :
« Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté. » (Baudelaire, L’Invitation au voyage)

































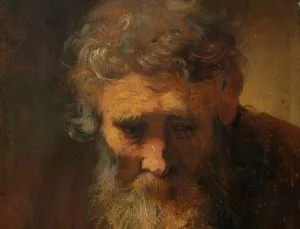



Clair et précis, rappel bienvenu de ces règles de la poésie. Intéressant aussi, merci
Intéressant. J’ai publié aussi quelques recueils. les écrivant, je ne savais les règles de la poésie. Je me demande si Arthur Rimbaud dans sa poésie sans rimes, globale suivaient les règles.