
⏳ Temps de lecture : 7 minutes
Définition
La définition du « mot-valise » (plus rarement mot-tiroir, emboîtement lexical ou croisement) peut varier selon les points de vue, mais désigne en général un néologisme (un mot nouveau) formé à partir de deux autres mots au moins. Les mots sont imbriqués les uns dans les autres pour en former un nouveau. Ce nouveau mot désigne une réalité nouvelle qui est, on le suppose, une fusion de que désignent ses mots parents :
- Le mot-valise « divulgâcher » a été forgé à partir des verbes « divulguer » et « gâcher », et désigne le fait de gâcher le plaisir de suivre un récit (un film, une série) en divulguant des éléments importants d’une intrigue à ceux qui ne le savent pas encore. Ce mot traduit l’anglais spoiler. On le voit, « divulgâcher » combine bien les sens de ses deux mots parents.
Un mot formé par simple préfixation ou suffixation ne peut être considéré comme un mot-valise (ils ne contiennent pas véritablement deux mots).
La formation du mot-valise
La plupart des mots-valises sont formé à l’aide du processus de troncation, en supprimant la fin d’un mot (apocope) ou le début d’un autre (aphérèse). Exemple :
- Foultitude, composé à partir de « foule » dont on a supprimé le -e final (apocope) et de « multitude » dont on a supprimé multi- (aphérèse). Foultitude est un synonyme de multitude, mais a, contrairement à lui, une connotation plaisante et légère. Il appartient au langage oral.
Ce n’est pas le seul procédé de formation d’un mot-valise : ils peuvent être formés par deux apocopes, ou en insérant un mot dans l’autre (très rare). Exemples :
- le manfra, composé de « manga » et « français ». Deux apocopes.
- un escalator : invention faite aux États-Unis, dont le nom est un hybride (il mélange deux langues) formé à partir de l’anglais elevator (« ascenseur ») et de l’insertion en son milieu de l’italien scale (« escalier »). Il désigne par antonomase tous les escaliers mécaniques.
Nombre de mots-valises sont formés autour de syllabes communes (de phonèmes communs). Ce phénomène est dénommé l’haplologie :
- Tragi-comique, formé à partir de « tragique » et « comique », partage en son centre le phonème [k] (le qu de tragique, le c de comique). Le « que » final des deux termes aide à la fusion.
- Infox a été forgé à partir d’« info » (abréviation d’informations) et d’« intox » qui partagent les phonèmes [ɛ̃] (« in ») et [o].
- Le nom de l’association sidaction, formé à partir de sida (un acronyme) et d’action, sans troncation.
Par la troncation, de nombreux mots perdent leur autonomie : dans divulgâcher, gâcher reste compréhensible (il conserve son signifiant), mais divul- seul n’a pas de sens (bien que l’on comprenne quel mot il abrège).
Certains mots-valises, rares, sont des hybrides qui mélangent deux langues. C’est le cas d’escalator, mais aussi du mot japonais freeter, formé à partir de l’anglais free et de l’allemand arbeiter (travailleur), qui désigne au Japon un jeune travailleur indépendant sans qualification.
Compréhension
De nombreux mots-valises sont transparents : on reconnaît les mots à partir desquels ils ont été formés, ou le contexte dans lequel ils sont employés aide à les comprendre.
- Le mot valise britannique Brexit, bien qu’anglais, est assez transparent, d’autant que l’un des composants n’a pas été tronqué : Britain + exit. Le contexte politique autour du Brexit a par ailleurs aidé à rendre ce mot-valise plus compréhensible.
D’autres, plus techniques, sont difficilement lisibles par les néophytes, d’autant que nombre de mots-valises anglais sont employés en français :
- Un calligramme, mot-valise inventé par Apollinaire à partir de « calligraphie » (l’art de bien former les lettres) et d’« idéogramme » (caractère qui a un sens en lui-même, comme les idéogrammes chinois). Un calligramme est donc un poème dont la forme même a un sens.
- Un incel, de l’anglais involutary celibate, désigne un homme qui désire être en couple qui n’arrive pas à l’être, et qui développe parfois une pensée et un discours misogynes. Ce terme est courant sur l’internet francophone, mais n’est pas transparent immédiatement à ceux qui, par exemple, n’ont pas la culture de certains réseaux (Reddit, Twitter, etc.).
Certains mots-valises, anciens ou très courants, ne sont plus perçus comme tels par les usagers :
- Embrouillamini est un mot-valise ancien (XVIIe siècle) formé à partir d’« embrouillé » et « brouillamini ». Le fait que ce dernier terme sorti d’usage rend impossible la détection spontanée de son étymologie.
- Photomaton est une marque déposée américaine dont le nom a été formé à partir de photography et d’automaton (automate) avec haplologie (« oto » et « auto ») Ce mot-valise est devenu une antonomase : ce nom propre est devenu un nom commun pour désigner toutes les cabines de photographie d’identité.
- Valdinguer, composé de « valser » et de « dinguer », verbe sorti d’usage dont le sens était « tomber, s’effondrer ».
Sources de formation des mots-valises
La formation des mots-valises peut avoir plusieurs motivations :
- créer un mot-nouveau pour désigner un réalité
nouvelle : un ligre (lion+tigre) pour le petit d’un lion
et d’une tigresse, potimarron (potiron+marron) pour désigner une
courge originaire de Chine, etc.
- pour désigner, parfois, des phénomènes de société (des concepts journalistiques frappants pour créer de l’engagement) : le trouple par exemple (trois+couple, relation amoureuse qui implique trois personnes).
- créer un mot frappant pour faire de la rhétorique :
- en politique : les merdias, mot-valise polémique composé de merde et de médias pour dénoncer ces derniers ; le franglais (français + anglais) pour dénoncer la prégnance de certains anglicismes en français (dans la langue des cadres des grandes entreprises ou des startups par exemple).
- pour faire de la publicité : les alicaments (aliments+médicaments), le carambar, etc.
- faire de l’humour : un éléphanfare (éléphant + fanfare), ridicoculiser (Edmond Rostand, ridiculiser + cocu), etc.
- Créer un équivalent français à un mot étranger (pour lutter contre les anglicismes le plus souvent, par initiative des autorités linguistiques québécoises le plus souvent) : infox pour fake news, courriel pour email, pourriel pour spam, etc.
L’espérance de vie des mots-valises dépend de la réalité qu’ils désignent. Si certains s’installent durablement dans le langage, d’autres en sortent vite, voire ne parviennent pas à y entrer du tout. Certains mots-valises n’intéressent qu’un petit groupe d’usagers, parce qu’ils ne touchent qu’un domaine spécialisé, ou une sous-culture, etc.
- Nombre de traductions d’origine québécoise de termes techniques anglais liés à l’informations ne sont pas courantes en français d’Europe : pourriel, balado (pour podcast), costumade (pour cosplay), égoportrait (selfie), ordiphone (pour smartphone).
- Des mots-valises sont frappés d’obsolescence (coronapiste, covidiot, fanzine), ou sont des concepts socio-journalistiques qui ne prennent pas (les tracances, travail+vacances, des vacances où l’on travaille…).
- Certains ne touchent qu’un groupe de personnes : la stagflation (stagnation+inflation), un hackathon (hack+marathon, un événement pendant lequel des développeurs tentent de résoudre ensemble des problèmes), mécatronique (mécanique+électronique), gaydar (gay+radar), etc.
Étymologie de mot-valise
Mot-valise est probablement un calque (une traduction littérale) de l’anglais portmanteau word, terme inventé dans par l’écrivain Lewis Carroll (1832 – 1898) dans Through the Looking-Glass (1871). Un portmanteau désigne en anglais une grosse valise servant à transporter des vêtements. La métaphore qui prend appui sur la valise vient probablement du fait que plusieurs éléments sont enfermés dans un contenant pour ne faire qu’« un » (« […] there are two meanings packed up into one word »).
Acronyme et mot-valise
Les acronymes sont proches des mots-valises. Ce sont des abréviations, souvent des sigles, qui se prononcent comme des mots nouveaux. Mais les mots-valises tentent de former un mot nouveau pour désigner une réalité nouvelle, c’est-à-dire former mot « autonome », alors que l’intention qui préside à la création des acronymes est d’abréger un syntagme.
- Bobo est une abréviation de bourgeois-bohème, le bobo est un bourgeois-bohème, alors que tigron n’est pas l’abréviation de tigre-lionne (qui ne veut rien dire), mais un être nouveau formé à partir de ces deux animaux.
- Dircom est l’acronyme de directeur de la communication. Un dircom n’est pas autre chose qu’un directeur de la communication.
Liste de mots-valises
- adulescence : « adulte » + « adolescence » ; désigne un adulte qui se comporte comme un adolescent, ou le retard du passage d’un état à l’autre.
- artivisme: formé de art + d’activisme ; activisme par l’art.
- bidonville : de bidon + ville.
- bistroquet : de bistrot + troquet
- brunch : de l’anglais breakfast + lunch, pour désigner un repas qui combine les aliments mangés au petit-déjeuner et au déjeuner.
- burkini : de burka et bikini. Joue sur la répétition de la séquence b-k.
- cellophane : cellulose + diaphane ; désigne le film plastique transparent aux usages multiples.
- copillage : de copie + pillage ; désigne le fait de dupliquer le contenu de certains livres, en les photocopiant notamment.
- (Train) corail : confort + rail.
- carambar : caramel en barre. Jeu avec le changement de prononciation du « am » de « caramel » qui reprend le phonème de « en » dans carambar.
- célibattant(e) : de célibataire + battant ; désigne un célibataire qui se de bat pour s’en sortir, ou une personne heureuse dans le célibat.
- cultivar : de l’anglais cultivated + variety ; désigne les plantes cultivées d’une espèce.
- daron : croisement très ancien de baron et de dam, « seigneur, maître ».
- flexitarien : flexible + végétarien, calque d’un mot-valise anglais. Quelqu’un qui mange de la viande occasionnellement. L’usage du mot-valise, et du concept qui va avec, est notamment porté par des groupes d’intérêt du secteur de la viande pour prendre en compte le développement supposé du végétarisme.
- foutraque : fou + patraque. Familier et amusant.
- fauxmage : de faux + fromage, appellation commerciale de produits vegans qui essaient d’imiter le goût et la consistance du fromage. Jeu sur la paronymie entre « faux » et du « fro » de fromage.
- féminazi : de féministe + nazi ; ce mot-valise polémique a été inventé aux États-Unis et diffusés par les commentateurs conservateurs pour disqualifier et dénigrer certaines féministes. Le qualificatif de nazi tente de disqualifier par association.
- La Françafrique : de France et Afrique ; mot-valise aujourd’hui péjoratif à propos des relations entre la France et les États de ses anciens territoires coloniaux.
- globish : global + english, désigne un anglais simplifié employé pour les communications internationales, parfois péjorativement.
- Handisport : de l’anglais handicap et sport.
- iel : de il + elle, pronom personnel neutre inventé pour constituer une langue inclusive.
- Indonésie : de l’anglais Indonesia, formé sur les composés grecs indos (Indus, et Inde par extension) et nesos (île).
- Motel : de l’anglais motor + hotel, pour désigner les hôtels situés le longs des routes aux États-Unis.
- Multiplex : de multi + complexe.
- Napalm : de l’anglais naphthenic et palmitic, deux composants de ce produit employé pour fabriquer des bombes incendiaires, utilisées pendant la guerre du Vietnam notamment.
- Nescafé : de nestlé + café.
- Novlangue : de nouveau + langue, calque de l’anglais Newspeak, langue officielle de l’Océania, État inventé par George Orwell dans son roman 1984 (1949).
- Oxbridge : l’ensemble formé par Oxford et Cambridge, deux grandes universités britanniques.
- Parapente : de parachute + pente.
- Paralympique : de l’anglais paraplegic + olympics.
- Podcast : iPod + broadcast, format inventé par Apple ; l’Office québécois de la langue français a proposé de le traduire par balado, abréviation de baladodiffusion, formé sur baladeur + radiodiffusion.
- Pom’potes : pomme + compote, et jeu sur la paronymie avec potes (amis).
- Smog : de l’anglais smoke (fumée) et fog (brouillard), du nom d’un brouillard formé par la pollution atmosphérique.
- Tanzanie : à partir du mot-valise anglais Tanzania, formé de Tanganyika + Zanzibar, avec un suffixe en –ia en anglais, -ie en français.
- Téléthon : de télévision + marathon.
- Velcro : de velours + crochet, antonomase qui désigne le système d’accrochage inventé par l’entreprise du même nom.
- Vélib : service de vélo en libre service parisien, formé sur vélo + liberté.




























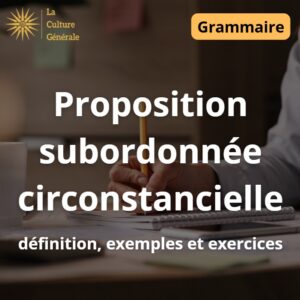

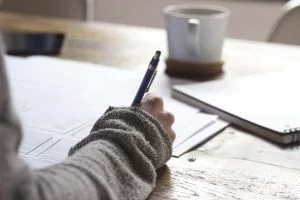






Alice, désignant une allée, demande à Humpty-Dumpty : -Et pourquoi l’appelle-t-on “alloinde” ? Réponse de Humpty-Dumpty : -On l’appelle “alloinde”, voyez-vous bien, parce qu’elle s’allonge loin devant et loin derrière ! (Derrière le miroir)
“L’animal seul, Monsieur, qu’Aristophane appelle hippocampéléphantocamélos, dut porter sur le front tant de chair sur tant d’os.” (Edmond Rostand; Cyrano de Bergerac.)