
⏳ Temps de lecture : 13 minutes
Ce qu’il faut retenir
-
Premier tribunal international de l’histoire, le procès de Nuremberg (1945-1946) a jugé 24 hauts responsables nazis pour crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l’humanité.
-
Le procès a établi le principe de responsabilité pénale individuelle en droit international, rejetant l’excuse “d’ordres supérieurs” comme défense absolue.
-
Sur les 21 accusés jugés, 12 ont été condamnés à mort, 7 à des peines de prison et 3 acquittés, avec Hermann Göring qui s’est suicidé avant son exécution.
-
Le procès a créé le concept juridique de “crime contre l’humanité” et posé les bases du droit pénal international moderne.
-
Malgré les critiques de “justice des vainqueurs”, Nuremberg reste un tournant historique qui a influencé la création de la Cour pénale internationale et d’autres tribunaux internationaux.
Contexte historique du procès de Nuremberg
Vous vous demandez peut-être pourquoi le procès de Nuremberg reste si emblématique dans l’histoire mondiale. La réponse est simple. Ce procès représente un tournant décisif dans l’histoire du droit international. Après la Seconde Guerre mondiale, les Alliés victorieux se trouvaient face à un dilemme sans précédent : comment juger les responsables des atrocités nazies ?
Le 8 mai 1945, l’Allemagne nazie capitule. Les puissances alliées découvrent alors l’ampleur des crimes commis. La décision est prise : les principaux responsables devront répondre de leurs actes devant un tribunal international. Ce sera Nuremberg, ville symbolique du nazisme, qui accueillera ce procès historique.
Les discussions préliminaires commencent dès l’été 1945. Le procès de Nuremberg est officiellement établi par l’Accord de Londres du 8 août 1945, signé par les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l’Union soviétique. Cet accord définit la structure du tribunal et les principes juridiques qui guideront son action.

La fin de la Seconde Guerre mondiale et la découverte des crimes nazis
Vous entrez dans l’Europe de 1945. Le continent est dévasté. Les armées alliées avancent et découvrent l’horreur. Les camps de concentration sont libérés un à un. Les preuves s’accumulent. L’ampleur des crimes dépasse l’entendement.
La libération du camp d’Auschwitz le 27 janvier 1945 révèle au monde l’industrialisation de la mort mise en place par le régime nazi. Les soldats alliés documentent méticuleusement ces découvertes. Photos, films, témoignages : tout sera utilisé comme preuve lors du futur procès.
Les statistiques sont glaçantes : près de 6 millions de Juifs exterminés, des millions de civils soviétiques, polonais, roms, handicapés et opposants politiques assassinés. Face à ces crimes sans précédent, une réponse juridique inédite s’impose.

La décision des Alliés d’établir un tribunal international
La question se pose rapidement : comment juger ces crimes ? Certains, comme Churchill, proposent initialement des exécutions sommaires des principaux dirigeants nazis. Cette option est finalement écartée.
Les États-Unis, sous l’impulsion du juge Robert H. Jackson, plaident pour un procès équitable. Un tribunal international permettrait de juger les criminels nazis tout en établissant un précédent juridique pour l’avenir. La justice, et non la vengeance, doit prévaloir.
Le 8 août 1945, l’Accord de Londres est signé. Il établit le Tribunal militaire international (TMI) et définit sa compétence. Quatre chefs d’accusation sont retenus : complot contre la paix, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Organisation et structure du Tribunal militaire international
Le Tribunal militaire international représente une innovation juridique majeure. Pour la première fois, un tribunal international est créé spécifiquement pour juger des individus accusés de crimes internationaux. Sa structure reflète la volonté des Alliés d’assurer un procès équitable tout en garantissant l’efficacité des poursuites.

Composition du tribunal : juges et procureurs des quatre puissances alliées
Le tribunal est composé de huit juges : un titulaire et un suppléant pour chacune des quatre puissances alliées. Ces magistrats viennent de traditions juridiques différentes, ce qui constitue un défi supplémentaire.
Les États-Unis sont représentés par le juge Francis Biddle, le Royaume-Uni par Sir Geoffrey Lawrence (qui présidera le tribunal), la France par Henri Donnedieu de Vabres et l’Union soviétique par Ion Nikitchenko.

Chaque pays désigne également un procureur principal. Pour les États-Unis, c’est Robert H. Jackson, juge à la Cour suprême, qui dirige l’accusation. Son équivalent britannique est Sir Hartley Shawcross, français François de Menthon (puis Auguste Champetier de Ribes) et soviétique Roman Rudenko.
Le cadre juridique innovant : création de nouveaux concepts de droit international
Le procès de Nuremberg innove en créant de nouveaux concepts juridiques. Le plus important est sans doute celui de crime contre l’humanité, défini pour la première fois dans un cadre juridique international.
L’article 6 du Statut du Tribunal définit trois catégories de crimes : les crimes contre la paix (planification et déclenchement d’une guerre d’agression), les crimes de guerre (violations des lois et coutumes de guerre) et les crimes contre l’humanité (assassinat, extermination, réduction en esclavage, déportation et autres actes inhumains commis contre des populations civiles).
Autre innovation majeure : le rejet de l’argument de l’obéissance aux ordres comme défense absolue. Les accusés ne pourront pas se cacher derrière les ordres reçus pour échapper à leur responsabilité personnelle.
Le lieu symbolique : pourquoi Nuremberg a été choisie
Vous vous interrogez peut-être sur le choix de Nuremberg. Cette décision n’est pas le fruit du hasard. Nuremberg représente un symbole puissant du nazisme. C’est dans cette ville que se tenaient les grands rassemblements du parti nazi et que furent promulguées les lois raciales de 1935.
Paradoxalement, c’est aussi l’une des rares villes allemandes disposant d’un palais de justice suffisamment grand et relativement intact après les bombardements. Le bâtiment comprend une prison attenante, ce qui facilite la détention et le transfert des accusés.

La symbolique est forte : juger les criminels nazis dans le berceau même de leur idéologie. Comme l’a déclaré Robert Jackson dans son discours d’ouverture : “Que Nuremberg, qui a connu leur plus grand triomphe, soit témoin de leur disgrâce.”
Les accusés du procès principal
Le premier procès de Nuremberg, souvent appelé “procès des grands criminels de guerre”, s’est concentré sur 24 hauts responsables du régime nazi. Ces hommes représentaient les différentes composantes du Troisième Reich : parti nazi, gouvernement, forces armées et économie.
Profils des 24 accusés : hiérarchie nazie et responsabilités
Parmi les 24 accusés initiaux, seuls 21 comparaîtront effectivement. Robert Ley se suicide avant l’ouverture du procès, Gustav Krupp est jugé trop malade pour être jugé, et Martin Bormann est jugé par contumace (on découvrira plus tard qu’il était déjà mort).
Les accusés représentent différentes sphères du pouvoir nazi :
- Dirigeants politiques : Hermann Göring (successeur désigné d’Hitler), Rudolf Hess (adjoint du Führer jusqu’en 1941), Joachim von Ribbentrop (ministre des Affaires étrangères)
- Militaires : Wilhelm Keitel (chef du Haut Commandement de la Wehrmacht), Alfred Jodl (chef des opérations)
- SS et police : Ernst Kaltenbrunner (chef de la RSHA après Heydrich)
- Administrateurs : Hans Frank (gouverneur général de Pologne), Wilhelm Frick (ministre de l’Intérieur)
- Propagandistes : Julius Streicher (directeur du journal antisémite Der Stürmer), Hans Fritzsche (directeur de la radio)
Chacun de ces hommes a joué un rôle spécifique dans la machine nazie. Leurs responsabilités variaient, mais tous étaient accusés d’avoir participé à l’entreprise criminelle du régime hitlérien.
Les grands absents : Hitler, Himmler et Goebbels
Vous remarquerez l’absence des trois principaux architectes du Troisième Reich. Adolf Hitler, Heinrich Himmler et Joseph Goebbels se sont tous suicidés dans les derniers jours de la guerre, échappant ainsi à la justice des hommes.
Hitler s’est donné la mort le 30 avril 1945 dans son bunker à Berlin, alors que les troupes soviétiques n’étaient plus qu’à quelques centaines de mètres. Goebbels, ministre de la Propagande, s’est suicidé le lendemain après avoir empoisonné ses six enfants. Himmler, chef de la SS et principal organisateur de la Solution finale, s’est suicidé le 23 mai 1945 après avoir été capturé par les Britanniques.
Leur absence au procès a privé le monde de réponses essentielles sur l’organisation des crimes nazis. Cependant, les documents saisis et les témoignages des accusés présents ont permis de reconstituer en grande partie la chaîne de commandement et les responsabilités.
Hermann Göring : figure centrale du procès
Parmi tous les accusés, Hermann Göring se distingue comme la figure la plus éminente. Numéro deux du régime nazi, Reichsmarschall, créateur de la Gestapo et de la Luftwaffe, il est le plus haut dignitaire nazi à comparaître à Nuremberg.

Göring domine les débats par son intelligence et son arrogance. Il tente de transformer le procès en tribune politique et conteste la légitimité du tribunal. Lors de son interrogatoire, il assume fièrement son rôle dans le régime nazi tout en niant toute connaissance de l’extermination des Juifs.
Sa défense s’effondre lorsque le procureur américain Robert Jackson présente des documents signés de sa main ordonnant à Reinhard Heydrich de mettre en œuvre la “solution finale de la question juive”. Condamné à mort, Göring se suicide la veille de son exécution en avalant une capsule de cyanure, privant ainsi les Alliés d’une exécution symbolique.
Les chefs d’accusation et fondements juridiques
Le procès de Nuremberg repose sur quatre chefs d’accusation principaux, définis dans l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international. Ces accusations représentent une innovation juridique majeure et posent les bases du droit pénal international moderne.
Les quatre chefs d’accusation : complot, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l’humanité
Le premier chef d’accusation concerne le complot ou plan concerté. Il s’agit d’avoir participé à l’élaboration d’un plan commun visant à commettre les autres crimes. Cette accusation établit le cadre général de la responsabilité des dirigeants nazis.
Le deuxième chef concerne les crimes contre la paix, définis comme “la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression”. C’est la première fois que le déclenchement d’une guerre est considéré comme un crime en soi.
Le troisième chef porte sur les crimes de guerre, violations des lois et coutumes de la guerre : mauvais traitements des prisonniers, exécutions d’otages, pillages, destructions sans nécessité militaire, etc.
Le quatrième chef, le plus novateur, concerne les crimes contre l’humanité : “l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux”.
Le principe de responsabilité individuelle et le rejet de l’excuse “d’ordres supérieurs”
Une innovation majeure du procès de Nuremberg est l’affirmation du principe de responsabilité pénale individuelle en droit international. Avant Nuremberg, le droit international concernait principalement les États, non les individus.
L’article 7 du Statut stipule clairement : “La situation officielle des accusés, soit comme chefs d’État, soit comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire, ni comme un motif de diminution de la peine.”
L’article 8 rejette l’argument de l’obéissance aux ordres supérieurs comme défense absolue : “Le fait que l’accusé a agi conformément aux instructions de son gouvernement ou d’un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité.” Cet article marque une rupture avec la conception traditionnelle de l’obéissance militaire.
Ces principes révolutionnaires établissent que chaque individu a une responsabilité morale et juridique, même en temps de guerre, même sous un régime totalitaire. Comme l’a déclaré le tribunal : “Les crimes contre le droit international sont commis par des hommes, non par des entités abstraites, et ce n’est qu’en punissant les individus qui commettent de tels crimes que les dispositions du droit international peuvent être appliquées.”

Les controverses juridiques : rétroactivité des lois et justice des vainqueurs
Le procès de Nuremberg a fait l’objet de critiques juridiques importantes. La principale concerne le principe de non-rétroactivité des lois pénales (nullum crimen, nulla poena sine lege). Les accusés ont soutenu qu’ils étaient jugés pour des crimes qui n’existaient pas au moment des faits.
Le tribunal a rejeté cet argument en soulignant que les crimes de guerre étaient déjà définis par les Conventions de La Haye et de Genève. Quant aux crimes contre l’humanité, le tribunal a estimé qu’ils représentaient une extension des principes humanitaires déjà reconnus.
Une autre critique concerne la “justice des vainqueurs”. Pourquoi seuls les Allemands étaient-ils jugés ? Pourquoi les bombardements alliés de Dresde ou les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki n’étaient-ils pas considérés comme des crimes de guerre ?
Le procureur américain Robert Jackson a reconnu cette difficulté dans son discours d’ouverture : “Si ces hommes sont les premiers dirigeants d’un État vaincu à être jugés au nom de la loi, ils sont aussi les premiers à avoir la possibilité de plaider leur innocence devant la loi.” Cette tension entre justice impartiale et justice des vainqueurs reste l’une des principales critiques adressées au procès de Nuremberg.
Déroulement du procès principal (1945-1946)
Le procès principal de Nuremberg s’est déroulé sur près d’un an, du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. Cette procédure monumentale a établi un précédent dans l’histoire judiciaire mondiale par son ampleur et sa méthodologie.
Chronologie des 218 jours d’audience
Le procès s’ouvre officiellement le 20 novembre 1945. Les premières semaines sont consacrées à la lecture de l’acte d’accusation et aux déclarations préliminaires. Les accusés plaident tous non coupables, à l’exception de Rudolf Hess qui refuse initialement de plaider.
De janvier à mars 1946, l’accusation présente ses arguments et ses preuves concernant les crimes contre la paix, crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. La défense présente ses arguments de mai à juillet.
Les plaidoiries finales ont lieu en juillet et août. Le tribunal se retire ensuite pour délibérer pendant près d’un mois. Le verdict est rendu le 30 septembre et le 1er octobre 1946.
Présentation des preuves et témoignages
L’accusation s’appuie sur une masse considérable de preuves documentaires. Plus de 3000 tonnes de documents ont été saisies par les Alliés. Ces documents comprennent des ordres officiels, des rapports, des journaux intimes et des correspondances qui révèlent l’ampleur et la systématisation des crimes nazis.
Des films de propagande nazis sont également projetés, ainsi que des films tournés par les Alliés lors de la libération des camps. Ces images choquantes montrent l’horreur des camps de concentration et d’extermination.
De nombreux témoins sont appelés à la barre, dont d’anciens prisonniers des camps et des officiers SS repentis. L’un des témoignages les plus marquants est celui de Rudolf Höss, ancien commandant d’Auschwitz, qui décrit froidement le fonctionnement de la machine d’extermination.
Stratégies de défense des accusés
Face à l’ampleur des preuves, les accusés adoptent différentes stratégies de défense :
- Certains, comme Göring, assument leur rôle dans le régime nazi mais nient avoir eu connaissance de l’extermination des Juifs.
- D’autres, comme Speer, plaident la repentance et affirment avoir tenté de limiter les dégâts en fin de guerre.
- Certains invoquent l’obéissance aux ordres ou l’ignorance des crimes commis.
- Enfin, quelques-uns, comme Hess, adoptent une attitude de déni total ou prétendent avoir perdu la raison.
La défense tente également de remettre en question la légitimité du tribunal, arguant qu’il s’agit d’une “justice des vainqueurs”. Cet argument est rejeté par le tribunal.
Verdict et sentences

Après de longues délibérations, le tribunal rend son verdict les 30 septembre et 1er octobre 1946. Les jugements sont individuels, reflétant la responsabilité personnelle de chaque accusé.
Répartition des condamnations
Sur les 21 accusés jugés, les sentences sont les suivantes :
| Sentence | Nombre d’accusés |
|---|---|
| Peine de mort par pendaison | 12 |
| Prison à vie | 3 |
| Peines de prison (10 à 20 ans) | 4 |
| Acquittements | 3 |
Parmi les condamnés à mort figurent Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner et Julius Streicher. Rudolf Hess, Walter Funk et Erich Raeder sont condamnés à la prison à vie.
Les acquittements concernent Hjalmar Schacht, Franz von Papen et Hans Fritzsche, faute de preuves suffisantes de leur implication directe dans les crimes nazis.
Exécution des condamnés à mort
Les exécutions ont lieu dans la nuit du 15 au 16 octobre 1946, dans le gymnase de la prison de Nuremberg. Les condamnés sont pendus l’un après l’autre, à intervalles d’environ 20 minutes.
Hermann Göring échappe à la pendaison en se suicidant quelques heures avant l’exécution, avalant une capsule de cyanure qu’il avait réussi à dissimuler. Son suicide est perçu comme un dernier acte de défi envers le tribunal.
Les corps des exécutés sont incinérés et leurs cendres dispersées dans un lieu tenu secret pour éviter la création d’un lieu de pèlerinage pour les néonazis.
Impact et héritage du procès de Nuremberg

Le procès de Nuremberg a eu un impact considérable sur le développement du droit international et la mémoire collective de la Seconde Guerre mondiale.
Établissement de nouveaux principes de droit international
Le procès de Nuremberg a posé les bases du droit pénal international moderne. Les “principes de Nuremberg”, adoptés par l’ONU en 1950, établissent que :
- Les individus peuvent être tenus responsables de crimes internationaux
- La fonction officielle n’exonère pas de la responsabilité pénale
- L’obéissance aux ordres n’est pas une excuse absolue
- Les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité sont punissables en droit international
Ces principes ont influencé la création de la Cour pénale internationale en 2002 et ont été appliqués dans d’autres tribunaux internationaux, comme ceux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda.
Influence sur la mémoire collective et l’historiographie de la Seconde Guerre mondiale
Le procès de Nuremberg a joué un rôle crucial dans la construction de la mémoire collective de la Seconde Guerre mondiale. Il a permis de documenter de manière systématique les crimes nazis et de les inscrire dans l’histoire officielle.
Les témoignages et les documents présentés au procès ont fourni une base essentielle pour les historiens de la Shoah et du régime nazi. Le procès a contribué à établir le concept de génocide, même si ce terme n’était pas encore utilisé juridiquement à l’époque.
Nuremberg a également marqué le début d’un processus de dénazification en Allemagne, visant à purger la société allemande de l’influence nazie. Ce processus a été complexe et parfois controversé, mais il a contribué à la reconstruction démocratique de l’Allemagne d’après-guerre.
Critiques et controverses persistantes
Malgré son importance historique, le procès de Nuremberg continue de susciter des débats et des critiques :
- La question de la “justice des vainqueurs” reste controversée. Pourquoi les crimes des Alliés, comme les bombardements de Dresde ou les bombes atomiques sur le Japon, n’ont-ils pas été jugés ?
- Le principe de non-rétroactivité des lois a été remis en question, notamment pour les crimes contre la paix et les crimes contre l’humanité.
- Certains accusent le procès d’avoir été trop clément envers l’industrie allemande, dont plusieurs représentants ont été acquittés ou condamnés à des peines légères.
- L’absence des principaux dirigeants nazis (Hitler, Himmler, Goebbels) a privé le tribunal de témoignages cruciaux sur l’organisation des crimes.
Malgré ces critiques, le procès de Nuremberg reste un moment fondateur du droit international et de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Comme l’a déclaré Robert Jackson : “Ce procès est l’un des plus importants tributs que le pouvoir ait jamais rendu à la raison.”
Conclusion
Le procès de Nuremberg représente un tournant majeur dans l’histoire du droit international et de la justice. Pour la première fois, des dirigeants d’un État étaient jugés pour des crimes commis au nom de cet État. Ce procès a posé les bases d’une justice internationale et a contribué à établir le principe de responsabilité individuelle pour les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.
Malgré ses imperfections et les critiques qui lui sont adressées, Nuremberg reste un symbole puissant de la volonté de la communauté internationale de ne pas laisser impunis les crimes les plus graves. Son héritage continue d’influencer le droit international et la manière dont nous concevons la justice à l’échelle mondiale.
Le procès de Nuremberg nous rappelle que la justice, même imparfaite, est préférable à la vengeance ou à l’oubli. Il nous invite à rester vigilants face aux dérives totalitaires et aux violations massives des droits humains. Comme l’a dit le juge Jackson : “La vraie plaignante à la barre de ce tribunal est la civilisation.”
Références
Encyclopedia Britannica – Nuremberg trials
United States Holocaust Memorial Museum – The
Nuremberg Trials
PBS – The Nuremberg Trials
Famous Trials – The Nuremberg Trials
Yale Law School – The Avalon Project: Nuremberg Trial
Proceedings
Deutsche Welle – Nuremberg trials: A warning to war
criminals and dictators
University of Oxford – Nuremberg war crimes trials
70 years on: a complex legacy




























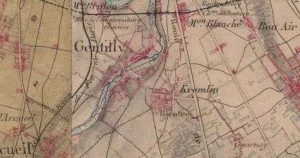









Laisser un commentaire